
International
Forum ECIU University 2025 : l’INSA Lyon confirme son engagement dans l’alliance
Les 10 et 11 juin, l’INSA Lyon participait, avec une délégation du Groupe INSA, à l’édition 2025 du Forum ECIU University à l’Università di Trento, en Italie.

L’évènement réunit 230 participants autour de l’innovation pédagogique pour des futurs durables sous forme de tables rondes, ateliers de formations et présentations thématiques. Des enseignants-chercheurs, personnels et étudiants ont pu partager leur expérience avec les nouveaux venus, leur faisant ainsi découvrir les opportunités offertes par ce réseau.
« Pour ma première participation au Forum ECIU, je suis ravi d'avoir découvert la communauté ECIU : se dégage une très forte dynamique de groupe et un très fort engagement pour faire vivre ce réseau universitaire européen. Les échanges sont riches et fraternels avec une ambition pleine de sens d'une formation universitaire transfrontalière plus résiliente et durable. » Arnaud Lelevé, enseignant-chercheur au département GE et au laboratoire Ampère.
L’innovation au cœur de la transformation sociétale. Le forum s’est ouvert avec les conclusions du challenge « Shaping the future of Chocolate », organisé par l’Université de Trento en collaboration avec la start-up Foreverland Food. Les étudiants ont développé la stratégie commerciale du Choruba, une alternative durable au chocolat créée à partir de caroube, un fruit présent sur les côtes méditerranéennes. Ce retour d’expérience illustre l’approche pédagogique du Challenge-Based Learning (CBL) : des équipes internationales d’étudiants, encadrées par des enseignants et/ou chercheurs, se mobilisant autour de problématiques concrètes soumises par des acteurs locaux (collectivités, associations ou entreprises). Leur mission : concevoir des solutions réalistes, accessibles et utiles. Le Forum a offert un espace de co-création où enseignants, chercheurs, personnels administratifs et étudiants peuvent échanger librement, favorisant de futures collaborations en pédagogie, recherche et innovation, en plaçant les étudiants au centre de projets écoresponsables.
« Le Forum ECIU permet de créer les liens européens, rencontrer les collègues d’horizons différents dans un cadre et taille adaptée. » Michal Ruzek, enseignant-chercheur au département GM et au laboratoire LaMCoS.
Pour l’INSA Lyon, le Forum a consolidé son engagement au sein de cette alliance. Il incarne la dynamique portée par ECIU University : convivialité, coopération et innovation pour répondre aux enjeux de demain.

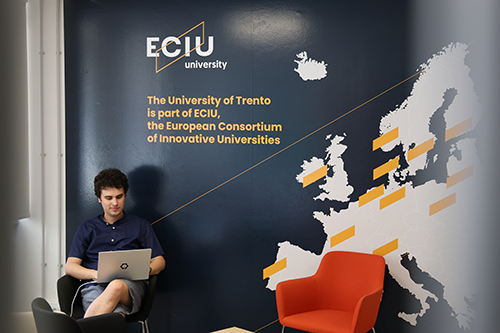
Forum ECIU University 2025, Università di Trento, Italie ©Pierre Teyssot

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Matteo DELLI COLLI
Apport des analyses numérique et expérimentale dans l’étude des contacts de type impact-glissement
Doctorant : Matteo DELLI COLLI
Laboratoire INSA : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED n°162 MEGA - Mécanique, Énergéque, Génie Civil, Acousque
L’industrie nécessite de réaliser de tests expérimentaux d’usure pour estimer la durée de vie de certains composants. Ces tests sont de plus en plus exigeants en termes de représentativité, surtout que leur endommagement représente des risques pour la sécurité. Ceci est le cas des faisceaux tubulaires supportés avec jeu dans les centrales nucléaires. Pour cette raison, FRAMATOME a développé ses propres bancs d’essais (bancs AURORE) pour étudier l’usure par impact-glissement de ces composants. Chaque banc d’essais est lui-même une structure élancée et supportée avec jeu à échelle réduite, excitée par des forces magnétiques et immergée dans un milieu aqueux à haute température et haute pression. Mis à part l’enjeu de réaliser des essais dans un tel environnement extrême, d’autres défis sont présents : la répétabilité des résultats, étant les conditions d’impact issues de la réponse dynamique d’un système non-linéaire ; la mesure des grandeurs de contact, posant la représentativité des essais des contraintes sur l’instrumentation. Cette thèse a donc deux objectifs : identifier des conditions de fonctionnement de ces bancs d’essais qui donnent des caractéristiques d’impact égales pendant un essai et répétables entre différents essais ; estimer les grandeurs du contact à partir des mesures réalisées. Pour ce faire, une approche numérique et expérimentale a été choisie. Plusieurs modèles numériques ont été mis en place, car les phénomènes ont lieu sur des échelles temporelles et spatiales différentes. La dynamique du système impactant est modélisée comme un oscillateur à impacts avec deux degrés de liberté, soumis à une force magnétique et à des forces liées à l’écrasement du fluide dans le jeu entre le tube et son support. La prise en compte de cet eet est possible grâce à la résolution de l’équation de Reynolds modifiée pour prendre en compte également une partie de l’inertie de l’eau. Ce modèle permet de réaliser des analyses paramétriques et de trouver des conditions de fonctionnement adéquates. Un autre modèle masse-ressort-amortisseur a été réalisé pour estimer les grandeurs du contact. Un modèle aux éléments finis du banc complet a été développé pour accéder à la pression de contact entre le tube et son support. Ensuite, la réalisation de tests expérimentaux d’usure et l’analyse post-mortem des échantillons ont permis de valider les résultats numériques obtenus. Les résultats de cee étude montrent le rôle de la fréquence d’excitation du système impactant pour obtenir des essais avec des caractéristiques des impacts (position, vitesse, angle et fréquence) égales et répétables entre plusieurs essais. Notamment, des impacts avec ces caractéristiques sont possibles si la fréquence d’excitation est au-delà de celle du premier mode de vibration du système impactant. De plus, dans ces conditions testées, l’eet de l’écrasement du fluide résulte négligeable sur les caractéristiques des impacts. Par conséquent, des essais similaires peuvent être réalisés en air et en eau. Concernant l’estimation des grandeurs de contact à partir des mesures, les analyses montrent un degré de cohérence variable selon les conditions d’impact. La raison est que les systèmes mécaniques sur lesquels ces mesures sont faites présentent des modes de vibrations avec des périodes du même ordre de grandeur que les périodes des contacts. En général, le plus les forces d’impact sont élevées, majeure est la vibration de ces systèmes et donc mineure est la cohérence de la mesure par rapport à la réelle dynamique du contact. Par rapport au système mécanique pour mesurer le déplacement, il est fort probable que sa dynamique pendant le contact pilote le temps de contact. Concernant les régimes de frottement (adhérence, glissement) à partir des mesures de force, leur interprétaon devient encore plus complexe en milieu aqueux.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Clémence Augustine Royer, Bâtiment Jacqueline Ferrand, INSA-Lyon (Villeurbanne)
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Emmanuel THOULON
Modèle poro-élastique multi-échelle du système tige/fémur pour fabrication additive d'une tige fémorale personnalisable à gradient de propriétés mécaniques
Doctorant : Emmanuel THOULON
Laboratoire INSA : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED n°162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique
L'arthroplastie totale de la hanche (THA) est en un remplacement complet de l'articulation de la hanche par un implant. Il s'agit du seul traitement disponible pour de nombreuses pathologies de la hanche liées à l'âge. La durée de vie de la prothèse est limitée, nécessitant souvent une nouvelle intervention au bout de plusieurs années. L'augmentation de l'espérance de vie et la baisse de l'âge de première implantation contribuent à l'accroissement du nombre de patients concernés. Le prolongement de la durée de vie des prothèses de hanche constitue un enjeu à la fois économique et sociétal. La principale cause de réintervention est le descellement aseptique, caractérisé par une résorption osseuse à l'interface os implant. Cela entraîne une instabilité de l'implant et est attribué au « bouclier de contrainte » (stress shielding), qui résulte de la différence de raideur entre le titane et l'os. Cela réduit la transmission des contraintes dans l'os et favorise la résorption osseuse liée au désusage. Dans un contexte médical plus large, où les solutions personnalisées sont privilégiées, cette thèse explore le concept de tige fémorale mécano-biofidèle, c'est-à-dire une tige imitant la géométrie et les propriétés mécaniques de l'os naturel. Alors que l'aspect géométrique a déjà été étudié par Braileanu (2020), ce travail se concentre sur la détermination de propriétés mécaniques optimales pour adapter l'implant à chaque patient. Il s'appuie sur les travaux antérieurs de Perrin (2018) et de Coftigniez (2021), qui portaient respectivement sur une modélisation poroélastique de l'os et sur la fabrication additive de supports en titane destinés à la croissance osseuse. L'objectif principal est de créer un modèle poroélastique de l'os incluant la simulation de la cicatrisation et du remodelage, puis de confronter ses résultats à ceux obtenus par fabrication additive. La cicatrisation et le remodelage étant deux processus biologiques distincts, aucun modèle numérique ne les simule simultanément. Deux modèles issus de la littérature ont été sélectionnés et implémentés dans un modèle éléments finis simplifié, axisymétrique, du système tige-fémur à l'aide de subroutines UMAT. Grâce à un document externe et à l'utilisation d'un predefine field, les calculs de remodelage reprennent au dernier pas de calcul de cicatrisation, assurant ainsi la continuité entre les deux processus. Une procédure de validation a été appliquée pour vérifier l'insensibilité au maillage, la justesse des calculs de contraintes et le comportement asymptotique de la raideur avec un nombre croissant de cycles. Pour évaluer la précision du modèle, les résultats de la simulation numérique ont été comparés à ceux de trois patientes scannées respectivement 5 mois, 4 ans et 12 ans après l'implantation. Les résultats préliminaires sont encourageants, avec une même distribution de raideur et des écarts maximaux de 6 %, 24 % et 11 %. Ils mettent en évidence certaines limites, notamment l'approximation géométrique qui réduit la précision dans la zone de la tête fémorale. La surestimation de la raideur dans le modèle de remodelage suggère une sensibilité aux conditions initiales et une possible surestimation inhérente au modèle lui-même. L'utilisation d'images préopératoires offrirait certainement des améliorations pour les futures études. Enfin, une première étude des matériaux a montré que l'introduction de porosité dans le titane permet de diminuer la raideur, de réduire l'effet de bouclier de contrainte et de favoriser la colonisation cellulaire. Un prototype poreux en titane a pu être fabriqué par stéréolithographie, tandis qu'aucune éprouvette en polymère n'a pu être produite en raison de contraintes dimensionnelles imposées par les techniques disponibles. Des recherches complémentaires sur les procédés de mise en forme des polymères seront donc nécessaires. La prochaine étape de ce travail consistera en une caractérisation mécanique et biologique de l'éprouvette en titane.
Informations complémentaires
-
INSA Lyon - Salle René Char, 14 avenue des arts, INSA-Lyon, 69100 Villeurbanne
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Tristan PATRIGEON
Effets de la troncature sur l'épaisseur de film dans les contacts ponctuels elastohydrodynamiques pivotants
Doctorant : Tristan PATRIGEON
Laboratoire INSA : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED n°162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique
Cette thèse est consacrée à l'étude des contacts pivotants situés à l'interface entre l'extrémité du rouleau et la collerette des roulements à rouleaux. Le but de cette étude est d'analyser l'influence de la proximité et de la forme du bord d'un solide sur l'épaisseur de film dans un contact élastohydrodynamique. De plus on étudie comment un mouvement de rotation peut affecter un contact tronqué. Afin d'approcher des mécanismes réalistes, l'importance de la géométrie au bord du solide est prise en compte. Une double approche numérique-expérimentale est proposée. L'épaisseur du film est calculée numériquement à l'aide d'une méthode d'Eléments Finis et est validée à l'aide de deux bancs d'essais dédiés: Jerotrib et Tribogyr. Une comparaison de l'épaisseur centrale et minimale du film est effectuée pour une arête vive, un chanfrein et un congé pour différentes distances entre le bord du solide et le centre de la zone de contact théorique. L'analyse montre une diminution exponentielle de l'épaisseur minimale du film lorsque le contact s'approche du bord, et notamment lorsque le bord entre dans la zone théorique de contact. L'influence de l'angle du chanfrein et du rayon du congé sur l'épaisseur du film est déterminée.
Informations complémentaires
-
Salle Terreaux-Bellecour, Bâtiment Sophie Germain, Campus LyonTech La Doua - INSA Lyon, 27bis, Avenue Jean Capelle, 69621 VILLEURBANNE CEDEX, FRANCE
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Simone CIPRARI
Rôle de la rhéologie et de la physicochimie de l'interface dans la réponse tribologique et dynamique des systèmes frottants en composites C/C
Doctorant : Simone CIPRARI
Laboratoire INSA : LaMCoS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Énergétique, Génie civil, Acoustique)
Les matériaux composites carbone/carbone (C/C) sont utilisés dans de nombreuses applications de freinage haute performance, telles que le freinage aéronautique, dans lesquelles la légèreté et la résistance thermique représentent des exigences cruciales. En raison de l'intérêt croissant pour cette classe de matériaux, un grand nombre de travaux de recherche ont étudié leur réponse tribologique. Un comportement complexe, caractérisé par l'existence de différents régimes de frottement en fonction des principaux paramètres de contact (température, pression, vitesse de glissement, etc.), a été mis en évidence. Malgré la quantité de travaux consacrés à ce sujet, seuls quelques groupes de recherche ont étudié la relation entre la réponse en frottement des matériaux C/C et l'apparition de vibrations instables induites par le frottement (FIV) du système mécanique, soulignant un rôle fondamental joué par la rhéologie de l'interface sur les comportements de frottement conduisant à l'apparition d'instabilités dynamiques au contact. Dans ce cadre, cette thèse étudie le rôle du troisième corps (c'est-à-dire la couche d'interface formée par les particules d'usure et externes) sur la réponse tribologique et dynamique des systèmes de friction C/C. À cette fin, une nouvelle méthode expérimentale d'évaluation du rôle rhéologique du troisième corps est développée, en adoptant une approche indirecte. La technique de nettoyage par ultrasons est appliquée pour retirer la couche de troisième corps d'un contact C/C, ce qui permet d'effectuer des tests sur les mêmes échantillons en présence et en absence de la couche d'interface. La comparaison entre les comportements mesurés met en évidence un rôle prédominant du troisième corps dans le contrôle de la réponse globale en frottement du système, en particulier dans des conditions de température élevée. La réintroduction dans le contact d'un troisième corps externe est également étudiée, en utilisant les échantillons nettoyés, obtenus après des conditions de freinage réelles et après l'élimination de leur troisième corps naturel, en tant que substrats. La validation de cette procédure ouvre la voie à l'essai d'échantillons de troisième corps introduits artificiellement. Des observations MEB complémentaires ont été effectuées pour caractériser la couche de troisième corps observée sur les surfaces de frottement des matériaux C/C conditionnés pendant la vie en service. Des familles morphologiques du troisième corps en accord avec la littérature existante ont été identifiées, et un accent particulier a été mis sur les contaminants hétérogènes observés dans le troisième corps carboné. Ces observations ont conduit au développement des spécimens artificiels du troisième corps, destinés à reproduire le mieux possible la morphologie du troisième corps naturel, en contrôlant la présence et la morphologie des contaminants hétérogènes. À l'aide de cette méthodologie, le rôle du troisième corps et de ses caractéristiques, telles que la morphologie et la composition chimique, sur la réponse frictionnelle et dynamique du contact C/C a été analysé. L'effet de certains contaminants du troisième corps est étudié, révélant une forte sensibilité de la réponse de frottement C/C sur la nature du contaminant, même en présence d'une faible fraction d'éléments hétérogènes dans la couche de troisième corps. Chaque type de contaminant est caractérisé en termes d'effet sur les valeurs moyennes de frottement et sur la relation coefficient de frottement - vitesse, deux aspects fondamentaux pour évaluer leur impact sur l'apparition de vibrations instables induites par le frottement. Des scénarios rhéologiques sont ensuite proposés pour expliquer la réponse tribologique mesurée, en clarifiant les comportements de frottement qui conduisent à l'apparition d'une réponse dynamique instable du système.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Émilie du Châtelet, 31 Av. Jean Capelle Ouest, Bibliothèque Marie Curie, 69100 Villeurbanne
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Julien FINOT
Contribution à la compréhension du phénomène de bruit fantôme des dentures d'automobiles
Doctorant : Julien FINOT
Laboratoire INSA : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique
Au cours des dernières années, l'industrie automobile a entrepris une transformation majeure de ses groupes motopropulseurs afin de se conformer à des réglementations plus strictes concernant les émissions de CO2. Cela a conduit Stellantis à fabriquer des véhicules électriques qui sont plus silencieux que les véhicules à essence ou Diesel en raison de l'absence de ce type de groupe motopropulseur. La boîte de vitesses existe toujours, et le bruit d'engrènement, également appelé bruit de sirène, devient plus audible à l'intérieur de la voiture. De plus, un autre type de bruit, appelé bruit fantôme, peut apparaître et devenir insupportable pour les utilisateurs du véhicule. La manière dont ce bruit fantôme est créé est encore sujet à discussion, mais il est clairement lié au processus de superfinition des flancs des dents des roues dentées et en particulier au processus de rectification par génération des roues dentées. Comme il s'agit du processus de superfinition le plus rapide pour l'usinage des dents, il est impératif pour l'industrie automobile de maîtriser ce phénomène de bruit. Tout d'abord, une introduction à l'évolution de la fabrication des engrenages chez Citroën et de l'architecture des boîtes de vitesses est faite pour mettre en évidence la transformation constante de cette industrie. Ensuite, une revue de la littérature traitant du phénomène de bruit fantôme est réalisée, abordant plusieurs sujets tels que: - La mesure et l'analyse de la micro-géométrie. - Les causes racines du bruit fantôme. - La détection du bruit fantôme lors de !'engrènement. - La simulation de la rectification par génération des roues dentées... Ensuite, différentes méthodologies sont créées ou améliorées afin d'étudier l'effet des flancs de dents avec des défauts d'ondulations sur l'apparition du bruit fantôme : - Une nouvelle analyse de la micro-géométrie testée en production automobile ; - L'amélioration de la simulation de !'engrènement en prenant en compte des écarts d'ondulations sur les flancs des dents ; - La conception et la validation d'une machine de mesure de l'erreur de transmission sans charge pour corréler les résultats de la simulation
d'engrènement; - Une simulation cinématique de la rectification des dentures par génération avec la possibilité d'ajouter des défauts cinématiques et d'étudier leurs effets sur les flancs des dents usinées. Enfin, une importante campagne de tests réalisée avec un fabricant de machines de rectification de denture est présentée et les résultats sont construits en utilisant les méthodologies développées précédemment. Sur la base des résultats, des lignes directrices pour maîtriser le phénomène de bruit fantôme sont données.
Informations complémentaires
-
Amphi Marc Seguin, Campus Lyonîech La Doua - INSA Lyon 27bis, Avenue Jean Capelle F69621 VILLEURBANNE CEDEX FRANCE
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Baptiste LACROIX
Élément fini solide-poutre pour l'analyse mésoscopique du comportement des renforts textiles à fibres continues
Doctorant : Baptiste LACROIX
Laboratoire INSA : LaMCos - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED n°162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique
Les renforts textiles à fibres continues sont utilisés pour la fabrication de matériaux composites, ce qui implique parfois des étapes de mise en forme. La maîtrise des étapes de celle-ci requiert des simulations à différentes échelles de représentation : macro, méso ou microscopique qui correspondent respectivement à celle du renfort, de la mèche ou de la fibre. L'analyse mésoscopique de la mise en forme de ces renforts permet de mettre en évidence les défauts apparaissant au niveau des mèches : leur flambement, leur écartement et leur désorientation. Leur prédiction est cruciale car ils sont responsables d'une diminution locale des propriétés mécaniques de la structure. Les méthodes permettant des simulations numériques à cette échelle nécessitent parfois des modèles complexes au nombre de degrés de liberté élevé et sont donc coûteux d'un point de vue calculatoire. Pour limiter ces coûts, certaines approches utilisent des modèles fondés sur des hypothèses simplificatrices qui ne permettent pas de capturer l'ensemble des mécanismes à l'œuvre dans la transformation des milieux fibreux. Pour répondre à cette problématique, l'objectif de la thèse est de développer une nouvelle stratégie de modélisation frugale pour l'analyse mésoscopique des renforts à fibres continues. Dans ce travail, nous proposons une approche de solide-poutre pour décrire les mèches. Cette approche repose sur une actualisation de la méthode proposée par Charmetant, basée sur des éléments volumiques et une loi de comportement hyperélastique isotrope transverse. Dans le cas du solide-poutre développé ici, l'élément volumique est enrichi par des poutres fictives utilisant une extension 3D de la méthode dite des éléments voisins et permettant de prendre en compte la raideur en flexion de la mèche. L'approche est implémentée dans un code de calcul interne utilisant la méthode des éléments finis avec un schéma d'intégration temporelle explicite. Des simulations de compaction non confinée, de flexion cantilever et de flambement d'une mèche sont réalisées afin d'observer l'influence de chaque mode de déformation sur la transformation de la mèche. Au travers de simulations numériques sur des mèches, des catégories de comportement de milieux fibreux (associées à des jeux de paramètres matériau) sont mis en évidence ; une classification est proposée en utilisant des ratios de propriétés. La pertinence de cette stratégie est démontrée par des comparaisons entre des simulations numériques et des essais sur des matériaux modèles. Enfin, des simulations de compaction et de pull-out hors plan sont réalisées sur un échantillon de renfort taffetas. Ces exemples numériques démontrent la capacité de notre modèle à capturer des défauts qui apparaissent lors d'opérations de mise en forme.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Clémence Royer, Bâtiment Jacqueline Ferrand, 12 rue des sports, 69621 Villeurbanne Cedex
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Adina-Nicoleta LAZAR
Développement d’outils pour le diagnostic et le traitement des maladies neurodégénératives
Maître de conférences des universités (MCU) : Adina-Nicoleta LAZAR
Laboratoire INSA : LaMCoS
Composition du jury :
Rapporteurs : Elmira Arab-Tehrany, Marc Dhenain, Sophie Lecomte
Jury :
|
Civilité |
Nom et Prénom |
Grade/Qualité |
Établissement |
|
Mme |
ARAB-TEHRANY Elmira |
Rapporteur |
Université de Lorraine |
|
Mme |
LECOMTE Sophie |
Rapporteur |
CBMN, Université de Bordeaux |
|
M. |
DHENAIN Marc |
Rapporteur |
MIRCen, Université Paris-Saclay |
|
Mme |
BERNOUD-HUBAC Nathalie |
Examinateur |
INSA Lyon |
|
Mme |
MANITI Ofelia |
Examinateur |
Université Lyon 1 |
|
M. |
DELATOUR Benoît |
Examinateur |
ICM, Sorbonne Université, Paris |
Informations complémentaires
-
INSA Lyon - Bat. IMBL - Salle Mc Whinnie - Villeurbanne
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Audrey MICHON
Développement d'un modèle éléments finis thermomécanique macroscopique pour l'estimation de l'impact du meulage sur les contraintes résiduelles dans les assemblages soudés.
Doctorante : Audrey MICHON
Laboratoire : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED 162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique
Le meulage, une opération d'enlèvement de matière utilisée dans diverses industries, en particulier dans le secteur nucléaire (EDF), est principalement appliqué aux composants soudés. Ce procédé, impliquant un outil de meulage composé de liants et de particules abrasives, fait partie des procédés de parachèvement pour améliorer la qualité des pièces soudées. Cependant, la nature manuelle du meulage introduit une variabilité en raison de facteurs tels que le type d'outil, le savoir-faire de l'opérateur, les matériaux utilisés et les paramètres opératoires de meulage. De plus, le meulage influence les contraintes résiduelles près de la surface traitée et, suivant la nature des matériaux, peuvent favoriser les mécanismes de fissuration par Corrosions Sous Contraintes (CSC). Cette thèse examine comment le meulage modifie l'état des contraintes résiduelles, façonné par l'historique thermomécanique du composant. Le meulage peut introduire de nouvelles contraintes résiduelles. Pour comprendre l'impact des paramètres de meulage sur ces contraintes, nous proposons une chaîne numérique complète, validée par des essais sur un banc de meulage semi-automatique développé par Framatome. L'objectif est d'évaluer l'interaction complexe entre les paramètres opératoires (procédé) du meulage et l'état des contraintes résiduelles dans les composants soudés. Le défi dans la modélisation du meulage provient des nombreux phénomènes physiques en jeu, allant de l'enlèvement de matière aux interactions thermomécaniques au cours du contact outil-pièce. Pour s'aligner sur les exigences d'EDF, une approche macroscopique a été adoptée, adaptée pour analyser les effets du meulage à l'échelle du composant. Notre recherche a conduit au développement d'un modèle tridimensionnel de meulage utilisant Code_Aster, le code open source d'éléments finis développé par EDF. Le procédé de meulage est simulé comme une charge thermomécanique équivalente, pré-calculée en utilisant un code de contact semi-analytique interne ISAAC développé au LaMCoS. Ces simulations couvrent plusieurs étapes successives d'enlèvement de matière. Pour valider notre modèle, nous avons effectué des essais sur une maquette soudée pour anticiper l'impact du meulage sur les contraintes résiduelles des soudures. Les résultats obtenus permettent non seulement de montrer l'effet du meulage sur les soudures, en termes de contraintes résiduelles, mais aussi de montrer la capacité du modèle à reproduire les tendances observées expérimentalement.
Informations complémentaires
-
Salle 406-00-39 - Mary Alice McWHINNIE (IMBL), 13 Av. Jean Capelle 0, 69100 Villeurbanne
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Pau BECERRA ZUNIGA
Multi-stabilité et rupture de symétrie dans un système vibro-impact non linéaire avec jeu annulaire : analyse expérimentale et numérique des bifurcations
Doctorant : Pau BECERRA ZUNIGA
Laboratoire : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED 162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique
Dans les générateurs de vapeur, les vibrations induites par l'écoulement génèrent des impacts qui peuvent provoquer l'usure des tubes intérieurs au fil du temps. Afin de mieux comprendre la réponse non linéaire de ces structures, une maquette représentant un tronçon de tube de générateur de vapeur a été conçue, consistant en un tube droit bi-encastré vibrant en flexion avec une butée annulaire à jeu avec un dispositif pour contrôler l'excentrement tube-butée. Parallèlement, un modèle d'ordre réduit a été construit afin de prédire la réponse la maquette et un algorithme de continuation basé sur la méthode d'équilibrage harmonique (HBM} a été utilisé pour calculer ses réponses stationnaires multistables. Cet algorithme ainsi qu'une technique de suivi des bifurcations ont été implémentés dans Cast3M (code de calcul du CEA}. Les résultats expérimentaux ont montré la coexistence de différents régimes pour le même ensemble de paramètres, ce qui a été correctement prédit par le modèle. Ensuite, les résultats expérimentaux et numériques ont été confrontés pour différentes symétries de tube-butée et malgré le modèle d'ordre réduit, les deux correspondaient remarquablement. Ces comparaisons ont été effectuées pour différentes configurations de symétrie tube-butée et l'analyse de bifurcation s'est avérée particulièrement précise pour prévoir l'apparition de régimes multi-stables. En outre, le suivi des bifurcations a été utilisé pour analyser l'influence d'un modèle de frottement glissant régularisé. Enfin, l'influence du nombre de modes retenus dans le modèle d'ordre réduit a également été examinée. Ces résultats démontrent la coexistence de plusieurs réponses dynamiques dans une maquette assez simple, tout en mettant en évidence la robustesse et les points faibles des outils numériques développés au cours de ce travail.
Informations complémentaires
-
Centre CEA D306, Porte Est, 91190 Saclay

