
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Kexin YAN
Simulation numérique de la croissance d'anévrisme de l'aorte ascendante pour l'aide à la décision chirurgicale
Doctorante : Kexin YAN
Laboratoire INSA : LaMCoS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Énergétique, Génie civil, Acoustique)
Prévoir l'évolution de la croissance des anévrismes de l'aorte ascendante (AscAA) représente un défi majeur en raison de l'interaction complexe entre la géométrie aortique, le comportement des tissus et la dynamique des flux sanguins. Cette étude explore un modèle de Fluide-Structure Croissance (FSG), basé sur la théorie Homogenized constrained mixture model (HCMM), pour simuler de manière réaliste la croissance des AscAA. Le modèle par éléments finis est initialisé avec une zone de dégradation de l'élastine, définie par la distribution des contraintes de cisaillement pariétales moyennes (TAWSS) dérivées des simulations de dynamique des fluides computationnelle. Dans un premier temps, nous menons une étude paramétrique pour évaluer l'influence de paramètres d'entrée spécifiques-tels que la direction du jet d'entrée, qui détermine les zones de TAWSS élevé, et la prédéformation initiale, qui impacte l'état homéostatique des tissus-ainsi que des paramètres matériaux sur les résultats de simulation de croissance. Ensuite, nous calibrons ces paramètres pour reproduire la croissance observée dans cinq cas patients, dont un cas disposant de données longitudinales. Nous parvenons à reproduire cette croissance longitudinale en tenant compte des mises à jour du TAWSS et de la rigidité du support élastique. Nos résultats montrent que l'approche FSG proposée, combinée à un ajustement des paramètres sensibles, permet de reproduire avec succès les schémas de croissance observés cliniquement, en validant à la fois le diamètre de l'anévrisme et la distribution des déplacements par comparaison à l'imagerie CT de suivi. Ce travail montre un potentiel prometteur pour une application à d'autres cas patients, contribuant ainsi aux efforts visant à développer un outil prédictif pour soutenir la prise de décision clinique.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Émilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Apou Martial KPEMOU
Hydruration secondaire et fragilisation d'une gaine M5(Framatome) après sollicitation de type APRP
Doctorant : Apou Martial KPEMOU
Laboratoire INSA : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique
L'hydruration secondaire, qui fait référence à une prise massive d'hydrogène par la gaine combustible due à l'oxydation à haute température de la surface interne de la gaine, peut survenir pendant un transitoire APRP (Accident de Perte de Réfrigérant Primaire), en cas d'éclatement de gaine permettant à la vapeur de pénétrer à l'intérieur. Ce phénomène peut ensuite induire une fragilisation de la gaine combustible et conduire à une rupture lors de la phase de renoyage. Plusieurs instituts de recherche internationaux réalisent des essais dits semi-intégraux afin de caractériser le comportement des gaines combustibles en APRP. Ces essais combinent plusieurs phénomènes interconnectés, rendant complexe une étude fine et à effets séparés du phénomène d'hydruration secondaire. Ces travaux de thèse ont pour objectif d'améliorer la compréhension du phénomène d'hydruration secondaire par le biais d'essais analytiques dédiés et couplés à des simulations physico-chimiques et mécaniques. Un protocole expérimental a été mis en place, pour simuler le phénomène d'hydruration secondaire en conditions APRP, afin de caractériser l'effet de divers paramètres. Les résultats expérimentaux obtenus indiquent que la quantité d'hydrogène absorbée par la gaine augmente à la fois avec la température d'oxydation (1100-1200°C) et la durée d'oxydation (100-1400s). Une tendance similaire a été observée en étudiant l'influence de différentes tailles de gap (80, 130 et 230 µm) et de différents diamètres d'ouverture (02 et 04 mm). Différentes méthodes de mesure de l'hydrogène ont été utilisées pour caractériser la distribution de l'hydrogène au sein du matériau après oxydation :la mesure par fusion dégazage, l'imagerie par neutrons et la µ-LIBS. Des techniques d'analyses locales (EPMA et µ-LIBS) ont également été employées afin de déterminer la distribution locale de l'oxygène et de l'hydrogène. Les essais à effets séparés ont été modélisés à l'aide du logiciel SHOWBIZ de l'ASNR. Les simulations réalisées ont permis de mettre en évidence les mécanismes de transport des gaz à l'intérieur de la gaine, ainsi que l'influence de différents paramètres. La tendance des résultats de simulations est en bon accord avec les résultats expérimentaux. Enfin, les effets de fragilisation combinés des réactions d'oxydation et d'hydruration de la gaine ont été étudiés par le biais d'essais de flexion 4 points et par une modélisation mécanique de la rupture.
Informations complémentaires
-
La Fénière, Château de Cadarache - Maison d'hôtes du CEA Cadarache Route de Vinon sur Verdon 13115 Saint Paul Lez Durance
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Gergely MOLNAR
The role of length scales in material failure
[Soutenance publique]
Chargé de recherche CNRS : Gergely MOLNAR
Laboratoire INSA : LaMCoS
Rapporteurs :
- Samuel Forest (MINES Paristech,
- David Rodney (UCBL),
- Jean-François Molinari (EPFL)
Jury
| Civilité | Nom et Prénom | Grade/Qualité |
Établissement |
|
M. |
FOREST Samuel |
Directeur de Recherche |
MINES Paristech |
|
M. |
RODNEY David |
Professeur des universités |
Université Claude Bernard Lyon 1 |
|
M. |
MOLINARI Jean-François |
Full professor |
EPFL |
|
Mme. |
DE LORENZIS Laura |
Full professor |
ETH Zürich |
|
M. |
MOËS Nicolas |
Professeur des universités |
UCLouvain |
|
M. |
GRAVOUIL Anthony |
Professeur des universités |
INSA Lyon |
Informations complémentaires
-
INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie - Villeurbanne
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Maryne FEBVRE
Intelligence artificielle pour optimiser le contrôle distribué des vibrations : Application aux réseaux de transducteurs dans les structures intelligentes.
Doctorante : Maryne FEBVRE
Laboratoire INSA : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Énergétique, Génie civil, Acoustique)
Les matériaux intelligents, comme les transducteurs piézoélectriques, sont devenus essentiels en ingénierie moderne pour des applications telles que le contrôle des vibrations, la récupération d'énergie et la propagation des ondes. Ces éléments multiphysiques permettent de développer des structures intelligentes adaptatives, capables d'interagir avec leur environnement, et de résoudre des problématiques liées à l'instabilité et à la fatigue des matériaux. Cependant, l'optimisation de ces systèmes devient de plus en plus complexe à mesure que le nombre de transducteurs et de paramètres ajustables augmente. Cette thèse explore l'optimisation du contrôle des vibrations dans les structures intelligentes à l'aide de l'apprentissage par renforcement profond (DRL pour Deep Reinforcement Learning). Plusieurs lois de contrôle actif ou passif sont appliquées aux transducteurs piézoélectriques. Le réglage de ces lois par DRL est comparé à des méthodes d'optimisation traditionnelles telles que le simplex et les algorithmes génétiques. L'efficacité est évaluée en termes d'atténuation des vibrations, de stabilité structurelle et de performance de calcul. Des analyses modales, à la fois numériques et expérimentales, sont effectuées pour valider la faisabilité du contrôle sur diverses structures, allant de modèles unidimensionnels basés sur des éléments finis à des réseaux complexes de transducteurs. Les résultats mettent en évidence l'efficacité du DRL pour ajuster des lois de contrôle en boucle fermée multi paramètres tout en tenant compte de fonction d'optimisation non linéaires incluant des contraintes de stabilité. Cependant, des défis tels que l'aléa dans l'entraînement et la divergence sont surmontés grâce à des stratégies basées sur la mémoire, renforçant la robustesse et l'adaptabilité aux variations environnementales. Ce travail fait progresser les méthodes basées sur l'intelligence artificielle pour le contrôle des structures intelligentes distribuées, établissant un lien entre les domaines de l'intelligence artificielle et des matériaux adaptatifs.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Clémence Royer, Bâtiment Jacqueline Ferrand, INSA Lyon, 31 Av. Jean Capelle 0, 69100 Villeurbanne
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep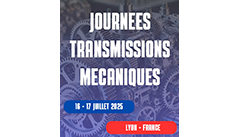
Recherche
Journées Transmissions Mécaniques 2025
Colloque national dédié aux industriels et universitaires sur la thématique des transmissions mécaniques (engrenages, cannelures, ...) dans le domaine du numérique et de l'expérimental.
Le pôle universitaire de Lyon joue un rôle majeur dans la recherche française sur les transmissions mécaniques. Il regroupe plusieurs laboratoires de renom : le LabECAM (ECAM LaSalle, campus de Lyon), le LTDS UMR5513 (Centrale Lyon) et le LaMCoS UMR5259 (INSA Lyon). Ces équipes bénéficient de structures collaboratives dédiées à la recherche appliquée et au transfert de technologies.
armi celles-ci : La chaire SAFRAN-INSA en partenariat avec l’ECAM LaSalle, axée sur les transmissions innovantes pour l’aéronautique. Les laboratoires communs tels que CETIM-INSA-ECAM Transméca et VIBRATEC-ECL Ladage. Le consortium CIRTrans, réunissant 8 industriels et les laboratoires du pôle. Le soutien de l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon.
Les dernières Journées Transmissions Mécaniques de 2023, organisées les 10 et 11 juillet à l’INSA Lyon, ont rassemblé plus de 110 participants issus des milieux industriels et académiques. Cet événement a été marqué par 25 présentations scientifiques et techniques, offrant un cadre propice aux échanges constructifs et enrichissants.
En 2025, les Journées Transmissions Mécaniques se dérouleront les 16 et 17 juillet sur le campus de Lyon de l’ECAM LaSalle. Elles poursuivent leur mission de rassembler la communauté scientifique et industrielle pour échanger sur les défis et les avancées des transmissions mécaniques. Ce format, destiné à un public francophone, favorise des discussions approfondies et des interactions conviviales, caractéristiques des éditions précédentes.
Ces journées sont organisées par le LaMCoS et le LabECAM, en partenariat avec le LTDS, le consortium CIRTrans et SAFRAN. L’objectif principal est de faire le point sur les dernières avancées scientifiques, les innovations techniques et les problématiques industrielles dans ce domaine.
Informations complémentaires
- jean-pierre.devaujany@insa-lyon.fr
- https://jtm2025.sciencesconf.org/
-
ECAM LaSalle à Lyon
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Elias RECHRECHE
Analyses expérimentales et numériques du comportement des accouplements à ressort en conditions quasi-statiques et dynamiques
Doctorant : Elias RECHRECHE
Laboratoire INSA : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures
École doctorale : ED162 MEGA de Lyon (Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique)
Les travaux de thèse ont été effectués grâce à un financement CIFRE dans le cadre d'une collaboration entre l'entreprise CMDgears et le Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (LaMCoS UMR CNRS 5259) de l'INSA de Lyon. Les accouplements à ressorts sont des éléments de transmission connus pour leur flexibilité torsionnelle et leur capacité à compenser les déflexions thermiques et les désalignements entre les arbres. Ils sont utilisés comme solutions polyvalentes pour relier les arbres dans les transmissions à fortes charges, du fait de leur capacité à atténuer les vibrations potentiellement nuisibles. Cependant, malgré cet intérêt reconnu, la littérature sur le sujet reste peu abondante. L'objectif principal de ces travaux est de permette une analyse fine du comportement statique et dynamique de ce composant. Pour cela, un modèle tridimensionnel complet d'accouplements à ressorts a été développé intégrants d'éventuels écarts entre moyeux. Cet outil de simulation permettra l'amélioration des caractéristiques dynamiques de ces accouplements par rapport aux exigences de plus en plus sévères des machines industrielles. Ces accouplements se composent d'un ressort en contact avec les dents des moyeux, qui possèdent un bombé longitudinal, permettant ainsi de relier les arbres d'entrée et de sortie, même en cas de désalignement. Un boîtier englobant le ressort et les moyeux est présent autour de l'accouplement permettant d'encapsuler le lubrifiant tout en maintenant le ressort dans les directions radiale et axiale. En conséquence, une stratégie de modélisation hybride, combinant des éléments finis et des éléments à paramètres concentrés, est proposée pour prendre simultanément en compte les échelles globale (arbres/moyeux/boîtiers) et locale (contacts). Dans ce cadre, le ressort est représenté par une série de segments, modélisés à l'aide d'éléments de poutre de Timoshenko. Parallèlement, les moyeux sont traités comme des solides rigides, mobiles dans l'espace. Les interactions de contact entre les dents des moyeux et le ressort sont, quant à elles, modélisées à l'aide de fondations élastiques de Winkler.
Enfin, le boîtier est modélisé par des éléments de raideur en translation introduits entre la base de chaque boucle du ressort et un point de fixe du moyeu. À chaque pas de temps, les problèmes de contact et l'intégration des équations du mouvement du système complet sont traités simultanément afin de tenir compte des interactions possibles entre les échelles locales et globales. Un ensemble de résultats de simulation sont présentés, mettant en évidence le comportement des accouplements à ressorts dans des conditions de fonctionnement réalistes. Il est démontré que ces accouplements présentent un comportement torsionnel raidissant, causé par le déplacement sous charge des zones de contact entre le ressort et les moyeux. Dans le cas de moyeux désalignés reliés par plusieurs ressorts, la raideur torsionnelle de l'accouplement varie avec la position angulaire, générant ainsi des excitations paramétriques qui contribuent à la dynamique du système. En présence d'une excitation extérieure dont la fréquence varie, la réponse dynamique présente des sauts d'amplitudes, caractéristique d'un système non-linéaire. Parallèlement, un banc d'essai expérimental a été spécialement conçu pour permettre des comparaisons avec le comportement simulé. Ce dispositif a notamment mis en évidence l'importance du jeu axial entre le ressort et le boîtier. L'analyse des résultats montre la capacité du modèle à simuler de manière satisfaisante les réponses temporelles et fréquentielles de l'accouplement.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Marc Seguin, 27 avenue Jean Capelle 69100 Villeurbanne
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Aurore GOIGOUX
Experimental and theoretical analyses of the Rolling Contact Fatigue for indented surfaces
Doctorante : Aurore GOIGOUX
Laboratoire INSA : LAMCOS
École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique)
L’électrification des véhicules induit une modification des conditions opératoires des roulements présents dans les réducteurs. Cette application est caractérisée par une lubrification polluée.
Afin de développer des nouveaux matériaux efficacement, il est nécessaire de comprendre le mécanisme d’endommagement et d’en déduire les paramètres influents, ceci dans des conditions opératoires représentatives. Dans cet objectif, cette étude expérimentale et théorique est menée sur des roulements en 100Cr6 martensitique indentés par des particules dures. Le mécanisme d’endommagement est étudié basé sur deux approches : une caractérisation quantitative des indents et de leur endommagement et une caractérisation multi-échelle de la microstructure. Il est montré que les opérations de finition génèrent une fine couche plastiquement affectée à la surface qui n’évolue plus, ni après indentation, ni après fatigue, excepté sous l’épaulement de l’indent. Ainsi, l’épaulement est clé dans l’initiation de l’endommagement. D’abord, il se déforme et/ou s’use progressivement au cours de l’essai, son aspect de surface change et la zone rodée augmente. L’épaulement amont a un aspect de surface différent de celui aval, ce qui pourrait indiquer une déformation plastique plus avancée, expliquant la position préférentielle de la fissuration. Cette déformation engendre une plasticité avancée sous l’épaulement. Avec l’accumulation des cycles, une fissure s’y initie, certainement sur un défaut, comme l’interface carbure primaire/matrice. La propagation de la fissure n’est pas immédiate et consiste en deux processus distincts caractérisés par deux faciès de rupture différents. La fissure se propage d’abord dans une zone à la microstructure très fine, suggérant une propagation lente. La fissure modifie additionnellement la microstructure au-dessus d’elle, certainement par déformation et cisaillement entre les lèvres. La probabilité de fissuration est corrélée au temps d’essai, à la pression et au volume du creux de l’indent, mais pas à sa pente. L’influence du volume du creux pourrait s’expliquer par un volume d’épaulement plus important.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Adrien DIDIER
« Mobiliser le chargement ultrasonique pour caractériser la fatigue de contact roulant : une étude de l'amorçage »
Doctorant : Adrien DIDIER
Laboratoire INSA : LAMCOS
École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique)
Les phénomènes d'endommagements causés par la fatigue de contact roulant sur une surface indentée sont reconnus comme responsables de la majorité des dysfonctionnements de roulements aéronautiques. Ces mécanismes d'endommagements sont encore mal compris en raison d'un manque crucial de données expérimentales. En effet, ces phénomènes ne se manifestent qu'après de nombreuses années, voire plusieurs décennies de fonctionnement, ce qui rend toute analyse expérimentale conventionnelle particulièrement laborieuse et chronophage. De plus, la simulation numérique de ce type d'endommagements est actuellement impossible, tant en raison du manque de données expérimentales disponibles que du nombre extrêmement élevé de cycles à simuler.
Afin de rendre accessible l'étude des sollicitations gigacyclique, nous avons conçu un dispositif de fatigue ultrasonique capable de reproduire un trajet de chargement analogue à celui d'un roulement sur une surface indentée, avec un chargement localement multiaxial et non proportionnel. Ce parallèle entre les deux trajets de chargement a été établi grâce à des simulations numériques par éléments finis. Ainsi, le dispositif expérimental permet de simuler l'équivalent de plusieurs décennies d'utilisation, soit plusieurs milliards de cycles, en seulement quelques dizaines d'heures. Cette étude a ainsi permis d'établir de nombreux liens entre la fatigue de contact roulant et la fatigue ultrasonique.
Elle a notamment permis d'expliquer le phénomène de transition des sites d'amorçage de fissures, qui se déplacent de la surface vers la profondeur du matériau, dans le cadre de la fatigue à très grand nombre de cycles. De plus, une analyse approfondie du raffinement local de la microstructure a été réalisée, mettant en évidence un lien direct avec l'amorçage en fatigue gigacyclique. Ce phénomène de raffinement a pu être expliqué et attribué à la même cause sous-jacente dans le cas de la fatigue des roulements et de la fatigue ultrasonique : le glissement dévié des dislocations (cross- slip).
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Seguin, INSA-Lyon (Villeurbanne)
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Victor PINARDON
Étude et modélisation des roulements à rouleaux coniques montés dans une roue d’aéronef
Doctorant : Victor PINARDON
Laboratoire INSA : LaMCoS
École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique)
Les roulements à rouleaux coniques présents dans les roues d’aéronefs sont fortement sollicités lors des phases où l’avion est en contact avec le sol. Leur dimensionnement et intégration dans la roue requièrent donc une attention particulière. Cette thèse explore notamment les risques liés à la rotation de la bague externe d’un roulement à rouleaux coniques dans son logement lorsqu'il est soumis à un chargement thermique provenant du frein. En effet, ces roulements sont montés avec un ajustement serré dans le logement. De plus, lors de cas de chargements mécaniques sévères tel qu’un virage de l’avion sur la piste, les efforts internes du roulement peuvent générer un couple de frottement élevé. Ainsi, sous un chargement thermique spécifique et en raison des coefficients de dilatation thermique différents entre la bague et le logement, une perte de serrage peut se produire et entraîner une rotation relative entre la bague externe et le moyeu de la roue dans lequel le roulement est monté. Ce phénomène de glissement dégrade les performances du roulement et peut conduire à de l’endommagement. Une approche semi-analytique est appliquée à un roulement à bagues rigides pour déterminer les efforts de contact entre les rouleaux et les pistes. Ces efforts sont des données nécessaires pour évaluer le couple de fonctionnement du roulement. Le couple est estimé avec des modèles empiriques proposés dans la littérature et basés sur la théorie EHL. Un modèle thermomécanique transitoire est ensuite utilisé pour étudier l'évolution du couple de serrage entre la bague et le moyeu. Enfin, le code de calcul de roulement à bagues rigides est modifié pour intégrer les déformations de la bague externe afin d’évaluer l’impact de ces déformations sur le couple de frottement du roulement. Ces modèles sont appliqués sur deux roues appartenant à des avions différents.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Émilie du Châtelet (BMC), INSA-Lyon (Villeurbanne)
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Büşra DURAN
Influence of gear transmission oils degradation on tribological performance and gearbox efficiency
Doctorante : Büşra DURAN
Laboratoire INSA : LaMCos
École doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon
Les lubrifiants jouent un rôle clé dans la réduction du frottement, mais peuvent se dégrader au cours de leur utilisation, ce qui peut compromettre la fiabilité et l'efficacité des équipements. Définir une stratégie de lubrification optimale nécessite donc une compréhension approfondie des impacts potentiels de la dégradation des huiles.
Pour étudier ce phénomène, plusieurs lots d'huiles de transmission par engrenage ont été analysés et testés afin d'évaluer les changements entre les échantillons neufs et les échantillons prélevés en application. Dans un premier temps, certaines propriétés rhéologiques et chimiques des huiles ont été mesurées et analysées, telles que la viscosité, la composition chimique, l'acidité, la teneur en eau et la contamination en particules solides. Ensuite, les performances tribologiques des huiles ont été évaluées à l'aide de deux tribomètres distincts, complétés par des méthodes optiques de caractérisation des éprouvettes d’essais. Enfin, des essais sur un banc d’essai de transmission ont été effectués sous différentes conditions de fonctionnement pour étudier l'évolution de la dissipation de puissance et du comportement thermique du banc d'essai. De plus, un modèle numérique basé sur un couplage thermique a été utilisé pour exploiter davantage les données expérimentales.
Les résultats de cette étude démontrent une influence claire du fonctionnement des transmissions à engrenages sur les propriétés et la performance des lubrifiants. Les propriétés intrinsèques ont tendance à évoluer avec la dégradation donc les performances tribologiques sont également affectées. Dans le banc d'essai de transmission, la dégradation entraîne une évolution de la puissance dissipée, qui affecte à son tour le comportement thermique. Ces observations semblent également fortement dépendantes des conditions de fonctionnement en application.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Clémence Royer (bâtiment Jacqueline Ferrand) - (Villeurbanne)

