
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Victor PINARDON
Étude et modélisation des roulements à rouleaux coniques montés dans une roue d’aéronef
Doctorant : Victor PINARDON
Laboratoire INSA : LaMCoS
École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique)
Les roulements à rouleaux coniques présents dans les roues d’aéronefs sont fortement sollicités lors des phases où l’avion est en contact avec le sol. Leur dimensionnement et intégration dans la roue requièrent donc une attention particulière. Cette thèse explore notamment les risques liés à la rotation de la bague externe d’un roulement à rouleaux coniques dans son logement lorsqu'il est soumis à un chargement thermique provenant du frein. En effet, ces roulements sont montés avec un ajustement serré dans le logement. De plus, lors de cas de chargements mécaniques sévères tel qu’un virage de l’avion sur la piste, les efforts internes du roulement peuvent générer un couple de frottement élevé. Ainsi, sous un chargement thermique spécifique et en raison des coefficients de dilatation thermique différents entre la bague et le logement, une perte de serrage peut se produire et entraîner une rotation relative entre la bague externe et le moyeu de la roue dans lequel le roulement est monté. Ce phénomène de glissement dégrade les performances du roulement et peut conduire à de l’endommagement. Une approche semi-analytique est appliquée à un roulement à bagues rigides pour déterminer les efforts de contact entre les rouleaux et les pistes. Ces efforts sont des données nécessaires pour évaluer le couple de fonctionnement du roulement. Le couple est estimé avec des modèles empiriques proposés dans la littérature et basés sur la théorie EHL. Un modèle thermomécanique transitoire est ensuite utilisé pour étudier l'évolution du couple de serrage entre la bague et le moyeu. Enfin, le code de calcul de roulement à bagues rigides est modifié pour intégrer les déformations de la bague externe afin d’évaluer l’impact de ces déformations sur le couple de frottement du roulement. Ces modèles sont appliqués sur deux roues appartenant à des avions différents.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Émilie du Châtelet (BMC), INSA-Lyon (Villeurbanne)
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Maxence DECOTE
Numerical modelling of an EHL contact undergoing multiples overrollings
Doctorant : Maxence DECOTE
Laboratoire INSA : LaMCos
École doctorale : ED162 MEGA de Lyon (Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique)
Les roulements à biles sont des éléments cruciaux au sein d’une boite de vitesse d’un hélicoptère pour lequel ils lui permettent de voler. En effet, une défaillance au niveau de ces éléments peut entraîner une fin dramatique de l’hélicoptère comme un crash. Ce travail a pour but de mieux comprendre comment un un roulement à billes fonctionne dans des conditions de défaillance de lubrification. Afin de réaliser cela, ce travail ne va pas considérer un roulement entier (trop compliqué). À la place, il va se focaliser sur un contact entre un élément roulant et une bande de roulement. Ce travail constitue une première étape dans la compréhension du fonctionnement d’un roulement à billes en présence d’une panne de lubrification. L’extrapolation des résultats obtenus sur un contact à tout le roulement serait la prochaine étape. Des travaux présentent deux différents comportements, la présence de grippage ou un fonctionnement stable. Un modèle numérique permettant la prise en compte de la sous-alimentation dans un contact ElastoHydroDynamique (EHD) (et Thermo-ElastoHydrodynamique (TEHD)) a été développé dans le but de reproduire ces travaux expérimentaux. La sous-alimentation est introduite par le biais d’une méthode innovante faisant appel au maillage mobile. Ce modèle numérique a été confronté à une référence provenant de la littérature, avec succès. Par la suite, il a été comparé à des résultats expérimentaux en condition de perte de lubrifiant. Des situations stables où le contact fonctionne durant de nombreuses heures sans ajout de lubrifiant ont été obtenues.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Marc Seguin, INSA-Lyon (Villeurbanne)
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Vie de campus
AG de recrutement du CLES-FACIL
Si toi aussi tu as la tête dans les étoiles en cours, alors rejoins-nous ! Viens découvrir les projets du CLES - FACIL en partenariat avec le CNES !
Tu es passionné d'aéronautique, de spatial ou d'astronomie ? Ou tout simplement fan de bricolage et de projets ambitieux ?
Rendez-vous à l'AG de rentrée le mardi 8/10 à 18h15 en amphi Seguin.
Au programme : présentation des projets de l'année : fusées, expériences, planeurs RC et plein d'autres surprises ;) suivi d'une visite du local et des projets des années précédentes.
Informations complémentaires
- cles-facil@asso-insa-lyon.fr
- https://cles-facil.org/
-
Amphithéatre SEGUIN
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Sarah JIBODH-JIAOUAN
Etude du confort vibratoire et acoustique en cabine d’avion sous l’influence de la rotation des moteurs ou des phénomènes de turbulences
Doctorante : Sarah JIBODH-JIAOUAN
Laboratoire INSA : LVA
Ecole doctorale : ED162 : Mécanique Energétique Génie civil Acoustique
Airbus répond à la demande croissante des passagers d'avions commerciaux en quête d'un vol confortable, avec moins de bruit et de vibrations. Cependant, les normes actuelles ne correspondent pas toujours aux sensations ressenties par le personnel navigant. De plus, il n'existe actuellement aucun modèle d'inconfort intégrant à la fois les stimuli sonores et vibratoires pour une application dans l’aviation. Dans cette thèse, des tests perceptifs ont été menés pour mieux comprendre et modéliser la perception de l'inconfort causé par différentes sources, à travers deux axes de recherche distincts. Le premier axe s'est concentré sur les vibrations et le bruit générés par la rotation des turboréacteurs synchronisés et désynchronisés. Les résultats ont montré que les participants sont sensibles à la fréquence de rotation des moteurs synchronisés, ainsi qu'à son amplitude. En revanche, pour les moteurs désynchronisés, les variations d'amplitude de modulation ou de fréquence de modulation n'ont pas semblé affecter la sensibilité des participants. La sonie est apparue comme un paramètre pertinent pour évaluer l'inconfort acoustique, bien limitée. En ce qui concerne l'inconfort vibratoire, la norme ISO 2631-1 a été jugée adéquate pour estimer l'inconfort dans le cas des moteurs synchronisés, mais elle ne tient pas compte des phénomènes de modulation. Les participants ressentent les vibrations dans leur ensemble, sans qu'une zone spécifique du corps soit particulièrement touchée. Un modèle linéaire a été développé pour estimer l'inconfort global, intégrant à la fois l'inconfort acoustique et vibratoire, mais uniquement pour les moteurs synchronisés. Pour les moteurs désynchronisés, seul l'inconfort vibratoire était pertinent. Le deuxième axe s'est penché sur la perception subjective et physiologique de l'inconfort vibratoire causé par des turbulences. Les résultats ont montré que l'ISO 2631-1 permettait d'estimer de manière adéquate l'inconfort vibratoire dans ces situations. De plus, des mesures physiologiques, pourraient être utilisées pour soutenir les évaluations subjectives.
Informations complémentaires
-
Airbus (M67-0-W016 Event Gavarnie) (Toulouse)
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Maxime MEUTERLOS
Développement de méthodes de fusion, modélisation et classification des indicateurs vibratoires de surveillance des ensembles mécaniques basées sur les paramètres d’utilisation. Application à l’hélicoptère
Doctorant : Maxime MEUTERLOS
Laboratoire INSA : LVA
Ecole doctorale : ED162 MEGA
Les systèmes VHMS (Vibration Health Monitoring System) installés sur les hélicoptères ont un rôle stratégique pour augmenter la sécurité en vol des opérateurs et passagers. Ces systèmes consistent à enregistrer des données opérationnelles en vol, en particulier de nature vibratoire, et à surveiller l’intégrité des ensembles mécaniques par le biais d’indicateurs issus du traitement des signaux. Le principe de base se fonde sur le postulat que l’apparition d’un mode de défaillance engendre une évolution caractéristique des valeurs des indicateurs. Une limite rencontrée par les systèmes VHMS est cependant liée à la forte dépendance des indicateurs aux conditions de vol qui, pour les hélicoptères, sont susceptibles de varier rapidement et de manière complexe. Ces variations, aujourd’hui difficilement maîtrisées, peuvent masquer la signature d’une défaillance mécanique. Il en résulte donc une ambigüité sur l’interprétation de l’origine d’évolution observée des indicateurs. \\ \\
Dans ce manuscrit, des méthodes de normalisation sont développées permettant d’estimer des indicateurs vibratoires normalisés, c'est-à-dire insensibles aux conditions de vol. Dans un premier temps, une revue des méthodes de normalisation couramment utilisées dans la littérature est présentée. Dans un deuxième temps, un cadre statistique paramétrique modélisant les indicateurs vibratoires est proposé et repose sur des modélisations cyclostationnaires du signal vibratoire. Ce cadre paramétrique sera utilisé pour construire deux approches de normalisation des indicateurs vibratoires. La première basée sur le clustering-classification permettant de lier les phases de vol de l’hélicoptère à la statistique de l’indicateur vibratoire. Puis, une deuxième basée sur la régression de paramètres de distributions de quantile conditionnées sur les paramètres de vol expliquant la variabilité des indicateurs de santé. En parallèle, une étude de sensibilité permettant d’identifier ses paramètres de vol est menée.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Louis DASSONVILLE
Approche décentralisée de la machine synchrone à bobinage ouvert et de sa commande
Doctorant : Louis DASSONVILLE
Laboratoire INSA : Ampère
Ecole doctorale : ED160 : Electronique, Electrotechnique, Automatique
L’objectif de ce travail est de concevoir un groupe motopropulseur (GMP) résilient aux défauts. Les applications visées sont la mobilité électrique, l’aéronautique et les autres applications qui requièrent un haut niveau de fiabilité. Le travail présenté a pour but d’explorer la résilience des machines synchrones à aimants permanents (MSAPs) à bobinage ouvert, qu’elles soient triphasées ou multiphases. L’approche proposée cherche à rendre chaque enroulement de la machine indépendant. Cette indépendance concerne non seulement la machine elle-même, mais aussi l’électronique et la commande, afin de garantir un haut niveau de résilience, quel que soit l’origine du défaut. Des simulations ainsi que des essais expérimentaux permettent de valider cette approche. Cette nouvelle approche décentralisée du groupe motopropulseur ouvre beaucoup de nouvelles perspectives de recherche, que ce soit dans le domaine des machines électriques, de l’électronique ou de la commande. Cette thèse CIFRE menée en collaboration entre le laboratoire Ampère et l’entreprise Keep’Motion offre l’opportunité de développer un GMP industrialisable d’une très haute fiabilité.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre AE1, Bâtiment Gustave Ferrié, INSA Lyon (Villeurbanne)
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Augustin PIGE
Introduction des corps de roue flexibles dans la modélisation dynamique des engrenages coniques
Doctorant : Augustin PIGE
Laboratoire INSA : LaMCoS
Ecole doctorale : ED162 MEGA
Les moteurs d’hélicoptère contiennent des transmissions de puissance, qui servent à mettre en mouvement divers équipements (pompes à huile et à carburant, génératrice…) ou à transférer la puissance de la turbine vers la boîte de transmission principale. Ces applications se caractérisent par de hautes vitesses de rotations et des exigences contradictoires : assurer une grande fiabilité avec des pièces les plus légères possibles. Des simulations dynamiques précises peuvent donc s’avérer utiles aux concepteurs. Pour des raisons d’intégration, il est parfois indispensable de transmettre un mouvement entre des axes concourants, ce qui est généralement réalisé au moyen d’engrenages coniques. Ces derniers ont été bien moins étudiés que leurs équivalents cylindriques, en particulier en ce qui concerne les corps de roue allégés et flexibles. Ce travail se focalise sur la modélisation d’engrenages coniques prenant en compte la flexibilité des corps de roue. Le modèle proposé combine des sous-structures condensées, des éléments d’arbres de Timoshenko et des corps rigides avec une modélisation originale de l’engrènement. L’élasticité de l’engrènement est non-linéaire et varie au cours du temps. Elle est calculée simultanément à la résolution des équations du mouvement. Le modèle a été confronté à des résultats expérimentaux en quasi-statique et à très haute vitesse. Ensuite, une étude quasi-statique a mis en évidence l’effet de la flexibilité des corps de roue et des efforts centrifuges sur deux engrenages très différents. Enfin, une seconde étude dynamique a été menée pour relever les particularités du comportement des engrenages coniques allégés et les mettre en perspective par rapport aux travaux sur les engrenages cylindriques. Elle a aussi permis de souligner les points à vérifier lors d’une éventuelle campagne expérimentale et de proposer une implantation pour l’instrumentation.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Ouest, Bâtiment des Humanités - Villeurbanne
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Hugo FOURNIER
Aeroelastic Reduced-Order Modeling and Active Control of Flexible Aircraft
Doctorant : Hugo FOURNIER
Laboratoire INSA : Ampère
Ecole doctorale : ED160 : Electronique, Electrotechnique, Automatique
Cette thèse porte sur la modélisation aéroélastique d'un avion, et à son contrôle actif. En utilisant les surfaces de contrôle de l'avion de manière appropriée, il est possible de réduire les charges dues aux rafales de vents et à la turbulence. Cela permet de réduire la masse des structures responsables de maintenir l'intégrité de l'avion, et donc d'améliorer les performances du design global. L’utilisation d’un lidar, un senseur permettant de mesurer la vitesse du vent plusieurs dizaines de mètres à l’avant de l’avion, est envisagée pour améliorer les capacités de réduction de charges. De plus, les futurs avions devraient avoir des ailes plus allongées et flexibles, ce qui réduit la traînée mais crée des effets aéroélastique néfastes. Le flottement est une instabilité pouvant amener à une destruction de l'aile, à haute vitesse. Il peut être annulé ou au moins déplacé en dehors de l'enveloppe de vol grâce au contrôle actif des surfaces de contrôle. Ces deux techniques ont été développées dans la thèse au moyen de diverses techniques de design de contrôleurs, principalement basées sur la synthèse robuste H-infini et ses variantes. Des techniques dédiées pour modéliser la dynamique aéroélastique de l’avion ont été développées. Pour obtenir des modèles d’états d’ordres réduits, avec des contraintes sur les pôles. Pour ce faire, une méthodologie basée directement sur la réponse fréquentielle aéroélastique de l’avion est employée, par opposition aux techniques classiques basées sur des équations mêlant l'aérodynamique et la dynamique structurelle, qui amènent en général à des modèles d’ordre importants, inutilisables par les techniques modernes de synthèse de contrôleurs.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Recherche
Journée Initiative 3D à Grenoble INP
Après deux années de pause, en raison de la situation sanitaire, les partenaires d’Initiative 3D vous donnent rendez-vous le 22 septembre prochain à Grenoble INP pour la 6e Journée Initiative 3D, entièrement dédiée à la fabrication additive métallique.
Seront abordées les dernières avancées en R&D sur les nouveautés technologiques (moyens d’élaborations et conception) en fabrication additive, ainsi que les développements récents des matériaux. Ces sujets seront illustrés par des projets collaboratifs avec des industriels des secteurs de l’aéronautique, de l’énergie. Un focus sera également réalisé sur les offres de formations (initiale et continue) aussi bien techniciens, qu’ingénieurs.
La journée se concluera par le lancement du partenariat « France/Salon Formnext 2022 » dans lequel la France sera le pays mis à l’honneur sur la prochaine édition de ce salon mondial dédié à la fabrication additive Formnext – International exhibition and conference on the next generation of manufacturing technologies
Informations complémentaires
- f.simon@cimes-hub.com
- www.cimes-hub.com
-
Grenoble INP
Mots clés
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Recherche
« En réduisant leur taille, nous réduisons aussi les risques qui pèsent sur les infrastructures sensibles »
 Comment les mécaniciens peuvent-ils prédire le comportement d’un moteur d’avion en vol lorsqu’un oiseau s’y engouffre malencontreusement ? Pendant très longtemps, les physiciens décomposaient les mouvements complexes en phénomènes simples pour pouvoir les comprendre. Désormais, la complexité d’un mécanisme s’étudie grâce à la simulation numérique.
Comment les mécaniciens peuvent-ils prédire le comportement d’un moteur d’avion en vol lorsqu’un oiseau s’y engouffre malencontreusement ? Pendant très longtemps, les physiciens décomposaient les mouvements complexes en phénomènes simples pour pouvoir les comprendre. Désormais, la complexité d’un mécanisme s’étudie grâce à la simulation numérique.
Anthony Gravouil, enseignant-chercheur, a été récemment récompensé par le prix ONERA1 de l’Académie des Sciences pour ses travaux de modélisation des impacts extrêmes dans l’aéronautique et l’aérospatial, il détaille ses activités scientifiques menées au sein du LaMCos2 .
Quels sont ces phénomènes extrêmes que vous étudiez ?
J’étudie la science du mouvement et les phénomènes complexes qui y sont associés. Mon rôle est de décortiquer cette complexité afin de pouvoir la prédire grâce à des nouveaux procédés numériques qui permettent de mieux prendre en compte des échelles de temps très fines dans la modélisation d’impacts (endommagement, fissuration dynamique) et de leurs conséquences physiques sur les structures. Les enjeux auxquels notre recherche s’intéresse sont plus largement ceux de l’énergie et du transport car on comprend facilement qu’il est primordial de concevoir des éléments de sûreté les plus robustes et les plus fiables possibles, dès lors qu’ils entrent - par exemple - dans la composition d’une centrale nucléaire ou celle d’un moteur d’avion. Nous travaillons donc à prédire ce qui va se passer dès lors que ces éléments critiques subissent une sollicitation extrême, comme lorsqu’un oiseau s’engouffre malencontreusement dans un moteur d’avion en vol, ou qu’un atterrissage brutal vient altérer certains composants d’un appareil. Dans le cas de l’industrie énergétique, nous étudions également les dommages que peuvent subir des éléments de sûreté contenus dans des centrales nucléaires en cas de séisme ou d’impact lourd. Finalement, nous travaillons à comprendre tout ce qui se passe dans ces éléments de sûreté quand on se situe « au-delà » de leur bon fonctionnement.
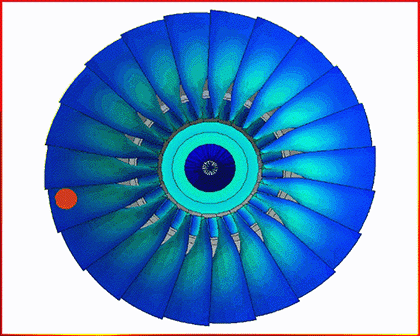
Modélisation d'un impact d'oiseau sur moteur d'avion
Vous anticipez donc ce qu’il advient d’un équipement lorsqu’il sort de sa « zone de confort » ?
C’est tout à fait ça ! Pour être complet, nous nous intéressons aussi à ce que nous appelons les impacts « basse énergie ». S’ils sont plus courants, ils n’en sont pas moins importants et intéressants à modéliser. Par exemple, au cours d’une phase de contrôle ou de maintenance d’un système, il peut arriver qu’un outil tombe des mains d’un opérateur et endommage un élément de structure. Si en surface l’impact peut sembler insignifiant et invisible, il peut générer des dégradations dans les sous-couches du matériau et, plus tard, pourra s’avérer critique pendant que l’appareil est en fonctionnement.
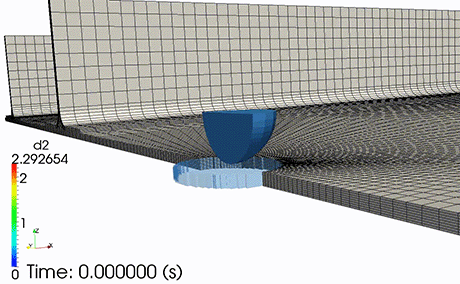
Impact basse énergie sur un panneau composite (thèse Chantrait 2014, collaboration LaMCoS/ONERA)
Vos travaux nécessitent donc d’entrer « au cœur des matériaux » et des équipements d’une certaine façon. Comment est-il possible d’accéder à un tel degré de précision ?
Les sciences pour l'ingénieur vivent depuis une quarantaine d’années, une véritable révolution avec l’avènement du numérique et des ordinateurs dotés d’une puissance de calcul extraordinaire. Au laboratoire, nos liens sont donc forts avec la science des données, la simulation, l’algorithmie, l’informatique et les mathématiques appliquées. Nous sommes désormais capables, à partir des grands principes de la physique, de décrire des phénomènes d’une grande complexité dans des modèles virtuels physiquement fondés. On peut donc aujourd’hui mener des expériences réelles sur les matériaux et conjointement faire la simulation en faisant fonctionner des avatars virtuels. Dans le cadre de nos recherches sur la modélisation des phénomènes extrêmes, on utilise donc la modélisation numérique, virtuelle, pour décrire le plus précisément possible « le réel » et ce qu’il advient concrètement lorsque des éléments de sûreté sont dégradés.
Vos travaux sont également très importants pour limiter les risques subis par les éléments de sûreté des centrales nucléaires. D’ailleurs, les dérèglements climatiques peuvent accroître les risques d’impacts extrêmes pour ces équipements. Que préconisez-vous pour limiter ces risques ?
Je pense que pour s’adapter à ces dérèglements, les équipements devront d’abord réduire leurs dimensions. En effet, pendant très longtemps nous avons développé d’importants systèmes énergétiques comme les grosses centrales nucléaires en France, dont la vocation était de pouvoir centraliser la production et la distribution d’énergie. Aujourd’hui nous nous tournons plutôt vers des « smart systems », des infrastructures intelligentes de production plus petites et mieux adaptées aux besoins locaux. Selon moi, nous n’avons plus besoin de fabriquer de gigantesques équipements, comme de grandes centrales énergétiques, ou de très gros avions dans le domaine aéronautique pour qu’ils soient efficaces. Finalement, en réduisant leur taille, nous réduisons aussi les risques qui pèsent sur les infrastructures sensibles : les phénomènes extrêmes sont ainsi mieux anticipés, et nous pouvons mieux surveiller les éléments de sûreté qui les composent.
Vous êtes également enseignant au département génie mécanique. Comment préparez-vous les futurs ingénieurs mécaniciens à aborder la question environnementale dans la discipline ?
Dans un domaine très spécifique tel que la mécanique, nous nous efforçons de transmettre à nos étudiants l’idée que les enjeux sociétaux, climatiques et écologiques les concernent directement. Les mécaniciens de demain sont ceux qui devront réfléchir à la consommation d’énergie qu’un système requiert pour être fabriqué, pour fonctionner et pour être recyclé. Nous souhaitons leur faire prendre conscience que c’est toute la chaîne de valeur d’un produit ou d’un équipement que l’on se doit de considérer. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d’action des mécaniciens dans l’adaptation au changement climatique.
1 Centre Français de Recherche Aérospatiale
2 Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS)

