
INSA Lyon
La Préfète de Région et le Recteur de la région académique reçus à l’INSA Lyon
Jeudi 23 mai 2024, Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône ainsi que Gabriele Fioni, Recteur, délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Auvergne Rhône-Alpes, Nathalie Mezureux, Déléguée Régionale Académique à la Recherche et à l’Innovation, et Virginie Bazin, Cheffe de mission Emploi, formation, jeunesse, et fonds européens - Pilote Worldskills Lyon 2024 ont été accueillis sur le site de la Doua par Frédéric Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon entouré de Jean-Michel Jolion, coordinateur du Collège d’ingénierie, Marie-Christine Baietto, Directrice de la recherche et de la valorisation, Catherine Verdu, Directrice de la vie étudiante, Alexis Metenier, Directeur du développement, Nicolas Gaillard, Directeur général des services et Pascale Gibert, Directrice de l’Institut Gaston Berger.
Cette première visite de madame la préfète a été l’occasion de présenter les différentes activités de l’école, ses grands enjeux actuels et chantiers à venir, mais également de découvrir le campus.
Ainsi, à travers une déambulation sur le site de la Doua, madame la préfète a pu visiter plusieurs lieux emblématiques du campus : l’amphithéâtre Jean Capelle rénové, les bâtiments Louis Néel et les résidences A et B qui ont pu être rénovés grâce au plan France Relance de l’État ainsi que Creatis, premier laboratoire ouvert en 1957 qui figure parmi les leaders français de l’imagerie médicale.
Dans le cadre des chantiers à venir, la délégation a pu voir le bâtiment des Humanités qui devrait être rénové et découvrir le nouveau bâtiment Suzanne Mériaux, inauguré en juin 2023 et financé dans le cadre du CPER, véritable Centre de compétences et de ressources mutualisées dans la caractérisation, le traitement et la valorisation des déchets et les solutions de dépollution, géré par INSAVALOR, la filiale de valorisation de l’INSA Lyon.

Cette délégation a pu prendre la mesure du « campus-ville-démonstrateur » avec une vie de campus foisonnante. L’activité d’hébergement de l’INSA Lyon recoupe 3100 lits dans 11 résidences. L’INSA Lyon, c'est également une restauration internalisée avec près de 800 000 repas servis chaque année sur deux sites principaux et sept salles de restauration pour plus de 6 000 étudiants. Un axe vert ouvert pour les villeurbannaises et villeurbannais. L’école mène une stratégie importante pour valoriser les espaces végétalisés, réduire les îlots de chaleur urbain à travers un ambitieux programme de plantations, veille à préserver la biodiversité, développer les modes de transport doux et améliorer le cadre de vie sur le campus.
Cette visite s’est terminée avec la présentation du bâtiment de la I-Factory, futur lieu totem de la créativité, de l’entrepreneuriat et de l’innovation de l’Université de Lyon, et un déjeuner afin d’échanger autour des grands sujets comme le collège d’ingénierie ou la politique internationale de l'établissement.


Entreprises
« Les chaufferies collectives sont des lieux sombres mais leurs données peuvent éclairer la facture d’énergie des copropriétés »
Quelques petites actions peuvent permettre d’économiser beaucoup : c’est avec ce principe que Paul Chaussivert, s’est lancé dans le pari de réduire les consommations énergétiques des copropriétés. Avec son entreprise, Captain’ Conso, le diplômé du département génie énergétique et génie de l'environnement de l’INSA Lyon, a fait de sa préoccupation pour la performance énergétique et le bâti, son terrain de jeu. Entretien avec l’ingénieur qui invite les gestionnaires d’immeubles à entamer leur transition énergétique en visitant leurs propres chaufferies collectives.
Un cursus au département GEN, un passage par la Filière Étudiant Entreprendre (FÉE) et un engagement associatif au Proto INSA Club1 lors de vos années étudiantes à l’INSA Lyon… Avez-vous toujours eu cette fibre entrepreneuriale et un intérêt pour la performance énergétique ?
L’intérêt pour la question énergétique est très certainement présent depuis longtemps ! Ma toute première expérience professionnelle chez un exploitant de chauffage m’a fait réaliser l’importance de la performance énergétique. Mon travail consistait à maintenir des chaufferies de résidences, d’écoles ou de bâtiments d’entreprises. En plus de ce rôle, je développais des actions pour améliorer la performance de celles-ci. Ce premier emploi m’a permis de me confronter à la réalité du secteur : en sortant de l’école, j’imaginais un monde automatisé où les machines étaient optimisées. En trois ans, je me suis aperçu que ça n’était pas le cas, et qu’il y avait des choses à faire sur le plan de la performance énergétique. Par exemple au sein des copropriétés, il n’y a pas une grande connaissance technique du système de chauffage ni des consommations. Les copropriétaires ont souvent l’impression qu'une personne est mandatée pour suivre pour eux. En réalité, peu de personnes suivent de près cette question énergétique : ce n’est pas le rôle du syndic et c’est rarement inscrit dans les contrats de maintenance des chauffagistes… Pour résumer, il manquait un tiers de confiance entre la chaufferie et la facture : c’est pour cela que j’ai créé Captain’ Conso. L'objectif est d’effectuer une exploration approfondie des chaufferies, d'extraire et d'analyser des données précieuses de ces espaces souvent méconnus, puis de les communiquer efficacement aux copropriétaires. Et mon expérience au sein de la FÉE m’a certainement beaucoup aidé pour oser me lancer dans l’aventure entrepreneuriale !
Aujourd’hui, vous jouez ce rôle de tiers avec votre entreprise « Captain’Conso » qui est basée sur un modèle économique gagnant-gagnant. Comment fonctionne-t-il ?
On entend beaucoup que pour faire des économies d’énergie, il faut rénover tout son parc en priorité. Cependant, avec quelques petites actions comme l’optimisation des réglages, on peut mesurer une économie qui peut aller de 15% à 20%. Le pari avec Captain’ Conso est de se rémunérer sur les économies réelles. Effectivement, le modèle est basé sur un échange gagnant-gagnant : à l’issue d’une première visite de la chaufferie, je suis en capacité de définir les petites actions à mettre en place pour réduire les consommations. Si le pari est réussi et que la copropriété économise sur sa facture finale, alors nous partageons la moitié de ce montant sur 3 ans. Le client bénéficie de l’expérience d’un ingénieur et d’une réduction de sa facture. De plus, cela augmente le confort des occupants, car nous garantissons une température stable et homogène sur tout le bâtiment. Ce qui est aussi très intéressant dans la démarche, c’est que nous devenons un vecteur de compréhension pour le client autour de la transition énergétique. Même si l’argument principal est économique, les clients restent très intéressés par l’impact positif de leur décision. Il y a un vrai enjeu d’information car vulgariser ce monde de l’énergie, très technique, ça n’est pas toujours très simple. Aujourd’hui, je suis ingénieur mais aussi chef d’entreprise, commercial et plus encore pédagogue sur les enjeux de l’énergie. C’est assez valorisant et motivant car il y a un double effet à mon activité professionnelle. Certains clients vont même plus loin que l’objectif d’économie de 15% à 20% : grâce à la dynamique engagée, j’accompagne désormais l’un de mes clients vers l’étude de la rénovation totale de son parc.

Comment envisagez-vous la suite avec votre entreprise Captain’ Conso ?
L’année 2023 a été pour moi l’occasion du lancement d’une nouvelle entreprise, qui vient compléter l’activité de Captain’Conso pour aller plus loin dans l’optimisation énergétique et environnementale des bâtiments. C’est une histoire insalienne puisque je mène ce projet avec un ami de promotion, Badr Bouslikhin, diplômé du département génie électrique. L’idée est née d’une discussion où je lui partageais des problématiques rencontrées lors de mes interventions. En concevant nos propres objets connectés destinés à optimiser les chaufferies, nous faisons se rencontrer nos expertises respectives : la thermique et l’électronique. Nous commençons tout juste à poser nos premiers équipements avec notre entreprise Thermigo. Je suis très heureux de ce nouveau projet car nous allons aller plus loin dans l’accès à la transition énergétique des copropriétés et cette activité sera complémentaire à celle menée avec Captain’Conso. Pour la suite, les choses viendront d’elles-mêmes, en fonction de ce que nous trouverons sur le terrain. Il y a encore beaucoup à faire !
[1] Le Proto INSA Club (PIC) est une association étudiante qui conçoit et réalise intégralement des véhicules à faible consommation.

Vie de campus
5 nouveaux bâtiments éco-rénovés sur le campus de l’INSA Lyon
Le 6 octobre 2023, Olivier Dugrip, Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Recteur de l'académie de Lyon et Chancelier des universités, Gabriele Fioni, Recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, et Olivier Roussat, Directeur Général du Groupe Bouygues et diplômé de l'INSA Lyon 87, étaient réunis autour de Frédéric Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon pour inaugurer 5 bâtiments rénovés sur le campus de Lyon.
Débutés entre avril et juin 2022, les travaux se sont échelonnés jusqu’à l’été 2023 sur site occupé. L’objectif du projet ? Concevoir et réaliser les travaux de rénovation thermique et énergétique de cinq bâtiments du campus de l’INSA : Camille Claudel, Louis Néel, Saint-Exupéry et les résidences A et B.
Ces travaux, dont le financement à hauteur de 15,5 millions d’euros a été apporté par l’État dans le cadre de l’appel à projets, France relance, s'inscrivent dans la transition énergétique, environnementale et écologique du projet stratégique Ambitions 2030 de l’INSA Lyon.
394 panneaux photovoltaïques, une toiture végétalisée, le réemploi d'éléments de façade, un taux important de matières biosourcées dans les matériaux, des fournisseurs locaux et PME locales sous-traitantes … Le campus de l’INSA Lyon continue de s'affirmer comme un éco-campus démonstrateur à l’échelle 1 des expérimentations de nos laboratoires et des processus industriels innovants de nos partenaires.
Ces travaux ont été réalisés par un groupement d’experts conduit par Bouygues Bâtiment Sud-Est associé à l’agence d’architecte Supermixx représenté par l’architecte David Vial ainsi qu’EODD et Quadriplus.
Il devait répondre à un double enjeu :
- reconstituer une enveloppe performante avec des matériaux pérennes et issus d’une démarche bas carbone afin de répondre aux enjeux environnementaux actuels ;
- préserver et respecter l’écriture architecturale et patrimoniale existante du site, imaginé et réalisé par l’architecte lyonnais Jacques Perrin-Fayolle en 1957, en réinterprétant de manière plus contemporaine cette œuvre originale.

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Teddy GRESSE
Développement et validation d’une modélisation thermo- aéraulique tridimensionnelle et dynamique du bâtiment pour l’étude des environnements thermiques intérieurs complexes
Doctorant : Teddy GRESSE
Laboratoire INSA : CETHIL
Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon
Avec le changement climatique en cours et la hausse globale des températures, l’enjeu du confort thermique, notamment l’été et en ville, devient une question centrale pour la conception et la rénovation des bâtiments. Afin d’étudier le confort thermique dans des environnements thermiques intérieures complexes, mettant en jeu des phénomènes radiatifs et convectifs dynamiques et locaux, il est nécessaire de disposer d’outils de simulation thermique du bâtiment adaptés. Ce travail de thèse propose le développement et la validation d’une modélisation thermo-aéraulique du bâtiment basée sur la BES (Building Energy Simulation) tridimensionnelle, la CFD (Computational Fluid Dynamics) par la méthode de Boltzmann sur réseau (LBM) et la simulation des grandes échelles (LES), et finalement le couplage de ces deux approches. Tout d’abord, le modèle de BES développé a été validé suivant une confrontation avec des mesures en conditions réelles réalisées dans une pièce solaire passive. Les résultats montrent des résidus et des erreurs moyennes faibles sur les températures d’air et de surface intérieures. L’application du modèle de BES à l’étude d’un matériau à changement de phase montre notamment que le stockage d’énergie latente s’effectue principalement dans les parties de mur ensoleillées, ce que ne peuvent pas prédire les codes de calcul couramment utilisés. Ensuite, la modélisation LBM-LES a été confrontée à un vaste ensemble de données expérimentales d’une pièce ventilée mécaniquement mettant en jeu des jets turbulents, axisymétriques et anisothermes de paroi. Les résultats montrent un bon accord entre les prédictions et les mesures concernant les profils moyens et la turbulence des jets étudiés. Enfin, le couplage BES-CFD a été mis en place et confronté aux données expérimentales d’une pièce équipée d’un radiateur. L’analyse porte sur le transfert de chaleur aux parois et les caractéristiques du panache thermique et montre que le couplage employé conduit à des résultats fiables.
Informations complémentaires
-
Amphithéâtre Eugène Freyssinet (Bât. Eugène Freyssinet) - Villeurbanne
Derniers évènements
UNITECH - Assemblée générale 2025
Du 31 aoû au 05 sep
Entreprises
« Le changement climatique ne doit pas être une bataille d’idées politiques »
Vincent Bryant, diplômé de l’INSA Lyon en 2006, a co-fondé « Deepki ». Décrite comme une « pépite de la green-tech », elle veille à accompagner les acteurs du bâtiment dans leur transition énergétique. Déjà engagé sur la question climatique pendant ses années d’études, l’ingénieur informatique n’a jamais renoncé à son goût « de l’impact ». Que ce soit en co-fondant l’association « Avenir Climatique » avec Jean-Marc Jancovici ou en lançant une entreprise capable de lever 150 millions d’euros pour poursuivre son développement, Vincent voit loin et large. Entretien avec un ingénieur qui nourrit de grandes ambitions sur la transition environnementale.
Votre entreprise vient de lever 150 millions d’euros pour poursuivre son expansion à l'international. Comment accompagne-t-elle le secteur immobilier ?
L’immobilier génère 37 % des émissions globales de CO2 dans le monde. Aujourd’hui, les grands acteurs détenteurs de foncier connaissent le potentiel de la data pour accélérer la transition énergétique de leurs bâtiments, mais seuls, ils ne peuvent pas y parvenir. Pour aller vers un objectif « net zéro », les acteurs du secteur ont besoin d’être accompagnés dans leur prise de décision : faut-il isoler, rénover, reconstruire, vendre... À travers une plateforme logicielle, nous analysons les données de leurs bâtiments, nous les aidons à construire des plans d’actions et à mesurer les impacts. Nous sommes dans une démarche d’économie « à impact positif » ; notre mission est de préserver la planète en rendant l’immobilier moins lourd en matière de consommation énergétique, grâce à la data.
Deepki fait partie de cette frange, croissante, d’entreprises innovantes qui conjuguent écologie et numérique. Pensez-vous que les technologies soient réellement capables de sauver la planète ?
Toutes seules, non. Est-ce qu’elles peuvent aider ? Oui. « Science sans conscience, n’est que ruine de l’âme », a écrit Rabelais. Je suis dans cet état d’esprit. Par exemple, Deepki est résolument une entreprise « high-tech », mais elle est aussi promotrice de la low-tech. Les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Si l’on prend l’exemple de la transition énergétique, il y a de nombreuses façons de réduire les impacts qui ne nécessitent pas de technologies mais seulement un peu d’imagination. Je me souviens d’un client qui avait eu l’idée, pour inciter les utilisateurs à prendre les escaliers, de disséminer la réponses à des devinettes le long des marches. Alors évidemment, l’appât ne fonctionne que deux ou trois fois avec le même usager qui cherche à obtenir les réponses, mais c’est une façon d’encourager les bonnes pratiques sans l’ombre d’une technologie. Il y a de plus en plus de réflexions de ce genre qui émergent dans ce sens et c’est une bonne chose. Je ne crois pas que la technologie soit une réponse universelle pour agir sur les changements climatiques, mais si elle est mise en regard des besoins et du contexte, elle peut nous aider.
Vous êtes diplômé du département informatique. Comment votre parcours vous a-t-il amené de l’informatique à la transition énergétique de l’immobilier ?
J’ai des parents qui étaient déjà un peu écolos et conscients du problème. Lorsque j’étais étudiant à l’INSA, j’ai découvert les travaux de Jean-Marc Jancovici et je me suis pris de passion pour le sujet de la transition énergétique. À cette époque, j’avais même négocié avec la direction de la formation de l’INSA pour suivre les cours de génie énergétique et environnement en parallèle de mes cours de IF. Depuis mes études, j’avais cette idée d’utiliser l’informatique pour avoir un impact sur l’énergie et le climat. Quant à l’immobilier, je l’ai découvert lors de mes différentes expériences professionnelles, chez Engie notamment. Je travaillais sur tous types d’actifs, notamment sur ceux qui avaient des empreintes carbone lourdes. C’est le besoin d’avoir un impact qui m’a guidé à vouloir « massifier » cet effort de transition pour le secteur immobilier.
Étudiant, vous étiez déjà très engagé dans la cause environnementale. D’abord à l’INSA Lyon, en tant que membre du bureau de l’association « Objectif 21 », puis plus tard, lorsque vous fondez « Avenir Climatique » et contribuez au lancement du REFEDD1. L’associatif est-il une façon d’agir pour le climat ?
À l’époque de mes années étudiantes, j’y crois. Je suis persuadé que l’associatif est capable de former les gens, apporter du changement et de l’exemplarité. Je me souviens qu’avec Objectif 21, nous avions lancé un « concours innovation climat ». L’une des solutions proposées était de réduire la consommation de viande avec des repas végétariens pour les restaurants de l’école. L’idée, qui avait séduit le jury, a pu être mise en place dans les années suivantes et subsiste encore aujourd’hui ! Avec « Avenir Climatique », il s’agissait d’introduire les notions climatiques dans les enseignements pour que les diplômés sortent de l’école avec les bons ordres de grandeurs en tête. En grandissant, j’ai compris les limites de l’associatif : j’ai souvent été gêné par le mélange des genres, avec les idées politiques. Le changement climatique est un projet factuel et scientifique. Ça ne doit pas être une bataille d’idées. J’ai aussi fait de la politique, un peu tous les partis sauf les extrêmes. Et là aussi, c’était très décevant en matière d’action.
Quels conseils donneriez-vous aux élèves-ingénieurs qui auraient envie de s’orienter vers un « métier à impact » ?
Je m’en remettrais au précieux conseil de Jean-Marc Jancovici : formez-vous ! Suivez vos cours, réfléchissez et faites les choses comme vous le sentez. C’est à vous de choisir la barque dans laquelle vous souhaitez monter. J’aime bien l’image de Nicolas Hulot, avec le syndrome du Titanic. Il y a ceux qui restent dans les estafettes et qui pointent du doigt l’iceberg en criant « attention »; et puis il y a ceux qui décident de monter dans le bateau pour aller convaincre que l’iceberg représente un réel danger. Est-ce que vous êtes prêt à faire partie du système ou préférez-vous rester en dehors de celui-ci ? C’est une question fondamentale d’approche, d’ordre philosophique. Il n’y a pas de bonne réponse, chacun doit pouvoir aller là où il veut pour agir.
[1] : Réseau Français Étudiant pour le Développement Durable, aujourd’hui RESES (Réseaux Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire)

Formation
La difficile équation du matériau de construction durable
Pour construire durablement, faut-il privilégier la pierre, la paille ou la brique comme les trois petits cochons ? Là où « produit de construction écologique » ne rime pas toujours avec « durabilité économique », la transition des matériaux du génie civil se heurte à plusieurs défis. Pour Élodie Prud'homme, enseignante-chercheure au département génie civil et urbanisme et responsable du module « matériaux innovants pour la construction durable » à l’INSA Lyon, il faut commencer par faire connaître et reconnaître les procédés de construction plus durables par les (futurs) professionnels du secteur.
Construction et le développement durable : laisse béton !
Au procès écologique du bâtiment, l’industrie cimentière est habituée à être sur le banc des accusés. En effet, elle représenterait près de 2,9 % des émissions carbone en France. Si le tout-béton a connu son apogée dans les années d’après-guerre, le procédé lourd et énergivore imposé par la fabrication du ciment est désormais pointé du doigt face à la conjoncture environnementale. « De la fabrication du ciment, nécessitant l’extraction de calcaire et d’argile et une transformation gourmande en énergie fossile, en passant par l'utilisation de granulats qui sont des ressources non-renouvelables à l'échelle humaine, le béton est certainement le plus mauvais élève des matériaux. C'est un exemple très parlant pour illustrer l'impact des matériaux dans le cycle de vie des bâtiments. Dans une construction classique, les parties bétonnées entraînent environ 40 % des émissions de CO2 au niveau de l'étape de construction. L’impact carbone est déjà très élevé dès les premières fondations de la construction », explique Élodie Prud'homme.
Parmi les matériaux nouveaux ou redécouverts par les procédés d’écoconstruction : des matières naturelles. Mais si la réponse durable ne doit pas se cantonner à l’utilisation de quelques matériaux biosourcés comme le bois ou la terre, il faut garder à l’esprit que chaque ressource, une fois extraite de son milieu naturel engendre un impact. « La réponse n’est pas automatique. Une réflexion globale est nécessaire », ajoute l’enseignante.
 Explorer de nouveaux matériaux : oui, mais pas seulement.
Explorer de nouveaux matériaux : oui, mais pas seulement.
Le premier petit cochon construisit sa maison avec de la paille trouvée dans un champ. Le deuxième trouva du bois dans la forêt et le troisième prit plus de temps pour construire sa maison, car elle était en briques. Ce sur quoi la comptine ne s’attarde pas, c’est la façon dont les trois personnages ont choisi leur matière. Qu’ont-ils préféré ? Des ressources visiblement à portée de main, mais qui n’ont pas toutes résistées au souffle du loup. Voilà peut-être l’un des principaux défis auquel fait face l’écoconstruction du 21e siècle : concilier impact carbone et performance. « Prenons l’exemple de la laine de chanvre dont la production a un faible impact en émission de GES par rapport un isolant de type polystyrène. Si à épaisseur égale, ses performances isolantes ne sont pas aussi satisfaisantes que le polystyrène, est-ce toujours un choix écologique ? En effet, une performance moindre pourra entrainer des consommations énergétiques plus importantes, qui ne seront pas forcément compensées par l'utilisation de l'écomatériau. Il est donc fondamental d'avoir une vision globale de l'impact environnemental du bâtiment pour faire des choix. L’impact écologique d’un bâtiment ne s’arrête pas à la construction, mais se poursuit pendant toute sa durée de vie, à travers son utilisation, et jusqu’à sa fin de vie, sa démolition et la gestion des déchets », souligne l’enseignante.
 Ouvrir les perspectives des futurs ingénieurs
Ouvrir les perspectives des futurs ingénieurs
Au sein du département génie civil et urbanisme de l’INSA Lyon, Élodie Prud'homme initie ses élèves de 4e année à d’autres regards sur les matériaux de construction à travers un module, intitulé « matériaux innovants pour la construction durable ». Selon elle, la fonction d’ingénieur a un rôle décisif, capable d’accélérer la transition du secteur. « En amont ou sur le chantier, l’ingénieur est souvent amené à faire des choix, bien qu’il doive faire face aux habitudes du secteur qui se résument souvent à trouver l’équilibre entre performance énergétique, coût financier bas, et temps de livraison rapide. Ce qui freine le développement des éco-matériaux aujourd’hui, c’est une certaine méconnaissance de ces solutions alternatives et le manque de cadre règlementaire pour certains matériaux, tels que la terre crue, qui peut encore faire peur, tant aux maîtres d’œuvre, qu’aux investisseurs et assureurs ! ». À travers un programme de découverte, les élèves-ingénieurs suivant le module optionnel déconstruisent leurs préjugés sur les méthodes alternatives. « Les étudiants doivent développer un matériau à base de terre et/ou de fibres végétales répondant à certaines caractéristiques comme être porteur ou isolant. L’expérimentation est indispensable pour découvrir que les ressources biosourcées ont des propriétés inexplorées. Je suis persuadée que c’est en essaimant les petites graines auprès des futures générations d’ingénieurs que le secteur peut évoluer, d’ailleurs, de plus en plus de bureaux d’études émergent sur ces questions de matériaux durables. Cela est très encourageant pour l’évolution d’un génie civil plus durable », conclut Élodie.
Copyright © amàco
Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 2 - 29 avril 2021

Vie de campus
Requiem pour un peigne
La légendaire excroissance du bâtiment Louis Neel a tristement entamé sa chute depuis le 24 juin dernier. On l’appelait « le peigne » ou « les travées », en référence à ses quatre longs couloirs qui desservaient salles de classes et salles de travaux pratiques.
Érigé en 1957, le peigne a été l’un des premiers édifices du campus : il fallait « faire vite » pour construire en sept mois des bâtiments en dur où seraient « instruits, logés, nourris les élèves de la première année de l’Institut1. » Avec des menuiseries et façades métalliques coiffées d’ouvrants à projection à l’italienne, Jacques-Perrin Fayolle l’avait pensé plein de promesses pour les jeunes étudiants. Simple dans la structure, l’architecte n’en avait exclu ni la modernité ni l’élégance de son époque.
Dans les travées ont déambulé les tous premiers étudiants de l’INSA Lyon. Chacune présentait un volume identique : 74,50 mètres de long, 9,90 mètres de large et 3 mètres de hauteur sous plafond, et accueillaient le « groupe des laboratoires » comme il pouvait parfois être appelé. Les plus anciens élèves se rappelleront peut-être de « la pêche aux cations » sur les paillasses en carrelage blanc, vêtus de leur blouse blanche. Symbole de la première année de formation insalienne, le peigne trônait à l’ouest de l’espace vert central du « QG des propé2 », du « PC3» ou du « FIMI4 ». Puis est arrivé un nouveau directeur5 avec l'intention de faire souffler un vent nouveau sur l’école, en ouvrant la pédagogie à de nouvelles formes : désormais, les blocs de béton carrelés des laboratoires de chimie laisseraient place aux classiques salles de classes.
Chaque insalien aura vécu entre les murs du peigne des moments mémorables : des heures de travaux pratiques de physique, de cours de langues et d’humanités… Et souvent, le souvenir a plusieurs saveurs : lorsque derrière les ossatures métalliques des façades se pointaient les rayons matinaux du soleil, l’âge de la bâtisse se faisait sentir. L’isolation bien incertaine ne ravissait ni en été, ni en hiver, doublée de l’atmosphère presque médicale indiquée par la couleur des murs surannée. Et dans le même temps, les jeunes étudiants fraîchement tombés des nids familiaux trouvaient dans ces longs couloirs bleus, un endroit de repère et de réconfort à croiser chaque jour les visages de leurs nouveaux amis.
Si aujourd’hui les murs du peigne s’agenouillent sous les coups de l’excavatrice, c’est pour laisser place à une vue plus libre. Entre mépris et tendresse, il est certain que la communauté INSA saura, lorsqu’elle foulera de son pied l’herbe naissante d’une nouvelle coulée verte, se souvenir d’un temps qui n’est plus et comprendre les mots de Gaston Berger : « La vie, c’est le passage6. »
L'histoire du peigne en images
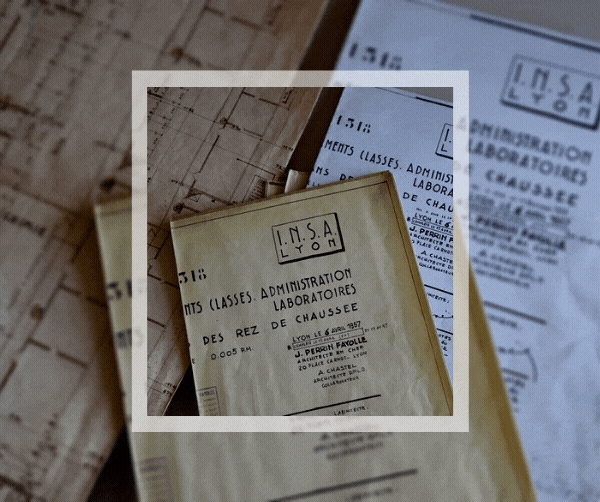
1Institut National des Sciences Appliquées (revue n°14 Hygiène et Confort des collectivités, édito signé par P. Donzelot, Directeur général de l’équipement scolaire, universitaire et sportif) – en 1958.
2Les « Propédeutiques » étaient les étudiants de première année. Jusque dans les années soixante, le premier cycle était constitué d’une année, contre deux aujourd’hui.
3Premier Cycle.
4Formation Initiale aux Métiers de l’Ingénieur.
5Marcel Bonvalet, de 1967 à 1969.
6Encyclopédie française XX, 20.02.7.


