
INSA Lyon
Francis Maupas nous a quittés le samedi 3 septembre 2022
Francis était un homme que la réputation précédait. Lourde tâche donc, que de résumer sa personne en quelques lignes. S’il fallait commencer quelque part, on décrirait certainement son esprit, qui était à l’image de cette école qu’il aimait tant : « inventif et foisonnant ». Arrivé en 1961, d’abord en tant que conseiller d’orientation professionnelle, puis en que directeur des résidences, Francis Maupas n’a pas seulement marqué l’institution. Il a inscrit un souvenir attendri chez toutes les personnes qui avaient eu la chance de croiser sa route.
 Débarqué du navire Jean Bart sur lequel il avait fait son service militaire, il s’était naturellement acclimaté à l’ambiance communautaire qu’offrait l’INSA. Ses fonctions au « service Psychologie » semblaient avoir été dressées pour lui. Durant ses études de psychologie, il avait été associé dès la création de l’INSA aux commissions d’appréciations. Ainsi était-il était déjà familier avec l’aspect inédit que portait le « projet INSA ». Avait-il conscience qu’à la signature de son premier contrat, débutait une longue histoire d’amour avec cette école ; lien qui rayonnera certainement encore longtemps après la fin de sa vie ?
Débarqué du navire Jean Bart sur lequel il avait fait son service militaire, il s’était naturellement acclimaté à l’ambiance communautaire qu’offrait l’INSA. Ses fonctions au « service Psychologie » semblaient avoir été dressées pour lui. Durant ses études de psychologie, il avait été associé dès la création de l’INSA aux commissions d’appréciations. Ainsi était-il était déjà familier avec l’aspect inédit que portait le « projet INSA ». Avait-il conscience qu’à la signature de son premier contrat, débutait une longue histoire d’amour avec cette école ; lien qui rayonnera certainement encore longtemps après la fin de sa vie ?
Il disait du service APO (Aide Psychopédagogique et Orientation) qu’il dirigeait, que « comme aux Galeries Lafayette, il s’y passe toujours quelque chose ». Effectivement, là où se trouvait Francis Maupas, il se passait toujours quelque chose. Son rôle, à la croisée des chemins entre les études et l’emploi, la famille et la société, supposait une faculté d’écoute qu’il est juste de se remémorer; des heures et des heures dédiées aux autres, inlassable.
Mais Francis ne s’est jamais satisfait d’être seulement une bonne oreille ; c’était un homme d’action. Toujours intéressé et cherchant à aller au fond des choses, il visait l’évolution, le mieux, récoltant ainsi autant la résonnance que la dissonance auprès de ses interlocuteurs. De toutes ses compétences mises à profit au sein des services de l’INSA par lesquels il a pu passer, c’était son calme, son extrême bienveillance et son sens de la justice qui marquaient ses collègues et étudiants.
Amoureux des idées de Capelle et de Berger, il trouvait dans leurs écrits une source d’inspiration profonde. Ce psychologue de formation se sentait-il investi d’une mission ? Personne n’a jamais vraiment su le dire. Tout ce que l’on peut affirmer avec certitude, c’est cette passion, vouée à la philosophie insalienne, toute sa vie. Même après ses trente-six ans de postes, rien ne l’avait arrêté dans son ambition de faire vivre les idées des fondateurs de l’école. À sa retraite, il eut d'ailleurs longtemps proposé des leçons de « communicologie », au département des Humanités : un cours qui consistait en des groupes de paroles sur les sciences humaines, la psychologie et la sociologie.
Francis était un homme passionné de photographie et de lecture. Un peu fâché avec l’informatique, il préférait le papier, qu’il gardait précieusement. À tel point, qu’il s’était vu prêter un espace au sous-sol de la résidence GJ pour entreposer ses 35 mètres linéaires d’archives publiques. Ce grand collectionneur ne s’était jamais débarrassé des lettres, fiches ou prospectus qui avaient pu concerner l’école. Si un bon nombre de ses souvenirs et de ses écrits sont désormais classés méthodiquement dans un fonds d’archives dédié, d’aucun savent qu’il préférait en garder quelques-uns secrets qu’il avait souhaité partager dans une anthologie. Ce projet de publication, poussé par le directeur Joël Rochat, a été enrichi année après année. Dans la maison construite par son père, dans le Var, il a continué, jusqu’aux derniers mois de sa vie, à peaufiner des écrits longtemps placés sous scellés tant il leur trouvait un goût d’inachevé. Aussi faudrait-il l’écriture d’un livre tout entier pour faire honneur à un tel homme ; peut-être aussi épais que celui sur lequel il travaillait depuis plusieurs années.
L’école portera longtemps la mémoire de Francis Maupas, dont l’histoire est mêlée à celle de l’INSA Lyon.
Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 12 septembre à 10h00 à l’église de Solliès-Pont, dans le Var.
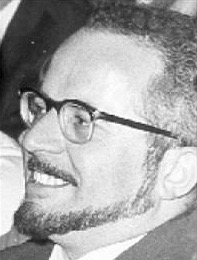 En 1961, il intègre le service Psychologie. Puis, en parallèle de ces missions, il se voit confier la direction des résidence E, F et H. En 1963, il est nommé responsable du service Psychologie, jusqu’en 1974 où le nom change et devient le service APO (Aide Psychopédagogique et Orientation). En 1976, après 15 années de dévouement Francis Maupas met fin à ses fonctions de directeur des résidences E, F et H au profit d’actions pédagogiques dans les département GMD (Génie Mécanique et Développement) et IF (Informatique). En 1976, ce service mène des actions au niveau des admissions : recrutements, recruteurs, préparations, entretiens, jurys… En parallèle de ces activités, Monsieur Maupas assure des cours de « communicologie », perpétués même après sa retraite en 1997. Jusqu’en 2000, et malgré la suppression du service APO après son départ et au profit d’internet, il met son expertise au service de l’INSA, afin d’assurer une « assistance technique ».
En 1961, il intègre le service Psychologie. Puis, en parallèle de ces missions, il se voit confier la direction des résidence E, F et H. En 1963, il est nommé responsable du service Psychologie, jusqu’en 1974 où le nom change et devient le service APO (Aide Psychopédagogique et Orientation). En 1976, après 15 années de dévouement Francis Maupas met fin à ses fonctions de directeur des résidences E, F et H au profit d’actions pédagogiques dans les département GMD (Génie Mécanique et Développement) et IF (Informatique). En 1976, ce service mène des actions au niveau des admissions : recrutements, recruteurs, préparations, entretiens, jurys… En parallèle de ces activités, Monsieur Maupas assure des cours de « communicologie », perpétués même après sa retraite en 1997. Jusqu’en 2000, et malgré la suppression du service APO après son départ et au profit d’internet, il met son expertise au service de l’INSA, afin d’assurer une « assistance technique ».
Sport
Course folklorique en hommage à Lionel Manin
Organisée par le Club INSA Athlétisme - CIA en hommage au professeur en Génie Mécanique Lionel Manin, décédé dans une avalanche au printemps dernier.
Lionel Manin appréciait particulièrement la course folklo du cross de l'INSA, donc osez tous les déguisements et venez nombreux !
🏁 Course de 4km
🏅 Récompenses pour les 3 meilleurs déguisements et la plus grande équipe inscrite
☕ Ravitaillement à l'arrivée
⌚ Retrait des dossards 17h30-18h15
Départ de la course 18h30
🎫 Inscription 3€ : https://eqrcode.co/a/BPHg8u
❗ Passe sanitaire obligatoire ❗
Informations complémentaires
- https://fb.me/e/1iM8xUfWJ
-
Campus LyonTech La Doua

Vie de campus
Requiem pour un peigne
La légendaire excroissance du bâtiment Louis Neel a tristement entamé sa chute depuis le 24 juin dernier. On l’appelait « le peigne » ou « les travées », en référence à ses quatre longs couloirs qui desservaient salles de classes et salles de travaux pratiques.
Érigé en 1957, le peigne a été l’un des premiers édifices du campus : il fallait « faire vite » pour construire en sept mois des bâtiments en dur où seraient « instruits, logés, nourris les élèves de la première année de l’Institut1. » Avec des menuiseries et façades métalliques coiffées d’ouvrants à projection à l’italienne, Jacques-Perrin Fayolle l’avait pensé plein de promesses pour les jeunes étudiants. Simple dans la structure, l’architecte n’en avait exclu ni la modernité ni l’élégance de son époque.
Dans les travées ont déambulé les tous premiers étudiants de l’INSA Lyon. Chacune présentait un volume identique : 74,50 mètres de long, 9,90 mètres de large et 3 mètres de hauteur sous plafond, et accueillaient le « groupe des laboratoires » comme il pouvait parfois être appelé. Les plus anciens élèves se rappelleront peut-être de « la pêche aux cations » sur les paillasses en carrelage blanc, vêtus de leur blouse blanche. Symbole de la première année de formation insalienne, le peigne trônait à l’ouest de l’espace vert central du « QG des propé2 », du « PC3» ou du « FIMI4 ». Puis est arrivé un nouveau directeur5 avec l'intention de faire souffler un vent nouveau sur l’école, en ouvrant la pédagogie à de nouvelles formes : désormais, les blocs de béton carrelés des laboratoires de chimie laisseraient place aux classiques salles de classes.
Chaque insalien aura vécu entre les murs du peigne des moments mémorables : des heures de travaux pratiques de physique, de cours de langues et d’humanités… Et souvent, le souvenir a plusieurs saveurs : lorsque derrière les ossatures métalliques des façades se pointaient les rayons matinaux du soleil, l’âge de la bâtisse se faisait sentir. L’isolation bien incertaine ne ravissait ni en été, ni en hiver, doublée de l’atmosphère presque médicale indiquée par la couleur des murs surannée. Et dans le même temps, les jeunes étudiants fraîchement tombés des nids familiaux trouvaient dans ces longs couloirs bleus, un endroit de repère et de réconfort à croiser chaque jour les visages de leurs nouveaux amis.
Si aujourd’hui les murs du peigne s’agenouillent sous les coups de l’excavatrice, c’est pour laisser place à une vue plus libre. Entre mépris et tendresse, il est certain que la communauté INSA saura, lorsqu’elle foulera de son pied l’herbe naissante d’une nouvelle coulée verte, se souvenir d’un temps qui n’est plus et comprendre les mots de Gaston Berger : « La vie, c’est le passage6. »
L'histoire du peigne en images
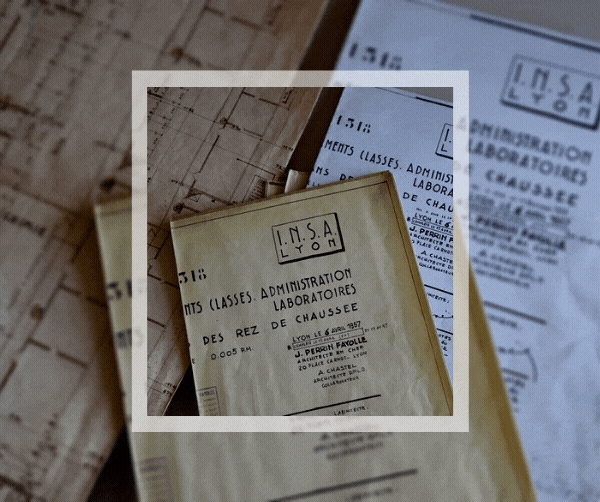
1Institut National des Sciences Appliquées (revue n°14 Hygiène et Confort des collectivités, édito signé par P. Donzelot, Directeur général de l’équipement scolaire, universitaire et sportif) – en 1958.
2Les « Propédeutiques » étaient les étudiants de première année. Jusque dans les années soixante, le premier cycle était constitué d’une année, contre deux aujourd’hui.
3Premier Cycle.
4Formation Initiale aux Métiers de l’Ingénieur.
5Marcel Bonvalet, de 1967 à 1969.
6Encyclopédie française XX, 20.02.7.

INSA Lyon
Hommage à Serge Turlan
Hommage de Michel Descombes, membre du directoire d'INSAVALOR et de Stéphane Raynaud, enseignant-chercheur de l’INSA Lyon à Serge Turlan décédé le 9 mai dernier.
Humaniste, curieux et épicurien
« Serge TURLAN a été très tôt un fervent partisan du mélange des sciences et des humanités, que ce soit lors de son passage à CAST, puis comme enseignant à l’INSA de Lyon, où il initia et développa des projets de formation tant dans le domaine de la qualité, du management, que celui de la métrologie. Son passage dans l’industrie l’avait certainement conforté dans l’idée que la technique sans le relationnel et la prise en compte des personnes n’est pas viable, en humaniste il a toujours été fidèle à ce précepte.
Curieux, il l’était aussi, si souvent une phase d’hésitation précédait son engagement, il finissait toujours par accepter le challenge. Curieux il l’était aussi pour comprendre et échanger avec ses interlocuteurs, approfondir, trouver un sens, débattre, même lorsque leurs visions, voire leurs convictions se trouvaient être éloignées des siennes. Son appétence pour la pédagogie, que ce soit pour les élèves ou pour les professionnels de la formation continue, qu’il a gardé jusqu’à la fin de sa carrière, tenait certainement à son attrait pour les autres.
Cela l’a amené à assumer de nombreuses responsabilités dans l’établissement. Sans être exhaustif, il a été responsable du service métrologie à la fois à CAST et au département GMC, chef de la Mission Formation Continue et l’un des acteurs de son rapprochement avec INSAVALOR et CAST dont il fut aussi quelques années l’un des directeurs, sans oublier son investissement auprès d’institutions comme le Collège Français de Métrologie, pour n’en citer qu’une.
Epicurien, il l’était tout autant, ceux qui l’ont côtoyé, se rappellent qu’il était aussi un compagnon de voyage et d’agape affable, lors de déplacements en France ou à l’étranger. Son attrait, en toute simplicité, des arts de la table n’était pas la moindre de ses qualités, se remémorer ces temps d’échange et de convivialité sans contraintes, resteront les souvenirs les plus présents et agréables. » Michel Desccombees
« Serge,
Je te dois beaucoup, lors de mon arrivée dans le département GMC, tu étais le référent dans le domaine de la métrologie dimensionnelle, de la qualité et du management de projet. Tu m’as donné le gout de poursuivre ma carrière dans le domaine du contrôle qualité des produits mécaniques en formation initiale et continue.
Nous avons travaillé de nombreuses années main dans la main au sein de la plateforme commune INSA GMC et INSAVALOR/INSACAST de métrologie.
Tu étais toujours entre le milieu industriel et le milieu universitaire. Tu as mis en œuvre et réalisé des projets remarquables dans le cadre des PFE avec de nombreux industriels et étudiants du département GMC pendant une trentaine d’années et jusqu’à ton départ à la retraite.
Tu étais très attachant, bienveillant, serviable et à l’écoute des collègues et des étudiants. Tu étais très pédagogue et généreux dans les explications et les connaissances prodiguées.
Une fois à la retraite, passionné par la formation continue, tu as continué quelques années pour diffuser ton savoir et ton expérience… Le dernier projet réalisé ensemble en tant que client et co encadrant de PFE était il y a tout juste 3 ans, sur la conception d’une machine de mesure du pollen dans l’air.
Triste nouvelle en période de crise sanitaire COVID19, tu nous quitte à cause d’une allergie aux piqures de guêpes…Incroyable fin !
Je te souhaite au nom du Pôle Smart-RAO – Meca3D et surtout des collègues du domaine métrologie de l’INSA/INSAVALOR de reposer en paix.
Tu resteras dans nos mémoires.
Amicalement, Stéphane. »

INSA Lyon
Hommage à Philippe Pesteil
Philippe Pesteil est décédé le vendredi 9 avril des suites du Covid-19.
Ingénieur INSA, il a eu une longue carrière chez EDF avant de devenir coach professionnel en 2016 afin d’accompagner la carrière de nombreux ingénieurs.
Cette reconversion n’est pas surprenante : il avait des qualités humaines appréciées par toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.
Engagé et humaniste, Philippe Pesteil savait soutenir, accompagner et guider nos étudiants auprès desquels il intervenait depuis deux années dans les départements de génie mécanique et génie électrique de l’INSA Lyon. Son objectif était de les faire progresser, de les faire réfléchir à l’importance de l’humain. Grâce à son implication sans faille, les étudiants ont beaucoup appris auprès de lui.
Marie Grandgenèvre, enseignante d'économie-gestion au département d’Humanités de l’INSA Lyon
© P.Pesteil

Recherche
Hommage à Jean-Pierre Pascault
Jean-Pierre Pascault, Professeur Emérite à l’INSA Lyon, Commandeur dans l’ordre des Palmes Académiques, s’est éteint ce samedi 4 avril 2020.
C’est à son établissement qu’il a consacré une grande partie de sa vie en contribuant à la fois à la qualité, désormais reconnue, de la formation des ingénieurs INSA et à faire de l’école un grand centre de recherches. C’est en effet après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur chimiste en 1965 puis un doctorat ès sciences sur la polymérisation anionique, qu’il l’a rejoint, dès 1966 comme assistant et en 1972 comme maître-assistant et enfin comme professeur des universités en 1983, et s’est investi pour faire ce qu’est l’INSA Lyon d’aujourd’hui. Fortement attaché à son établissement, il s’est toujours impliqué dans sa vie collective et son animation ayant été successivement membre élu de son conseil d’administration (1976-1980) et de son conseil scientifique (1982-1986). Attaché à la transmission des connaissances au plus près des derniers développements de la science mais aussi des préoccupations applicatives avec de forts liens avec l’industrie, il a construit une véritable école des polymères de Lyon avec de réelles spécificités reconnues nationalement et internationalement. La recherche ne pouvait être dissociée de la formation qu’il a marquée au sein des successifs départements ‘Matériaux’ de l’INSA Lyon et par ses enseignements en DEA puis master du site mais aussi dans le cadre de la commission pédagogique du GFP (groupement français d’études & d’applications des polymères, société savante dans le domaine des polymères) dont il a été le président de 2001 à 2004.
C’est un grand scientifique, passionné, rigoureux, inventif, peu attaché aux honneurs qu’était Jean-Pierre Pascault. Chercheur internationalement reconnu, il a apporté des contributions significatives dans de nombreux champs de la science des polymères : chimies macromoléculaires notamment celles des réseaux polymère, polymères dynamiques, design de morphologies à toutes échelles par la maîtrise de processus chimiques et thermodynamiques, mise en situation dans les procédés d’élaboration et mise en forme, utilisation de composés biosourcés… Tous ses travaux fondamentaux n’ont jamais été guidés par la recherche d’une mise en lumière qui n’aurait pas été justifiée par de réelles avancées applicatives, en particulier transposables en milieu industriel. Tout en ayant publié plus de 350 publications, deux ouvrages de référence et près de 300 communications, il est ainsi auteur de 50 brevets. Cette recherche, il a aimé la faire en particulier avec les 60 doctorants qu’il a encadré et auxquels il a beaucoup donné, à la fois en les guidant au jour le jour dans leurs travaux avec une grande attention, veillant à la qualité, à l’inventivité et à la rigueur de ces derniers mais aussi en leur offrant une proximité qui a fait que beaucoup d’entre eux ne sont pas de simples anciens docteurs mais sont devenus ses amis. Comme pour son établissement et la formation, Jean-Pierre Pascault s’est attaché tout au long de sa vie à construire l’environnement le plus favorable pour les chercheurs et faire vivre la vie scientifique collective. Élu au comité national de la recherche scientifique (CoNRS) pour deux mandats (1980-1986 et 1990-1994) mais aussi au conseil national des universités (CNU S33) de 2000 à 2003, il a porté avec une voix particulière faite de bienveillance et d’exigence, la défense d’une conception de la science au sein de laquelle chaque chercheur, avec ses approches et domaines particuliers, puisse y trouver sa place et s’y épanouir. C’est ainsi qu’il a aussi très tôt, de 1982 à 1992, dirigé l’Unité de recherche associée au CNRS, aujourd’hui l’UMR CNRS 5223 ‘Ingénierie des Matériaux Polymères’ et son antenne à l’INSA Lyon jusqu’en 1997 mais aussi créé la Fédération des Polyméristes Lyonnais (FR 2151) en 2000, structure qui allait servir de base avec son centre commun de RMN à la naissance de la FR Institut de Chimie de Lyon.
Aujourd’hui, l’unité IMP doit beaucoup à Jean-Pierre Pascault car il contribué, grâce à son rayonnement scientifique attesté par les nombreuses conférences et congrès auxquels il a été invité ou organisé, à construire un laboratoire internationalement reconnu, extrêmement visible à la fois sur ses travaux scientifiques mais aussi sur son positionnement avec le milieu des entreprises. C’est l’identité même de l’unité qu’on lui doit, faite de recherches originales, d’une organisation spécifique et de cette proximité avec l’Industrie mais aussi une manière de faire de la recherche au sein d’un collectif fort et passionné. Les entreprises, grands groupes mais aussi et surtout PME et PMI, ont aujourd’hui perdu un grand soutien et collaborateur au sein de la communauté académique car Jean-Pierre Pascault a toujours défendu que participer à résoudre des problématiques technologiques pouvait permettre de s’engager sur des questions scientifiques originales. Nombre d’entreprises ont travaillé avec lui sur de grands projets qui ont abouti à développer de nouveaux produits mais aussi à s’engager, grâce à son pouvoir de conviction, dans de nouvelles activités. C’est ainsi qu’il s’était fortement impliqué et était encore très récemment extrêmement actif auprès des pôles de compétitivité qui portent le tissu des entreprises de la plasturgie et des textile techniques au sein de leurs conseils scientifiques, soucieux de défendre les projets que portaient ces derniers. On ne saurait aussi parler de Jean-Pierre Pascault sans revenir sur les relations internationales qu’il a généré grâce à la renommée de ses travaux mais aussi de sa propension à découvrir d’autres pratiques pour faire la Science et à nouer des liens avec d’autres chercheurs qui sont pour la plupart devenus des amis très proches. Ces liens forts et pérennes à travers les décennies, il a su les offrir aux plus jeunes chercheurs pour qu’eux aussi s’enrichissent d’autres cultures. Les nombreuses collaborations d’aujourd’hui, certaines concrétisées sous la forme de réseaux reconnus et actifs, ou d’implications dans des sociétés savantes internationales, notamment européennes, sont pour l’essentiel issues de son engagement dans ce partage. La communauté scientifique des polymères à travers l’Europe et plus largement dans le Monde, a perdu un chercheur apprécié de toutes et tous et un grand ami.
Jean-François Gérard, enseignant-chercheur de l’INSA Lyon

