
Sciences & Société
Les Rencontres du Développement Durable
Une organisation conjointe de l'Institut Open Diplomacy et de l'INSA Lyon
Les RDD sont organisées à l’issue de l’Assemblée générale de l’ONU à travers toutes les régions françaises pour permettre à tous de réfléchir à ces problèmes dont les solutions viendront de l’action internationale comme des politiques territoriales.
Le programme des Rencontres du Développement Durable 2021 a été co-construit avec l’ensemble des partenaires rassemblés par l’Institut Open Diplomacy pour permettre à chacune et chacun de s’emparer des enjeux écologiques. Des villes durables à la finance responsable, en passant par l'industrie du futur, les partenaires ont choisi 10 fils rouges pour aider les citoyens à rentrer dans l’univers complexe de la transition écologique et solidaire.
BÂTIR DES VILLES DURABLES
- 9h15 à 9h40 | Ouverture de la journée
- 9h45 à 11h05 | Table-ronde #1 - La ville face au défi de l’adaptation au changement climatique
Alors qu’elles représentent 75 % des émissions de gaz à effet de serre et qu’elles sont l’épicentre de l’artificialisation des sols, les villes amorcent aujourd’hui un virage écologique majeur. La pandémie - remettant en cause le mode de vie urbain - a accéléré cette mutation. S’adapter à la crise climatique en végétalisant, en améliorant l'efficacité énergétique du bâti, et lutter contre la pollution constituent les dossiers en haut de la pile des maires car une question clé se pose : d’ici la fin du 21e siècle, pourrons-nous encore imaginer vivre en ville ? L’exode urbain, nouvel exode ?
- 11h15 à 11h35 | Keynote #1 - Stream « Penser l'après avec les ODD »
- 11h45 à 12h45 | Masterclass #1 - Stream « Défendre les générations futures »
- 14h00 à 15h15 | Table-ronde #2 - Smart cities : inclure petites ET grandes communes ?
La pandémie nous a projetés dans le tout numérique, où le télétravail généralisé provoquera, à court terme, une recomposition des espaces. Dans cet avenir incertain, quelle sera la place des smart cities ? Comment ces villes-réseaux, vecteurs d’améliorations considérables de notre qualité de vie et sources de nouvelles failles de cybersécurité, vont s’inventer ? Comment vont-elles se dessiner à l’heure où les bassins de vie et les bassins d’emploi sont en pleine révolution et où l’articulation entre les espaces ruraux et les espaces urbains sont au cœur des enjeux de cohésion sociale ? La promesse de mobilités plus efficaces et plus sobres qui en est le cœur sera-t-elle encore valable dans un monde post-COVID ?
- 15h30 à 15h55 | Keynote #2 - Stream « Construire l'avenir de l'Union »
- 16h05 à 17h20 | Masterclass #2 - Stream « Faire un monde plus solidaire »
- 17h30 à 18h30 | Clôture « Bâtir des villes plus résilientes » - Stream « Penser l'après avec les ODD »
Informations complémentaires
- https://www.les-rdd.fr/27-9-a-lyon
-
En distanciel

Recherche
Progrès numérique et sobriété : un mariage de raison
La pandémie et les confinements successifs auront fini d’accomplir la tâche : il n’est plus question de se passer de l’outil digital. Mais désormais, la transition numérique, aussi incontournable soit-elle, soulève une question : est-elle compatible avec la transition énergétique ?
Il semblerait que la technologie mette à nouveau l’humain face à son rapport au progrès, aux limites de la planète et du temps. Entre accélération et freinage d’urgence, quatre chercheurs de l’INSA Lyon prennent le temps de l’explication, et invitent à reconsidérer le besoin. Société numérique + enjeux climatiques : comment satisfaire l’équation ?
Le numérique prodige, déchu.
Hervé Rivano, Jean-François Trégouët et Nicolas Stouls sont chercheurs à l’INSA Lyon. Ils publiaient en novembre dernier une tribune qui s’attachait à démontrer la menace pesante du numérique sur la transition énergétique. « Le numérique est souvent considéré comme une porte de sortie pour réduire la consommation d’énergie dans beaucoup de secteurs. Mais les impacts environnementaux liés à son usage croissant sont bien trop sous-estimés », introduit Jean-François Trégouët, maître de conférence à l’INSA Lyon et membre du laboratoire AMPERE1.
 Selon le Shift Project, la part du numérique dans le total mondial des émissions de gaz à effet de serre se hisse à 3,7 %2. « Les impacts directs sont principalement liés au cycle de vie des terminaux et leur utilisation. Les ordinateurs, les boîtiers internet ou les câbles sont fabriqués puis acheminés aux quatre coins du monde. Puis pour faire fonctionner ces objets, il faut produire de l’électricité, prévoir des centres de stockage et différents réseaux qui acheminent les données. Tout ça pèse dans le bilan carbone mondial. Les impacts indirects quant à eux sont tout aussi importants mais bien plus difficiles à évaluer », ajoute-t-il.
Selon le Shift Project, la part du numérique dans le total mondial des émissions de gaz à effet de serre se hisse à 3,7 %2. « Les impacts directs sont principalement liés au cycle de vie des terminaux et leur utilisation. Les ordinateurs, les boîtiers internet ou les câbles sont fabriqués puis acheminés aux quatre coins du monde. Puis pour faire fonctionner ces objets, il faut produire de l’électricité, prévoir des centres de stockage et différents réseaux qui acheminent les données. Tout ça pèse dans le bilan carbone mondial. Les impacts indirects quant à eux sont tout aussi importants mais bien plus difficiles à évaluer », ajoute-t-il.
 Parmi les conséquences difficiles à mesurer, « l’effet rebond » qui se traduit par une augmentation de la consommation, lorsqu’une solution technique est optimisée. « C’est un phénomène paradoxal. Par exemple, alors que les quantités d’énergie nécessaires pour faire transiter une donnée diminue grâce aux avancées des ingénieurs, la consommation d’énergie mondiale dédiée au numérique ne cesse de croître. C’est l’effet rebond : bien que l’outil soit plus efficace, nous consommons plus de ressources ! », illustre Hervé Rivano, professeur à l’INSA Lyon et chef de l’équipe Agora3 au laboratoire CITI4.
Parmi les conséquences difficiles à mesurer, « l’effet rebond » qui se traduit par une augmentation de la consommation, lorsqu’une solution technique est optimisée. « C’est un phénomène paradoxal. Par exemple, alors que les quantités d’énergie nécessaires pour faire transiter une donnée diminue grâce aux avancées des ingénieurs, la consommation d’énergie mondiale dédiée au numérique ne cesse de croître. C’est l’effet rebond : bien que l’outil soit plus efficace, nous consommons plus de ressources ! », illustre Hervé Rivano, professeur à l’INSA Lyon et chef de l’équipe Agora3 au laboratoire CITI4.
Le numérique qui semblait représenter une si belle opportunité pour répondre aux enjeux environnementaux, ne semble donc pas remplir toutes ses promesses. Et alors que l’on doit l’émergence du numérique à la recherche technologique, c’est cette dernière qui semble être convoquée pour optimiser encore et encore, l’outil.
Ingénieurs et chercheurs, à la barre.
I nventer, réinventer, trouver des méthodes de réduction de la consommation en énergie ou en matière première… L’optimisation technique fait le quotidien des chercheurs. « Tout est presque faisable en matière de technologie. Il est par exemple tout à fait possible d’imaginer d’inclure les data-centers à l’échelle d’une ville et réutiliser la chaleur produite en l’injectant directement dans le réseau de chaleur urbain. Il existe de nombreuses pistes prometteuses et stimulantes pour les ingénieurs et les chercheurs, mais ces pistes répondent à quelle nécessité ? Celle de chauffer des habitations, ou celle de consommer encore plus de données ? Il est primordial de questionner notre besoin », pose Nicolas Stouls, maître de conférence et membre du laboratoire CITI.
nventer, réinventer, trouver des méthodes de réduction de la consommation en énergie ou en matière première… L’optimisation technique fait le quotidien des chercheurs. « Tout est presque faisable en matière de technologie. Il est par exemple tout à fait possible d’imaginer d’inclure les data-centers à l’échelle d’une ville et réutiliser la chaleur produite en l’injectant directement dans le réseau de chaleur urbain. Il existe de nombreuses pistes prometteuses et stimulantes pour les ingénieurs et les chercheurs, mais ces pistes répondent à quelle nécessité ? Celle de chauffer des habitations, ou celle de consommer encore plus de données ? Il est primordial de questionner notre besoin », pose Nicolas Stouls, maître de conférence et membre du laboratoire CITI.
Cette attitude, c’est celle communément appelée « la sobriété numérique », une notion qui rappelle que le progrès doit servir des causes, et ne pas être un objectif en soi. Kévin Marquet, maître de conférence et enseignant au département informatique de l’INSA Lyon, a participé aux ateliers menés par le Shift Project sur la question. « La sobriété numérique consiste à ne plus nécessairement passer par des technologies pour effectuer une tâche, mais à piloter ses choix à travers une attitude critique vis-à-vis de la technologie. Il s’agit de se donner un choix, plutôt que de le subir », explique-t-il.
Référé-suspension : le besoin questionné.
 Si la capacité à interroger l’utilité de la demande semble être nécessaire pour voir diminuer l’impact environnemental du numérique, le chercheur déplore l’attitude simpliste qui consiste à renvoyer l’utilisateur à sa propre et unique responsabilité. « Le modèle économique le plus répandu sur internet est celui de la publicité, basée sur des systèmes de ciblage très énergivores. Alors, le consommateur aura beau avoir fait ses choix numériques le plus sobrement du monde, une bonne partie du problème lui échappe encore. Les grands silencieux dans ce combat, ce sont les états des pays développés où la surconsommation numérique règne et dont le pouvoir de régulation est puissant. Tout ceci est une affaire de collectif : individus, entreprises et états, chacun a le pouvoir d’interroger l’utilité de ses comportements », ajoute Kévin Marquet.
Si la capacité à interroger l’utilité de la demande semble être nécessaire pour voir diminuer l’impact environnemental du numérique, le chercheur déplore l’attitude simpliste qui consiste à renvoyer l’utilisateur à sa propre et unique responsabilité. « Le modèle économique le plus répandu sur internet est celui de la publicité, basée sur des systèmes de ciblage très énergivores. Alors, le consommateur aura beau avoir fait ses choix numériques le plus sobrement du monde, une bonne partie du problème lui échappe encore. Les grands silencieux dans ce combat, ce sont les états des pays développés où la surconsommation numérique règne et dont le pouvoir de régulation est puissant. Tout ceci est une affaire de collectif : individus, entreprises et états, chacun a le pouvoir d’interroger l’utilité de ses comportements », ajoute Kévin Marquet.
Si le choix du consommateur est restreint et les politiques de régulation silencieuses, qu’en est-il du choix de l’ingénieur-concepteur, souvent à l’origine de la réponse à la demande ? « Le mythe du savant dans sa tour d’ivoire oublie que le chercheur fait partie de la société en tant que citoyen actif. La sobriété numérique est un champ de recherche passionnant pour les économistes et les sociologues, mais néanmoins, ses concepts pluridisciplinaires impliquent l’ingénieur et questionnent le rôle socio-politique des chercheurs », dit Jean-François Trégouët.
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »
Pour répondre aux défis majeurs de notre époque, l’INSA Lyon a récemment entamé un chantier d’évolution de la formation, avec au cœur du projet, le développement durable et le numérique. « Donner à penser et à comprendre pour que les citoyens construisent leurs choix en conscience fait partie de nos missions de chercheur. Les liens entre transition numérique et transition écologique ne sont pas toujours évidents à percevoir, et nous espérons pouvoir apporter aux élèves-ingénieurs, les clés pour les comprendre », ajoutent les enseignants-chercheurs également engagés dans les ateliers de réflexion autour de la formation.
 La préoccupation semble également avoir irradié au-delà des laboratoires et des salles de classe. « User d’un numérique plus responsable » : c’est une ambition inscrite dans le plan stratégique de l’établissement pour 2030 et dont les nombreuses dimensions nécessiteront un arbitrage, comme l’explique Hugues Benoit-Cattin, chargé du numérique. « Le chantier de la responsabilité numérique de l’établissement est très vaste. Devenir une structure numériquement responsable, c’est autant faire en sorte de consommer des solutions locales, que mutualiser les ressources informatiques et former ses personnels et étudiants à adopter une hygiène numérique. Des actions sont déjà engagées, et nous devons aller plus loin. Je pense également à la logique d’inclusion, dans l’accompagnement du handicap par exemple, qui est une belle illustration de ce à quoi le numérique peut servir, et où le progrès sert la cause », conclut Hugues Benoit-Cattin.
La préoccupation semble également avoir irradié au-delà des laboratoires et des salles de classe. « User d’un numérique plus responsable » : c’est une ambition inscrite dans le plan stratégique de l’établissement pour 2030 et dont les nombreuses dimensions nécessiteront un arbitrage, comme l’explique Hugues Benoit-Cattin, chargé du numérique. « Le chantier de la responsabilité numérique de l’établissement est très vaste. Devenir une structure numériquement responsable, c’est autant faire en sorte de consommer des solutions locales, que mutualiser les ressources informatiques et former ses personnels et étudiants à adopter une hygiène numérique. Des actions sont déjà engagées, et nous devons aller plus loin. Je pense également à la logique d’inclusion, dans l’accompagnement du handicap par exemple, qui est une belle illustration de ce à quoi le numérique peut servir, et où le progrès sert la cause », conclut Hugues Benoit-Cattin.
Pour aller plus loin : Hervé Rivano, Nicolas Stouls et François Trégouët ont animé une rencontre-débat en décembre dernier. La rencontre est à retrouver ici « Télétravail, 5g, Netflix… Notre empreinte numérique est-elle soutenable ? »
1 Génie électrique, électromagnétisme, automatique microbiologie environnementale et applications (INSA Lyon, ECL, Lyon 1, CNRS)
2 https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
3 AlGorithmes et Optimisation pour Réseaux Autonomes
4 Centre d’innovation en télécommunications et intégration de services (INSA Lyon/INRIA)
Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 5 - 21 avril 2022

INSA Lyon
Les brèves de la quinzaine
Campus d'Oyonnax. Le recteur Olivier Dugrip était en visite au PlastiCampus de Bellignat. Il a échangé avec les étudiants insaliens du Haut-Bugey du parcours de formation en plastronique sur leurs perspectives d’avenir.
En finale. Serveur cloud personnel connecté utilisant des disques durs revalorisés, Hurricane proposer de se libérer des grands noms du stockage en ligne par une approche éco-responsable. Le projet, porté par des élèves de l’INSA Lyon, est en finale du concours Coup2boost.
Formation durable. Bertand Raquet a répondu aux journalistes d'Usbek&Rica concernant les défis des sociétés modernes qui s’imposent aux ingénieurs de demain. Pour le président du Groupe INSA, aucun doute : « Tout ingénieur devra demain intégrer les enjeux climatiques et énergétiques à son métier. »
Objets connectés. Quatre livres blancs ont été édités par le laboratoire Citi et SPIE ICS qui travaillent dans le cadre de la chaire IoT à favoriser le développement de l’internet des objets pour une société connectée et respectueuse de l’individu. Le premier de la série traite de la sécurisation et du respect de la vie privée de l’utilisateur.
Ingénierie positive. Au micro de RCF Radio, l’ingénieure INSA et fondatrice de l’association La Clavette, Isabelle Huynh expose son concept « d’ingénierie positive », l'évolution de sa vie professionnelle et la place des industriels dans la transition écologique et solidaire.

Formation
Former tous les étudiants aux enjeux climat - énergie : le Groupe INSA ouvre un partenariat avec The Shift Project
The Shift Project, un laboratoire d’idées reconnu pour son expertise sur les enjeux climat-énergie, et qui œuvre en faveur d’une économie « post-carbone », va accompagner les établissements du Groupe INSA dans leur projet de former tous leurs étudiants à ces enjeux. Entretien avec Nicolas Freud, référent pour le projet ClimatSup et pilote du projet d’évolution de la formation à l’INSA Lyon.
Comment pouvez-vous présenter le projet ClimatSup INSA, et que va-t-il apporter à la formation INSA Lyon ?
L’INSA Lyon est en relation régulière avec The Shift Project depuis que ce dernier a lancé son chantier sur l’enseignement supérieur (voir, notamment, le rapport « Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat », publié en mars 2019). Nous avons pu constater que nous partagions le point de vue selon lequel tous les étudiants devraient être formés aux enjeux climat-énergie. Nous avons alors pensé que The Shift Project pourrait nous aider à conduire notre chantier d’évolution de la formation sur ces thématiques, en nous apportant un accompagnement méthodologique et une expertise sur le plan scientifique et technique. C’est de là qu’est né le projet Climatsup, aujourd’hui porté à l’échelle du Groupe INSA, qui devrait nous aider à élaborer un programme de formation cohérent sur la thématique climat-énergie, dans le cadre plus global du chantier d’évolution de la formation défini par le conseil d’administration de l’établissement.
N’y a-t-il pas un risque à s’associer à The Shift Project, dont les propositions peuvent apparaître parfois controversées ?
The Shift Project fonde ses propositions sur le diagnostic de la communauté scientifique, qui établit clairement la nécessité de décarboner les activités humaines pour parvenir à limiter le réchauffement climatique. Il est toujours guidé, dans sa démarche, par l’exigence de rigueur scientifique. Il est tout à fait légitime, cependant, que ses propositions suscitent le débat, tant les problèmes à résoudre pour faire face au changement climatique et réaliser la transition énergétique remettent en question nos habitudes, dans tous les domaines. L’INSA Lyon estime que tous ses étudiants doivent être formés sur ces questions, et doivent être des acteurs des transformations en cours et à venir. Même s’il s’agit de sujets extrêmement complexes, les ingénieurs que nous formons peuvent et doivent contribuer à éclairer les débats et prises de décision, en apportant, notamment, leur expertise scientifique et technique (indispensable, par exemple, pour ne pas se tromper d’ordre de grandeur lorsqu’on cherche des solutions). L’expérience avec The Shift Project sera très intéressante pour nous aider à avancer sur ces sujets.
L’INSA Lyon est particulièrement moteur pour faire évoluer sa formation, en phase avec les grands enjeux sociétaux et environnementaux. Est-ce une priorité stratégique pour l’établissement ?
Oui, absolument. L’INSA Lyon a acté le fait que les grands enjeux sociétaux et environnementaux doivent occuper une place centrale dans la formation. L’étape de la politique de formation étant franchie (avec le vote de deux notes de cadrage par le CA en 2019-20), l’établissement aborde à présent la phase plus opérationnelle de construction des futures maquettes de formation, qui seront proposées dès la rentrée 2021 aux nouveaux bacheliers. C’est un chantier complexe, mais nous sommes heureux de compter, dans le paysage des grandes écoles, parmi les acteurs les plus impliqués dans cette transformation devenue particulièrement urgente.

Sciences & Société
Atelier "Fresque du climat" (2h30)
Atelier proposé dans le cadre de la Fête de la Science.
Un atelier ludique, participatif et créatif qui propose de découvrir les composantes de dérèglement climatique et les conséquences dramatiques que cela comporte pour l'être humain et l'écosystème. Les bouleversements climatiques constituent, sans ambiguïté une des principales causes de la perte sévère de biodiversité. En équipe, on doit retrouver les liens de cause à effet entre les différents éléments du changement climatique et co-construire une véritable “Fresque” du climat. Perturbation des écosystèmes, acidification des océans, suppression d'espèces ou au contraire prolifération d'autres représente une série d’impacts de changement climatique sur la biodiversité. Un débat final permettra d’envisager des solutions à mettre en œuvre pour limiter le dérèglement climatique.
Atelier animé par Marion Fregonese, Nicolas Stouls, Solène Tadier, Lydie Ferrier, Claire Leschi / Groupe Transition INSA.
Réservé aux lycéens.
Sur Inscription :
- jeudi 8/10 de 9h à 12h : Marion Fregonese et Nicolas Stouls (23 participants max)
- jeudi 8/10 de 14h à 17h : Solène Tadier (15 participants max)
- vendredi 9/10 de 9h à 12h : Marion Fregonese et Lydie Ferrier (23 participants max)
- vendredi 9/10 de 14h à 17h : Claire Leschi (15 participants max)
Informations complémentaires
-
Salle de créativité de la BMC 202-203 - Bibliothèque Marie Curie
Mots clés

INSA Lyon
L’INSA Lyon toujours plus investi dans le développement durable
Le Times Higher Education a publié hier, mercredi 22 avril, la deuxième édition de son classement mondial dédié à la performance des établissements d’enseignement supérieur en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. L’INSA Lyon se classe parmi les 200 meilleures universités mondiales ayant un impact positif sur la société et décroche la 5e place ex-aequo des institutions françaises*. Un rang remarquable pour un établissement engagé de longue date sur ces problématiques. Interview avec Nicolas Gaillard, directeur adjoint en charge du développement durable.
Avec sa 54e place mondiale sur la thématique « Énergie propre et abordable » et sa 70e place sur la thématique « Villes et communautés durables », l’INSA sort son épingle du jeu sur l’énergie et la durabilité. Qu’en est-il vraiment ?
En matière d’énergie, l’établissement se mobilise depuis de nombreuses années pour définir une trajectoire de transition énergétique et écologique. L’efficacité énergétique du patrimoine immobilier et le développement des énergies renouvelables sont en effet des axes prioritaires, au même titre que la réduction des impacts environnementaux liés à la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces verts.
Nous avons mis en place cet engagement au service de la durabilité depuis de nombreuses années, en instaurant notamment un bilan des émissions de gaz à effet de serre depuis 2009, associé à un plan d’actions en réduction et en compensation. Nous avons également réalisé, en 2016, un diagnostic complet des aspects énergétiques et écologiques.
Avec les programmes de travaux de l'opération Lyon Cité Campus, qui visent à réhabiliter les bâtiments de notre campus, sont intégrées des exigences environnementales fortes, fondées sur des cibles de performances Haute Qualité Environnementale. Il faut savoir, par exemple, que les façades structurelles ont été réhabilitées avec un matériau bio-sourcé, le bois, remplaçant en partie les anciens éléments en aluminium. Toutefois, le nouveau parement est resté en aluminium pour respecter le choix de l’architecte Jean Prouvé.
Cet intérêt pour le patrimoine historique est d’ailleurs l’un des éléments qui expliquent notre bon classement dans la partie « Villes et communautés durables ». Nous sommes en effet attachés à la préservation du patrimoine historique et culturel, et notre campus en témoigne. C’est un campus ouvert sur la ville, avec des espaces verts et des espaces culturels dynamiques et accessibles.
Depuis quand date la prise de conscience de l’INSA Lyon dans l’intérêt des enjeux DDRS ?
Dès le début des années 2000, il y a près de vingt ans, notre école a mis le sujet de l’écologie au centre des discussions, avec la création d’une association étudiante, puis très vite le recrutement d’un chargé de mission. C’est en 2011 que l’INSA propose dans son projet d’établissement, un programme d’actions ciblées intitulé Agenda 21, qui sera institutionnalisé ensuite pour structurer la formation et la recherche au regard des enjeux DD&RS. Et en 2016, tout s’accélère. Avec la signature par la direction d’une charte Développement Durable et Responsabilité Sociétale proposée par nos élèves, qui fait des problématiques de développement durable un enjeu majeur et collectivement admis. Tous ces efforts nous conduisent naturellement à une labellisation officielle obtenue en 2019, pour une durée de 4 ans, qui vient reconnaître tout le travail réalisé pour faire de notre institut un établissement exemplaire en matière de d’engagement durable mais aussi pour intégrer la responsabilité sociétale dans son développement et veiller à mobiliser tous les acteurs. Et dernièrement, juste avant le confinement, nous avons eu l’immense honneur de recevoir le trophée des Campus Durables pour deux projets « verts », une récompense pour toute la communauté INSA qui se mobilise largement sur tous ces aspects.
La crise sanitaire occupe et préoccupe tous les esprits à l’heure actuelle, mettant au second plan la question de l’urgence climatique.
Qu’en pensez-vous ?
Effectivement, le discours ambiant a fait passer les problématiques DD&RS au second plan. Les médias focalisent leur attention sur la crise, avec toutes les problématiques sanitaires et aussi économiques que cela soulève. Cette crise met en lumière la désindustrialisation de notre pays et la délocalisation de certaines productions, comme celle de masques et de gants, vers la Chine notamment, illustrant notre dépendance et nous contraignant à des coûts et des délais importants, ce qui est également un non-sens environnemental.
Aussi, j'ai le sentiment que ces questions autour des enjeux climatiques et la place de l’humain dans la société vont revenir au cœur du débat, notamment dans les plans de relance post-Covid.
Notre école est également préoccupée par la crise actuelle. Mais il convient peut-être de distinguer l’urgence de la situation d'une stratégie d’action à long terme. Les enjeux de transition sont majeurs : transition énergétique, changement climatique, enjeux sociaux et solidaires… Ces problématiques touchent tous les citoyens. Elles doivent être au cœur de nos réflexions. Elles le sont particulièrement à l’INSA, où à terme, nous souhaitons nous affirmer encore plus dans les domaines de la transition écologique et durable. Ces classements sont très encourageants, mais nous voulons aller plus loin pour construire un avenir plus durable, qui porte des valeurs sociales et environnementales auxquelles nous croyons.
* L’INSA Lyon est classé dans les « 201-300 » sur 767 institutions pour le classement global. En 2019, l’INSA était classé « 301-400 » sur 450 institutions. L’école se distingue sur 8 indicateurs des 17 objectifs de développement durable établis par l’Organisation des Nations Unies :
Égalité des sexes :
Recherche sur l'étude du genre, les politiques en matière d'égalité des sexes et l'engagement à recruter et à promouvoir les femmes
INSA Lyon classé au rang 301-400
Eau propre et assainissement :
Recherche liée à l'eau, à l'utilisation de l'eau et à l'engagement à assurer une bonne gestion de l'eau dans la communauté au sens large
INSA Lyon classé au rang 201-300
Une énergie propre et abordable :
Recherche sur l'énergie, utilisation et politiques énergétiques, et engagement à promouvoir l'efficacité énergétique
INSA Lyon classé au rang 54
Réduction des inégalités :
Recherche sur les inégalités sociales, les politiques en matière de discrimination et l'engagement à recruter du personnel et des étudiants issus de groupes sous-représentés
INSA Lyon classé au rang 101-200
Villes et communautés durables :
Recherche sur la durabilité, le rôle de gardien des arts et du patrimoine et les approches internes de la durabilité
INSA Lyon classé au rang 70
Action pour le climat :
Recherche sur le changement climatique, l'utilisation de l'énergie et les préparatifs pour faire face aux conséquences du changement climatique
INSA Lyon classé au rang 101-200
La vie sous l'eau :
Recherche sur la vie sous l'eau et éducation et soutien aux écosystèmes aquatiques
INSA Lyon classé au rang 101-200
Partenariats pour les objectifs :
Les moyens plus larges par lesquels les universités soutiennent les objectifs de développement durable par la collaboration avec d'autres pays, la promotion des meilleures pratiques et la publication de données
INSA Lyon classé au rang 201-300

Sciences & Société
Bénéfices des arbres, qualité des sols, qualité de l’eau au sein de notre Métropole
Interventions de trois experts
- Frédéric SEGUR, ingénieur territorial à la Métropole de Lyon : comment l’arbre peut jouer un rôle de régulateur du climat, aider à lutter contre l’effet «d’ilot de chaleur urbain» et rendre la vie en ville plus supportable pendant les vagues de chaleur.
- Nicolas HUSSON, ingénieur environnement en sites et sols pollués, consultant et référent associatif, engagé pour la restauration d’une relation apaisée entre l’homme et la nature. Cadrage méthodologique et réglementaire sur les sites et sols pollués, la reconversion de friches dans l’agglomération lyonnaise et les évolutions vers la prise en compte de la biodiversité.
- Stéphane BUSCHAERT, président du Groupe de Recherche, Animation technique et Information sur l’Eau (www.GRAIE.org), directeur régional du BRGM Auvergne Rhône Alpes (établissement public référent dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol.) Evolution récente globalement positive de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en France, notamment par des exemples sur le bassin Rhône Méditerranée. Causes des dégradations résiduelles et de la vulnérabilité des eaux. Les bonnes pratiques d’une gestion durable des eaux en ville.
Informations complémentaires
- jmfriaud@free.fr
-
INSA Lyon - Amphithéâtre Emilie du Châtelet - Bibliothèque Marie Curie - Villeurbanne
Mots clés

INSA Lyon
« Formons tous les étudiants aux enjeux climatiques » : l'appel de 80 dirigeants d'établissements
Plus de 80 dirigeants d’établissements et 1.000 enseignants et chercheurs, en tête d’une liste de quelque 7.500 signataires, lancent un appel à l’Etat pour qu’il "initie une stratégie de transition de l’enseignement supérieur positionnant le climat comme l’urgence première".
- [En lire plus] : https://www.lejdd.fr/Societe/exclusif-formons-tous-les-etudiants-aux-enjeux-climatiques-lappel-de-80-dirigeants-detablissements-3919612

INSA Lyon
Urgence climatique : universités et grandes écoles mobilisées aux côtés des étudiants pour la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable
TRIBUNE

Nous avons une immense responsabilité envers les générations présentes et futures
Limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C et maintenir la biodiversité impliquent des changements très profonds de nos modes de production et de consommation, d’organisation des espaces urbains et des mobilités, de conception des infrastructures, d’organisation du travail dans le temps et l’espace. Nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nos consommations d’énergie, d’eau et de matières premières, et déployer une économie circulaire à grande échelle. Nous avons une immense responsabilité collective envers les générations présentes et futures, celle d’engager, sans plus attendre, les nécessaires transformations, dont l’ambition doit être à la hauteur des enjeux.
Le rôle central de nos établissements et de la communauté des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche doit être affirmé : par nos expertises, tant dans les sciences dites « dures », que dans les domaines technologiques ou les sciences de gestion et les sciences humaines et sociales, nous expliquons les phénomènes, mesurons leurs conséquences et proposons des solutions. Nous éclairons l’avenir.
Les universités, les organismes de recherche et les grandes écoles ont un devoir d’exemplarité
Nos travaux de recherche irriguent nos enseignements. Nous formons de futurs décideurs, les futurs acteurs de l’économie et de la société. Nous avons le devoir de les préparer à porter l’indispensable transformation, à savoir mesurer l’impact de leurs actions et décisions sur l’ensemble des parties prenantes et à agir en conséquence, en acteurs responsables.
Nous pouvons, nous devons, montrer la voie dans notre propre communauté. Les universités, organismes de recherche et les grandes écoles, ont vocation à devenir les démonstrateurs de solutions innovantes pour les transitions écologique, sociale et économique sur les territoires.
Nous, scientifiques, enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants, personnels administratifs et présidents ou directeurs d’établissement, mobilisons nos forces depuis plusieurs années autour des enjeux de développement durable et de responsabilité sociétale. L’enseignement supérieur français, comme nul autre en Europe, s’est structuré en réseaux d’acteurs aux côtés de la CPU, de la CGE pour produire des outils, de la connaissance et partager des solutions afin d’engager les établissements et tout leur écosystème dans une démarche vertueuse au service du développement durable et de la prise de responsabilité sociétale.
Un engagement collectif qui demande à être soutenu par l’État
Il faut changer d’échelle et aller plus vite dans cette voie, les étudiants nous y invitent avec force, mais nous ne pouvons le faire seuls. Nous, CPU, CGE et CDEFI, appelons l’Etat à un soutien politique qui se traduise par un engagement solennel reconnaissant le rôle essentiel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans la lutte contre le changement climatique et plus globalement la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD).
Cet engagement solennel, essentiel, restera vain s’il n’est accompagné de moyens identifiés tant pour la recherche, que pour l’enseignement ou la transformation de nos infrastructures, et inscrits dans la durée. Il faut aussi encourager la collaboration de tous les acteurs dans les territoires et engager systématiquement les étudiants à conduire des projets à fort impact sociétal dans nos établissements en partenariat avec les collectivités territoriales.
L’urgence est aujourd’hui climatique. Nous allons poursuivre, développer et amplifier notre engagement
« systémique » et interdisciplinaire autour des défis liés à cet enjeu. La formation tout au long de la vie, l'innovation – y compris l'innovation sociale – et la recherche sont indispensables à l'examen et à la compréhension des phénomènes, ainsi qu’à l'identification des solutions possibles. Elles contribuent à l'élévation générale des connaissances et à la prise de conscience des enjeux sociétaux, elles sont porteuses de réponses positives.
Co-construire une stratégie et la doter de moyens permettant de les atteindre
Nous, CGE, CPU et CDEFI, nous engageons à contribuer activement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable tels que définis par les Nations Unies et nous demandons aux ministères d’en démultiplier l’impact, en co-construisant une stratégie et en la dotant de moyens permettant de les atteindre. Nous avons déjà préparé le terrain de l'Université du futur. Rejoignez-nous dans sa construction au service de l’humanité et de la planète qui l’accueille.
Anne-Lucie Wack, Présidente de la CGE
Gilles Roussel, Président de la CPU
Jacques Fayolle, Président de la CDEFI
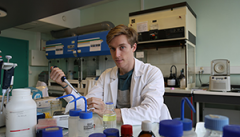
Recherche
Justin Maire : « je veux sauver la Grande Barrière de corail »
Visible depuis l’espace, elle est à la base d’un écosystème merveilleux sur lequel repose 25% de la vie marine et la subsistance de milliards d’individus. Et pourtant, elle meurt un peu plus chaque jour. La Grande Barrière de corail, véritable poumon de l’océan, subit depuis une trentaine d’années les conséquences du changement climatique. En cause, le réchauffement des océans qui entraîne un stress du corail qui rejette l’algue symbiotique lui permettant de se nourrir.
Justin Maire, ingénieur et docteur INSA Lyon s’est envolé pour l’Australie il y a quelques mois, dans le cadre d’un post-doctorat. Au sein de l’Université de Melbourne, il travaille à optimiser les bactéries symbiotiques de la plus grande structure vivante du monde. Rencontre et explications.
 Sur Terre, le réchauffement climatique est souvent et seulement envisagé comme l’augmentation de la température de l’air d’un ou deux degrés. Cependant, environ 90% de la chaleur produite en surface est récupérée par les océans et l’on considère que sans ce phénomène, la température sur terre avoisinerait les 50°C.
Sur Terre, le réchauffement climatique est souvent et seulement envisagé comme l’augmentation de la température de l’air d’un ou deux degrés. Cependant, environ 90% de la chaleur produite en surface est récupérée par les océans et l’on considère que sans ce phénomène, la température sur terre avoisinerait les 50°C.
« Pour la vie marine, ça n’a rien de l’air de vacances sous les tropiques. Les coraux vivent dans des milieux relativement pauvres. La majorité de leurs apports nutritifs repose sur de minuscules algues symbiotiques qui vivent dans leurs tissus, et les alimentent à travers la photosynthèse. Quand l’eau dépasse les 31°C, l’activité de ces algues symbiotiques est perturbée et l’animal les rejette. En expulsant l’algue qui lui permet de vivre, il est privé de nutriments et finit par mourir. C’est un peu comme chez l’Homme : lorsque notre corps a de la fièvre causée par une bactérie par exemple, il tente de s’en débarrasser », explique Justin Maire.
En trente ans, les océans ont vu la moitié de leurs coraux s’habiller de différentes couleurs, du blanc éclatant, en passant par des couleurs fluorescentes jusqu’au vert-gris.
« Le phénomène de blanchissement des coraux est assez impressionnant. En rejetant l’algue, qui confère aux coraux leur couleur naturelle, le corail devient alors translucide et la couleur blanche de son squelette est perçue. C’est très beau, mais c’est l’annonce de sa mort. Puis, la surface du squelette se recouvre d’algues filandreuses, et à ce moment, l’animal est mort. » 
© Chasing Coral
En Australie, la barrière corallienne s’étend sur 2300 kilomètres, concentrant plus de 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons et 4000 espèces de mollusques. À Melbourne, Justin Maire et son équipe tentent de créer des « super-coraux » qui résisteraient au réchauffement et aux variations de températures.
« Mon projet est d’optimiser les bactéries symbiotiques des coraux. D’abord en utilisant des probiotiques, ce qui sous-entend designer un cocktail de bactéries symbiotiques qui amélioreraient naturellement la résistance thermique de l’animal, puis, plus tard, modifier la génétique de ces bactéries pour améliorer encore davantage la résistance des coraux. Jouer sur les bactéries symbiotiques permet une plus grande flexibilité et manipulabilité que si l’on travaillait directement sur le patrimoine génétique du corail. »
Ingénieur diplômé du département Biosciences et ancien doctorant du laboratoire BF2i1 de l’INSA Lyon, Justin travaille sur les bactéries pathogènes et symbiotiques en interaction avec les animaux. fsubt

« Les coraux sont des êtres-vivants dont nous ne connaissons pas encore toutes les subtilités et les fonctionnements. Mon travail de recherche consiste aussi à comprendre les interactions entre le corail et ses partenaires symbiotiques, algues et bactéries. C’est, encore une fois, un peu comme chez l’Homme : notre corps évolue avec des milliards de bactéries et pourtant, il n’est pas en inflammation constante. Ces bactéries-là se disent « symbiotiques », puisqu’elles vivent en harmonie avec le reste de notre corps. Et parfois, notre système immunitaire rencontre une bactérie dite « pathogène » qui perturbe la symbiose. Pour le corail, on est dans la même situation. Quand sa relation avec son algue symbiotique est bouleversée, l’algue est en quelque sorte considérée comme « pathogène » par le corail, et son immunité réagit. Cependant, des températures aussi élevées ne font pas partie de son cycle naturel et il n’a jamais fait face à un tel stress. Son système immunitaire est seulement capable de « soigner » le corail en rejetant la partie qui dysfonctionne, c’est-à-dire les algues symbiotiques. Mais dans le cas des coraux, ce qui dysfonctionne, c’est aussi ce qui les nourrit. Nos travaux se concentrent alors sur ces minuscules algues dont dépend la vie du corail : comment réagissent-elles au stress thermique ? quels sont les mécanismes à l’origine de leur expulsion par les coraux ? comment l’ajout de probiotiques pourrait atténuer ce phénomène ? Il a notamment été montré que le traitement des coraux avec des antioxydants pouvait limiter leur blanchissement. Nos premières pistes se portent ainsi sur des bactéries capables de naturellement produire de telles molécules et qui viendraient donc en aide aux algues symbiotiques lors d’un stress thermique. »
Les travaux de recherche sur les récifs coralliens impliquent une course contre la montre. Dans trente ans, on estime la totalité des coraux de l’océan morts, ainsi que la disparition d’écosystèmes entiers qui reposent sur ces récifs. Si le projet de Justin Maire n’en est qu’à ses débuts, le jeune chercheur reste conscient de l’ampleur de la tâche et ne nie pas la pression environnementale et sociétale liée à l’urgence de la situation.
« Ici, chaque été, le bilan tombe et c’est très dur. On se dit ‘un an de moins’ ou ‘est-ce qu’on va y arriver ?’. On se lance dans ces recherches tout en étant conscients que ce sont des travaux risqués et que la mise en pratique sera longue et fastidieuse si elle est viable. Mais plus je m’approprie le sujet, plus je prends conscience du pouvoir de mon rôle de chercheur sur la planète. Aujourd’hui, on débroussaille, mais si ça fonctionne, on sauve la Barrière de corail avec des bactéries, et cette idée pousse ma détermination encore plus loin. »
1Biologie Fonctionnelle Insectes et Interactions, INSA Lyon/INRA
Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 4 - 27 mai 2021


