
Entreprises
« Le changement climatique ne doit pas être une bataille d’idées politiques »
Vincent Bryant, diplômé de l’INSA Lyon en 2006, a co-fondé « Deepki ». Décrite comme une « pépite de la green-tech », elle veille à accompagner les acteurs du bâtiment dans leur transition énergétique. Déjà engagé sur la question climatique pendant ses années d’études, l’ingénieur informatique n’a jamais renoncé à son goût « de l’impact ». Que ce soit en co-fondant l’association « Avenir Climatique » avec Jean-Marc Jancovici ou en lançant une entreprise capable de lever 150 millions d’euros pour poursuivre son développement, Vincent voit loin et large. Entretien avec un ingénieur qui nourrit de grandes ambitions sur la transition environnementale.
Votre entreprise vient de lever 150 millions d’euros pour poursuivre son expansion à l'international. Comment accompagne-t-elle le secteur immobilier ?
L’immobilier génère 37 % des émissions globales de CO2 dans le monde. Aujourd’hui, les grands acteurs détenteurs de foncier connaissent le potentiel de la data pour accélérer la transition énergétique de leurs bâtiments, mais seuls, ils ne peuvent pas y parvenir. Pour aller vers un objectif « net zéro », les acteurs du secteur ont besoin d’être accompagnés dans leur prise de décision : faut-il isoler, rénover, reconstruire, vendre... À travers une plateforme logicielle, nous analysons les données de leurs bâtiments, nous les aidons à construire des plans d’actions et à mesurer les impacts. Nous sommes dans une démarche d’économie « à impact positif » ; notre mission est de préserver la planète en rendant l’immobilier moins lourd en matière de consommation énergétique, grâce à la data.
Deepki fait partie de cette frange, croissante, d’entreprises innovantes qui conjuguent écologie et numérique. Pensez-vous que les technologies soient réellement capables de sauver la planète ?
Toutes seules, non. Est-ce qu’elles peuvent aider ? Oui. « Science sans conscience, n’est que ruine de l’âme », a écrit Rabelais. Je suis dans cet état d’esprit. Par exemple, Deepki est résolument une entreprise « high-tech », mais elle est aussi promotrice de la low-tech. Les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Si l’on prend l’exemple de la transition énergétique, il y a de nombreuses façons de réduire les impacts qui ne nécessitent pas de technologies mais seulement un peu d’imagination. Je me souviens d’un client qui avait eu l’idée, pour inciter les utilisateurs à prendre les escaliers, de disséminer la réponses à des devinettes le long des marches. Alors évidemment, l’appât ne fonctionne que deux ou trois fois avec le même usager qui cherche à obtenir les réponses, mais c’est une façon d’encourager les bonnes pratiques sans l’ombre d’une technologie. Il y a de plus en plus de réflexions de ce genre qui émergent dans ce sens et c’est une bonne chose. Je ne crois pas que la technologie soit une réponse universelle pour agir sur les changements climatiques, mais si elle est mise en regard des besoins et du contexte, elle peut nous aider.
Vous êtes diplômé du département informatique. Comment votre parcours vous a-t-il amené de l’informatique à la transition énergétique de l’immobilier ?
J’ai des parents qui étaient déjà un peu écolos et conscients du problème. Lorsque j’étais étudiant à l’INSA, j’ai découvert les travaux de Jean-Marc Jancovici et je me suis pris de passion pour le sujet de la transition énergétique. À cette époque, j’avais même négocié avec la direction de la formation de l’INSA pour suivre les cours de génie énergétique et environnement en parallèle de mes cours de IF. Depuis mes études, j’avais cette idée d’utiliser l’informatique pour avoir un impact sur l’énergie et le climat. Quant à l’immobilier, je l’ai découvert lors de mes différentes expériences professionnelles, chez Engie notamment. Je travaillais sur tous types d’actifs, notamment sur ceux qui avaient des empreintes carbone lourdes. C’est le besoin d’avoir un impact qui m’a guidé à vouloir « massifier » cet effort de transition pour le secteur immobilier.
Étudiant, vous étiez déjà très engagé dans la cause environnementale. D’abord à l’INSA Lyon, en tant que membre du bureau de l’association « Objectif 21 », puis plus tard, lorsque vous fondez « Avenir Climatique » et contribuez au lancement du REFEDD1. L’associatif est-il une façon d’agir pour le climat ?
À l’époque de mes années étudiantes, j’y crois. Je suis persuadé que l’associatif est capable de former les gens, apporter du changement et de l’exemplarité. Je me souviens qu’avec Objectif 21, nous avions lancé un « concours innovation climat ». L’une des solutions proposées était de réduire la consommation de viande avec des repas végétariens pour les restaurants de l’école. L’idée, qui avait séduit le jury, a pu être mise en place dans les années suivantes et subsiste encore aujourd’hui ! Avec « Avenir Climatique », il s’agissait d’introduire les notions climatiques dans les enseignements pour que les diplômés sortent de l’école avec les bons ordres de grandeurs en tête. En grandissant, j’ai compris les limites de l’associatif : j’ai souvent été gêné par le mélange des genres, avec les idées politiques. Le changement climatique est un projet factuel et scientifique. Ça ne doit pas être une bataille d’idées. J’ai aussi fait de la politique, un peu tous les partis sauf les extrêmes. Et là aussi, c’était très décevant en matière d’action.
Quels conseils donneriez-vous aux élèves-ingénieurs qui auraient envie de s’orienter vers un « métier à impact » ?
Je m’en remettrais au précieux conseil de Jean-Marc Jancovici : formez-vous ! Suivez vos cours, réfléchissez et faites les choses comme vous le sentez. C’est à vous de choisir la barque dans laquelle vous souhaitez monter. J’aime bien l’image de Nicolas Hulot, avec le syndrome du Titanic. Il y a ceux qui restent dans les estafettes et qui pointent du doigt l’iceberg en criant « attention »; et puis il y a ceux qui décident de monter dans le bateau pour aller convaincre que l’iceberg représente un réel danger. Est-ce que vous êtes prêt à faire partie du système ou préférez-vous rester en dehors de celui-ci ? C’est une question fondamentale d’approche, d’ordre philosophique. Il n’y a pas de bonne réponse, chacun doit pouvoir aller là où il veut pour agir.
[1] : Réseau Français Étudiant pour le Développement Durable, aujourd’hui RESES (Réseaux Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire)

Formation
« Les civic tech permettent d’éclairer le débat public, mais elles ne sont pas neutres »
Réconcilier les jeunes avec le vote grâce à une application mobile : telle est l’objectif de l’application « Elyze », surnommée dans la presse « le tinder électoral ». L’application invite l’utilisateur à balayer l’écran sur la gauche ou la droite en fonction des propositions politiques affichées. Après avoir répondu à une centaine de questions, un classement apparaît : une liste de personnalités politiques avec lesquelles il partage des convictions.
« Elyze », si elle fait partie des applications les plus téléchargées ces dernières semaines, n’a pas fait parler d’elle pour cette unique raison. Lorsque Mathis Hammel, diplômé du département informatique de l’INSA Lyon, met le nez dans le code informatique, il découvre des failles. De sécurité, d’abord, puisqu’il arrive à hacker l’application ; puis un manquement de protection sur les données des utilisateurs. L’ingénieur, habitué à vulgariser ses trouvailles informatiques sur son fil Twitter, a lancé un pavé dans la mare. Un pavé, oui. Mais un pavé citoyen car « le dossier Elyze » soulève à l’approche des élections présidentielles, un enjeu de sécurité majeur sur les « civic tech », ces outils technologiques qui œuvrent pour une participation citoyenne augmentée.
Vous avez mis en lumière des failles importantes sur l'une des applications les plus téléchargées en France ces dernières semaines. Que soupçonniez-vous ?
J’ai d’abord été intrigué par l’écriture de l’algorithme : comment l’application choisit-elle le candidat qui « matche » le plus avec l’utilisateur ? En cas de résultat ex-aequo, comment le candidat qui s’affiche en premier est-il choisi par rapport à l’autre ? Comme le programme n’était pas librement accessible à l’époque, il fallait utiliser des outils spécialisés pour déchiffrer le programme informatique. Le premier problème s’est révélé : les informations personnelles que chaque utilisateur avait rempli à leur première connexion, comme le lieu de résidence, le genre et la date de naissance étaient collectées à des fins commerciales. Ces données auraient sans doute intéressé la plupart des partis politiques pour mener leurs campagnes… On se souvient du scandale de l’entreprise Cambridge Analytica1 ! L’autre faille concernait la sécurité du contenu. J’ai réussi en quelques coups de clavier à modifier l’une des propositions politiques qui s’affichaient à l’écran.
Même si l’application ne prétend pas vouloir influencer les votes, il est facile d’imaginer que la plupart des utilisateurs voteront pour le candidat qui est apparu en premier. Les « civic tech » sont des outils très intéressants pour éclairer le débat public et engager le citoyen, mais elles ne sont pas neutres. Il était important de se pencher sur le cas de l’application Elyze, téléchargée plus d’un million de fois.

Un classement s’effectuait dans la première version
de l’application malgré des résultats ex-aequo
Depuis le partage de votre découverte sur Twitter, les créateurs d’Elyze ont suivi vos recommandations et ont même été audités par la CNIL2. Votre intrusion a-t-elle permis d’éviter le pire ?
On peut dire que l’opération a porté ses fruits. Mon tweet a interpellé beaucoup de gens, obligeant les développeurs à modifier leur algorithme et à publier le code en open source. Je pense que les créateurs ont été surtout été dépassés par le succès de leur app, d’où la moyenne maîtrise des questions légales en matière de protection des données. Le dialogue avec la CNIL a permis de mettre de l’ordre dans l’aspect juridique et technique ; nous pouvons maintenant utiliser l’application l’esprit un peu plus tranquille !
Aujourd’hui, il est si facile de lancer une application et de la mettre à disposition de tous. Pourtant, personne ne vérifie réellement la mise en conformité juridique de chaque application, n’est-ce pas ?
Les magasins d’applications font ce qu’ils peuvent au quotidien, en vérifiant que les applications disponibles ne contiennent pas de virus. Les créateurs ont l’entière responsabilité de ce qu’ils publient ; ils doivent être en conformité avec les lois, notamment celles qui caractérisent la manière de gérer les données. Dans les faits, les créateurs d’applications doivent faire leur propre audit et c’est ici qu’est le problème. Pour certains types d’application, le risque est moindre, mais lorsqu’on parle d’outils qui touchent le fonctionnement démocratique comme Elyze, les enjeux dépassent la simple utilisation de l’appli. J’espère que cette expérience avec Elyze permettra d’en tirer des leçons pour l’avenir des civic tech. La législation laisse encore des zones grises lorsqu’il s’agit de numérique et la façon dont j’ai découvert les failles d’Elyze en est un exemple, même si mon intention n’est pas de causer du tort non-mérité, mais d’alerter. C’est d’ailleurs, pour cette raison que je m’applique à vulgariser ce que je trouve.
Hier soir, j'ai découvert un problème de sécurité sur l'app Elyze (numéro 1 des stores en France cette semaine) qui m'a permis d'apparaître comme candidat à la présidentielle sur le téléphone de plusieurs centaines de milliers de français.
— Mathis Hammel (@MathisHammel) January 15, 2022
Je vous explique ce qui s'est passé ⤵️ pic.twitter.com/0a4LqZUPjL
Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, notamment pour sensibiliser le grand public à la cybersécurité. Vous êtes également communicant au sein de l’entreprise pour laquelle vous travaillez, CodinGame. Partager son savoir est une mission d’intérêt public pour vous ?
Cela fait plusieurs mois que j’essaie de partager ce que je comprends au grand public. Tout a commencé par un premier tweet qui a eu beaucoup de succès : j’avais réussi à reconstituer un pass sanitaire à partir d’une photo, celui de Jean Castex entre autres. Puis la sauce a pris et j’essaie de m’astreindre à poster régulièrement. À travers les réseaux sociaux, mon but est surtout d’informer sur des sujets d’actualité pour permettre aux internautes de mieux comprendre la société numérique dans laquelle ils vivent.
Du côté de CodinGame, nous nous adressons à des experts, en proposant des entraînements pointus à la programmation. L’informatique évolue si vite qu’elle oblige les professionnels à se maintenir à jour des nouveautés techniques, souvent en autodidacte. La culture du partage de connaissances est assez forte dans la communauté informatique. Je me souviens de mes années à l’INSA, où après les cours, nous continuions à coder, programmer, déchiffrer avec mes copains de classe. J’ai beaucoup appris de ces années de vie associative qui réunissait des gens passionnés par la même chose que moi. Ça avait une autre saveur que d’apprendre seul dans sa chambre, derrière son ordinateur.
1 La société Cambridge Analytica avait exploité en 2014 les données personnelles des utilisateurs Facebook américains. Ces informations ont servi à influencer les intentions de vote en faveur d’hommes politiques.
2 Commission nationale de l’informatique et des libertés
Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 1 - 7 avril 2021

Formation
« Il faut dépasser les idées reçues sur les sciences informatiques »
En ce début d'année, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Sara Bouchenak, enseignante-chercheure au laboratoire LIRIS1 et au département informatique de l'INSA Lyon. Désormais à la tête de la fédération d'informatique de Lyon, Sara est bien déterminée à faire travailler ensemble les équipes des cinq laboratoires2 de la structure pour construire l'informatique de demain. Interview.
Vous prenez aujourd'hui la tête de la fédération lyonnaise d'informatique. Quels sont les grands enjeux de cette discipline ?
Il me semble que l'informatique est assez méconnue en tant que science. C'est une discipline transverse dont découlent de nombreux métiers, et dans un monde qui n'arrive plus à se passer du numérique, elle a un rôle à jouer. De la cybersécurité à la gestion des données, en passant par l'impact environnemental du numérique, il y a encore beaucoup à inventer en la matière. L'informatique doit aujourd'hui se positionner en réponse aux problématiques de la société. Et les défis sont proportionnels à la vitesse de développement du numérique, c'est-à-dire, exponentiels. À l'époque où j'ai débuté, il y a vingt ans, les navigateurs web commençaient tout juste à se démocratiser, alors c'est dire si le domaine a rapidement évolué ! Enfant, je n'étais pas fan de programmation et je n'étais pas du genre à inventer des algorithmes, enfermée dans ma chambre. Ce qui m'a amené à cette matière, ce sont les mathématiques. Il me semble que c'est aussi un autre enjeu important pour la discipline : il faut dépasser les idées reçues sur les sciences informatiques.
Aujourd'hui, l'informatique fait partie de ces spécialités qui semble attirer assez peu de filles. À quoi cela est dû à votre avis ?
À mon sens, ceci est lié à nos représentations de l'informatique et de celles et ceux qui la font. Je m'explique. Filles ou garçons, les élèves ont souvent une idée préconçue de cette discipline. Les stéréotypes autour de l'ingénieur informaticien sont légions, proches du cliché du « geek » mordu de jeux vidéo. Et je dois bien avouer que ça ne fait peut-être pas rêver ! Nous manquons par ailleurs de représentations féminines dans le domaine. Nous sommes peu de femmes au sein des structures d'enseignement, de recherche et dans le monde professionnel de l'informatique. J'imagine qu'il est difficile pour une jeune fille de se projeter dans un métier lorsqu'elle n'a que peu de modèles féminins. Il y a probablement une forme d'autocensure chez les étudiantes, car elles sont près de 50% en première année de formation. Mais ce n'est pas une fatalité. D'ailleurs, les chiffres au sein du département informatique sont extrêmements encourageants, si elles étaient seulement 15% il y a quelques années, elles sont à présent 38 % de filles à intégrer cette spécialité en 3e année. Ceci grâce aux actions menées conjointement par l'Institut Gaston Berger et la commission femmes et informatique du département.
Comment lutter contre cette forme d'autocensure dont vous parlez ? Votre nouvelle fonction de présidente de la fédération d'informatique de Lyon vous permettra-t-elle d'agir plus largement ?
En tant qu'enseignante-chercheure, mon rôle est de promouvoir les formations et les métiers du numérique auprès des jeunes générations. Trop peu de jeunes filles choisissent l'informatique mais c'est en leur expliquant et leur apprenant ce qui se cache derrière le mot informatique que les stéréotypes pourront tomber. Il y a un certain nombre d'initiatives pour faire bouger les lignes et attirer les femmes dans le numérique. L'Institut Gaston Berger, par exemple, participe à la déconstruction des idées reçues, en accueillant chaque année des lycéennes pour leur faire découvrir ces sciences et aller au-delà des représentations classiques plutôt genrées. Et en tant que présidente de la fédération, j'aimerais créer une commission égalité pour veiller à une juste représentation des femmes et des hommes au sein de nos laboratoires. Lutter contre cette autocensure est un travail de longue haleine, qui doit être abordé à chaque étape de la vie étudiante et professionnelle pour permettre à chacune d'oser se lancer.
1 Laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information (INSA Lyon/Lyon 1/Lyon 2/ECL/CNRS)
2 CITI (INSA Lyon/INRIA), LabHC (Université Jean-Monnet/CNRS), LIP (ENS Lyon/CNRS/UCBL) et LIRIS (INSA Lyon/Lyon 1/Lyon 2/ECL/CNRS), CREATIS (INSA Lyon/Lyon 1/CNRS/Inserm/UdL/UJM)

Recherche
« I CARE » fera le ménage dans l’espace
Les débris orbitaux : une question qui inquiète de plus en plus les experts du spatial. Satellites inopérants, boulons, moteurs errants… Les déchets gravitant en orbite se déplacent si vite qu’ils peuvent causer des dommages sans précédent lorsqu’ils rentrent en collision avec d’autres satellites.
Clara Moriceau (INSA Rouen Normandie, Génie Mathématique 2019), Manuel Amouroux (INSA Lyon, Génie Informatique 2019) et Anthony De La Llave (INSA Rouen Normandie, Génie Mathématique 2016) sont trois ingénieurs récemment diplômés. Ils poursuivent actuellement leurs études en mastère spécialisé à l’ISAE-Supaero de Toulouse et ont remporté l’une des trois places du concours « Parabole » organisé par le Centre National d’Études Spatiales (CNES) grâce à leur système de capture, « I CARE ». Explications.
Des orbites encombrées
135 millions d’objets de 1mm ou plus1 : c’est le nombre vertigineux de débris qui errent dans l’espace. Situés majoritairement en orbite basse (entre 700 et 1000 km d’altitude) et en orbite géostationnaire (à 36 000 km d’altitude), les débris spatiaux mettent en péril les engins actifs. En raison de la vitesse à laquelle ils se déplacent, mêmes les plus petits sont capables de faire exploser un satellite en mission, générant à leur tour de nouveaux débris. Une réaction en chaîne dangereuse pour les engins actifs en orbite, pour les stations abritant des astronautes et à fortiori, pour certaines zones de la terre qui voient retomber les débris qui n’auraient pas été désintégrés lors de leur retour dans l’atmosphère. « La  problématique de l’encombrement spatial ne date pas d’hier. Elle existe depuis que l’homme envoie des satellites dans l’espace. Cependant, elle s’est accentuée avec la prolifération de nano satellites, appelés CubeSats. Ces engins miniatures, simples et peu coûteux à fabriquer, permettent de tester des instruments, réaliser des expériences scientifiques, développer des initiatives commerciales ou des projets éducatifs. Mais une fois inopérants, ils continuent d’envahir l’espace, menaçant la sécurité et la viabilité d’autres missions spatiales. L’enjeu des outils de capture est d’anticiper les déplacements de ces débris errants à une vitesse allant jusqu’à 28 000 km à l’heure puis de les attraper », explique Manuel Amouroux.
problématique de l’encombrement spatial ne date pas d’hier. Elle existe depuis que l’homme envoie des satellites dans l’espace. Cependant, elle s’est accentuée avec la prolifération de nano satellites, appelés CubeSats. Ces engins miniatures, simples et peu coûteux à fabriquer, permettent de tester des instruments, réaliser des expériences scientifiques, développer des initiatives commerciales ou des projets éducatifs. Mais une fois inopérants, ils continuent d’envahir l’espace, menaçant la sécurité et la viabilité d’autres missions spatiales. L’enjeu des outils de capture est d’anticiper les déplacements de ces débris errants à une vitesse allant jusqu’à 28 000 km à l’heure puis de les attraper », explique Manuel Amouroux.
Identifier et capturer
 Pour faire le grand ménage dans l’espace, des solutions sont développées par les experts : filets de capture, harpons magnétiques, satellites autodestructibles, etc. Cependant, ces systèmes visent généralement les débris de grande taille. Dans le cadre du concours organisé par le CNES, Manuel, Clara, Anthony et leur équipe ont concentré leurs efforts sur la capture des CubeSats gravitant en orbite basse. « Notre projet se matérialise par un bras robotisé muni de deux systèmes de captures interchangeables : une pince ou un électro-aimant. « I CARE », dont le nom signifie Identification & Capture for Active debris Removal Experiment, devra être complémentaire aux autres solutions déjà existantes comme la capture par filet par exemple, tout en s’intégrant aux plateformes standards déjà existantes. Notre prototype nettoyeur nous met face à deux défis : celui de designer un système capable de capturer des petits débris et celui de développer un algorithme d’intelligence artificielle qui sera entraîné à identifier le mouvement et anticiper les déplacements de l’objet », poursuit Clara Moriceau.
Pour faire le grand ménage dans l’espace, des solutions sont développées par les experts : filets de capture, harpons magnétiques, satellites autodestructibles, etc. Cependant, ces systèmes visent généralement les débris de grande taille. Dans le cadre du concours organisé par le CNES, Manuel, Clara, Anthony et leur équipe ont concentré leurs efforts sur la capture des CubeSats gravitant en orbite basse. « Notre projet se matérialise par un bras robotisé muni de deux systèmes de captures interchangeables : une pince ou un électro-aimant. « I CARE », dont le nom signifie Identification & Capture for Active debris Removal Experiment, devra être complémentaire aux autres solutions déjà existantes comme la capture par filet par exemple, tout en s’intégrant aux plateformes standards déjà existantes. Notre prototype nettoyeur nous met face à deux défis : celui de designer un système capable de capturer des petits débris et celui de développer un algorithme d’intelligence artificielle qui sera entraîné à identifier le mouvement et anticiper les déplacements de l’objet », poursuit Clara Moriceau.
Apprivoiser l’apesanteur
Dans le cadre du concours organisé par le CNES, les étudiants ont été sélectionnés pour tester leur prototype à bord du véhicule de la filiale Novespace, l’avion Zéro G. « Nous avons présenté un rapport technique de notre prototype qui a séduit le jury du CNES. La prochaine étape visera à améliorer la fiabilité de l’engin en vue du vol à bord de l’avion Zéro G. C’est un véhicule qui permet de 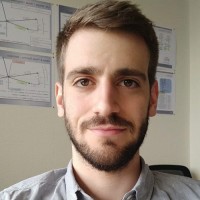 reproduire l’absence de pesanteur en décrivant des trajectoires paraboliques. En chute libre, l’apesanteur est sensiblement la même que dans l’espace (0.02g), comme le vivent les astronautes à bord de l’ISS, la Station Spatiale Internationale. Tester notre prototype dans ces conditions nous permettra d’entraîner l’algorithme à identifier le mouvement et la vitesse d’un CubeSat et vérifier la robustesse de nos pinces. Rendez-vous en octobre 2020 sur le tarmac de Bordeaux-Mérignac pour la suite ! », conclut Anthony De La Llave.
reproduire l’absence de pesanteur en décrivant des trajectoires paraboliques. En chute libre, l’apesanteur est sensiblement la même que dans l’espace (0.02g), comme le vivent les astronautes à bord de l’ISS, la Station Spatiale Internationale. Tester notre prototype dans ces conditions nous permettra d’entraîner l’algorithme à identifier le mouvement et la vitesse d’un CubeSat et vérifier la robustesse de nos pinces. Rendez-vous en octobre 2020 sur le tarmac de Bordeaux-Mérignac pour la suite ! », conclut Anthony De La Llave.
1Source (2017) : CNES

Formation
Félicitations à Olivier Brourhant !
Olivier Brourhant vient d’être élu Entrepreneur suisse de l’année 2016 par EY ! Portrait d’un ingénieur INSA Lyon diplômé du département Informatique en 1996, fondateur et PDG d’Amaris, groupe suisse de conseil en systèmes d’informations et organisation, né il y a 10 ans à peine.


