
Vie de campus
5 choses à savoir sur l’INSA Lyon
Un modèle INSA pionnier
 En créant l’INSA avec Jean Capelle en 1957, Gaston Berger sortait des sentiers battus. Le modèle de formation était inédit : mêler disciplines scientifiques, techniques et sciences humaines, rendre les études d’ingénieur accessibles à toutes et tous avec des frais de scolarité réduits… Gaston avait pensé une école nouvelle, lui qui croyait en la capacité d’évolution positive et en la curiosité intellectuelle de chacun. Pour lui, les choses étaient claires : il fallait adopter une attitude « prospective », tournée vers l’avenir. En imaginant l’INSA, il l’a voulu capable d’apporter des réponses contemporaines aux enjeux de société. Et depuis, l’INSA a formé plus de 90 000 ingénieurs sur ses 7 campus différents !
En créant l’INSA avec Jean Capelle en 1957, Gaston Berger sortait des sentiers battus. Le modèle de formation était inédit : mêler disciplines scientifiques, techniques et sciences humaines, rendre les études d’ingénieur accessibles à toutes et tous avec des frais de scolarité réduits… Gaston avait pensé une école nouvelle, lui qui croyait en la capacité d’évolution positive et en la curiosité intellectuelle de chacun. Pour lui, les choses étaient claires : il fallait adopter une attitude « prospective », tournée vers l’avenir. En imaginant l’INSA, il l’a voulu capable d’apporter des réponses contemporaines aux enjeux de société. Et depuis, l’INSA a formé plus de 90 000 ingénieurs sur ses 7 campus différents !
Avant l’INSA, il y avait des bœufs, des moutons et l’armée
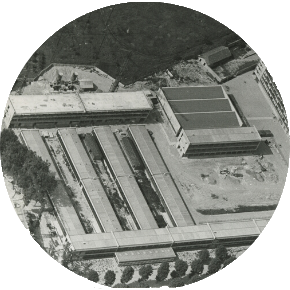 « Au départ ce n’était qu’un grand pré. Une centaine d’hectares situés en bordure du Rhône, où les paysans menaient paître leurs bœufs et leurs moutons. Puis vinrent les militaires. »
« Au départ ce n’était qu’un grand pré. Une centaine d’hectares situés en bordure du Rhône, où les paysans menaient paître leurs bœufs et leurs moutons. Puis vinrent les militaires. »
Avant 1957, le terrain, appelé « Le Grand Camp » consistait en de vastes prés communaux. Trois institutions se partageaient l’espace : l’armée, la société hippique de Lyon, et les PTT qui exploitaient l’émetteur de radiodiffusion. Pour la première rentrée en 1957, il fallait construire les premiers bâtiments qui accueillaient une promotion de 300 élèves. La mission avait été confiée à Jacques Perrin-Fayolle, architecte lyonnais et Premier Grand Prix de Rome. Il a imaginé le campus comme « un groupement autonome », où les étudiants devaient y trouver sur place tout le nécessaire : enseignement, logement, restaurant, bibliothèque, sport et activités culturelles. Grâce à des ossatures béton et les principes industriels de l’époque, les premiers bâtiments avaient été livrés en un temps éclair.
L’emblème de l’INSA Lyon est un rhinocéros
 On compte dans le monde cinq espèces de rhinocéros, toutes menacées. Au cours des cinquante dernières années, leur nombre aurait diminué de 80%. Le rhino de l’INSA Lyon, planté à deux pas du bâtiment des Humanités, sous le vent, face à la neige ou écrasé par le soleil, lui, reste imperturbable. Le « rhino » coloré veille sur une pelouse verdoyante. Depuis 2003, cette figure est devenue l’emblème de l’école : rouge, vert fluo, à pois, à rayures ou en tenue de gala, il en voit de toutes les couleurs selon l’humeur des étudiants. Malmené, Il en a même un jour perdu sa corne. Depuis, les étudiants d’arts-plastiques études lui ont rendu, et lui ont même donné un petit frère, sur la pelouse du FIMI.
On compte dans le monde cinq espèces de rhinocéros, toutes menacées. Au cours des cinquante dernières années, leur nombre aurait diminué de 80%. Le rhino de l’INSA Lyon, planté à deux pas du bâtiment des Humanités, sous le vent, face à la neige ou écrasé par le soleil, lui, reste imperturbable. Le « rhino » coloré veille sur une pelouse verdoyante. Depuis 2003, cette figure est devenue l’emblème de l’école : rouge, vert fluo, à pois, à rayures ou en tenue de gala, il en voit de toutes les couleurs selon l’humeur des étudiants. Malmené, Il en a même un jour perdu sa corne. Depuis, les étudiants d’arts-plastiques études lui ont rendu, et lui ont même donné un petit frère, sur la pelouse du FIMI.
L’INSA Lyon renomme la moitié de ses bâtiments avec des noms de femmes
 L’INSA Lyon, déjà bien engagé sur les notions de problématiques de genre, a souhaité rebaptiser les bâtiments de son campus avec des noms de femmes scientifiques aux parcours d’excellence, car ce n’est pas parce qu’on ne les connaît pas, qu’elles n’existent pas ! Cette opération, au-delà de sa symbolique, revendique le droit des femmes à exister dans le paysage scientifique. Engagée depuis 2019, cette opération d’envergure offrira de nouveaux noms à la moitié des bâtiments du campus dans les années à venir.
L’INSA Lyon, déjà bien engagé sur les notions de problématiques de genre, a souhaité rebaptiser les bâtiments de son campus avec des noms de femmes scientifiques aux parcours d’excellence, car ce n’est pas parce qu’on ne les connaît pas, qu’elles n’existent pas ! Cette opération, au-delà de sa symbolique, revendique le droit des femmes à exister dans le paysage scientifique. Engagée depuis 2019, cette opération d’envergure offrira de nouveaux noms à la moitié des bâtiments du campus dans les années à venir.
Une capsule temporelle est enterrée sur le campus
 Une capsule temporelle a été enterrée sur le campus en 2007, pour le cinquantième anniversaire de l’INSA Lyon. Déposée au pied du « cure-dent », elle renferme des textes des étudiants et des personnels de l’établissement et se fera témoin d’une époque pour les générations futures. Rendez-vous en 2050 !
Une capsule temporelle a été enterrée sur le campus en 2007, pour le cinquantième anniversaire de l’INSA Lyon. Déposée au pied du « cure-dent », elle renferme des textes des étudiants et des personnels de l’établissement et se fera témoin d’une époque pour les générations futures. Rendez-vous en 2050 !

Formation
Former les élèves-ingénieurs à s’emparer des futurs souhaitables
L’ingénieur1 doit-il se contenter d’être le rouage d’un système qui étend les logiques d’exploitation et de marchandisation du monde ? Aujourd’hui, la représentation majeure de l’ingénieur ne peut plus être défini par le seul prisme d’une efficacité technique, posant l’Homme comme « maître et possesseur de la nature ». Désormais, comme pour beaucoup d’activités professionnelles, l’horizon de la fonction d’ingénieur se doit d’être repensé dans les limites planétaires.
Dans le cadre du chantier de l’évolution de la formation INSA, le groupe de travail « quels futurs possibles et souhaitables ? », s’est attelé à mettre en mots une vision répondant à la question suivante : comment amener les élèves-ingénieurs à retrouver la possibilité d’un futur souhaitable, quand le progrès scientifique et technique se heurte déjà aux limites physiques et humaines de notre planète ? À la convergence de la quête de sens des étudiants et celle d’un établissement dont la raison d’être est de former des individus conscients de leurs choix, il est nécessaire de construire une nouvelle dialectique et de nouveaux récits. Entretien avec quatre enseignants du groupe de travail.
L’ingénieur : un rouage dans un système
À travers son activité professionnelle, l’ingénieur alimente la construction et le développement de systèmes techniques qui s’imposent aux sociétés et aux écosystèmes. L’héritage de Descartes, par lequel l’Humain s’est posé en maître de son environnement, continue d’opposer l’Homme et la nature. L’urgence climatique et la quête de sens des individus tendent à remettre en question ce principe philosophique. « Dans notre système de société, basé sur l’exploitation et la marchandisation, il y a une difficulté croissante à contrôler le phénomène technique. Quand l’optimisation, la performance ou la production sont réduits à leur seule dimension technique, celui-ci peut souvent sentir lui échapper les conséquences de ses actions », introduit Romain Colon de Carvajal, enseignant en génie mécanique. Pourtant la technique, par les créations qu’elle rend possible, est un moyen privilégié de penser l’action de l’Homme sur le monde. « En réalité, ça n’est pas qu’un débat technique et scientifique. Admettre que l’innovation puisse répondre aux grands défis et aux crises contemporaines force à poser des limites qui ne sont pas seulement techniques et physiques. L’innovation, qui ne peut plus être envisagée liée à une société de consommation débridée, pose des questions très politiques. Quel type de société souhaite-t-on réaliser ? Quelles valeurs veut-on véhiculer à travers la technique ? »
Des futurs possibles et souhaitables
« Qui sommes-nous ? Que peut-il advenir ? Que pouvons-nous faire ? Que devons-nous faire ? ». Ces quatre questions empruntées à la démarche Prospective de Gaston Berger, ont constitué l’ossature de la réflexion des membres du groupe de travail. Elles soulignent également l’aspect démocratique et politique du débat. Si le fondateur de l’école entendait former « des philosophes en action » en 1957, quelle école imaginerait-il aujourd’hui, pour faire agir l’ingénieur dans un espace sûr et juste pour l’humanité ? « Gaston Berger parlait de relations sociales, d’identité et de sens. En ouvrant la formation technique aux Humanités2, il tentait d’introduire une capacité politique chez l’ingénieur afin de penser les conséquences de ses actions. Aujourd’hui, il est nécessaire d’intégrer à cette réflexion, les problématiques se rapportant à l’anthropocène : les limites de la Terre sont des phénomènes physiques qui amènent à nous questionner sur le sens de l’Humanité », poursuit Marie-Pierre Escudié, enseignante en sciences humaines et sociales. Alors à quels futurs possibles et souhaitables l’ingénieur doit-il se vouer ? La question, presque oratoire, soutient une obligation de démocratie. « Il ne s’agit pas de penser le futur à la place des élèves-ingénieurs, mais bien de les mettre en capacité de le construire par eux-mêmes. Pour cela, il nous faut instaurer un double mouvement, individuel et collectif. Notre rôle est de leur permettre de trouver un espace de responsabilité où ils se sentent en capacité d’agir. »
Une éthique renouvelée de l’innovation pour l’ingénieur
Si l’un des rôles premiers de l’ingénieur consiste à éclairer les choix de société par leurs connaissances techniques et en sciences humaines et sociales, l’enjeu pédagogique d’une telle formation est de donner les clés pour innover en conscience. « Il faut cultiver l’optimisme, car il permet de dépasser l’angoisse des défis qui se dressent devant nous et sert de catalyseur pour apporter des solutions innovantes. L’ingénieur en tant que philosophe en action doit être capable d’éviter la production de fausses bonnes idées, qui tendent à invisibiliser les problèmes ou conduisent à des effets rebonds », prévient Joëlle Forest, maîtresse de conférences en épistémologie et histoire des techniques à l’INSA Lyon. « Qu’il adopte une posture de médiateur ou de diplomate-polyglotte, l’ingénieur pour réarticuler l’innovation à un dessin moral pour la société devra s’interroger sur les valeurs que véhiculent ses innovations : vont-elles vers plus ou moins de liberté, d’égalité, d’autonomie, de sécurité ou de convivialité ? »
Prendre le chemin de l’éthique et de l’action collective
Pour amener les futurs ingénieurs à développer leur espace de responsabilité, les membres du groupe de travail ont ainsi synthétisé plusieurs objectifs d’apprentissages fondamentaux. « Notre réflexion et le livrable qui en a découlé sont majoritairement une synthèse des pratiques existantes au sein des départements et au centre des Humanités. Nous avons surtout travaillé à donner une meilleure visibilité des pratiques qui n’étaient pas nécessairement communiquées ni partagées au sein de la communauté et qui ont pourtant beaucoup à apporter à l’évolution de la formation d’ingénieur INSA », ajoute Thomas Le Guennic, professeur agrégé de sciences économiques et sociales à l’INSA Lyon. « Sur le principe, il s’agit d’aider les élèves à démêler les idéologies, à décoder les relations d’interdépendances et comprendre la nécessité d’adapter les moyens aux finalités et les besoins aux ressources. Aussi, au titre de citoyen, futur salarié ou chef d’entreprise, avant de pouvoir s’engager dans l’action collective et cultiver un futur, il est nécessaire que chaque élève puisse connaître les valeurs qui l’animent individuellement, avant d’accepter les chemins de traverse et les échecs comme faisant partie du changement. »
Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année. Elle est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :
▪️ Anthropocène et climat
▪️ Énergie
▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact
▪️ Enjeux du vivant
▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?
▪️ Calcul numérique
▪️ Sciences des données et intelligence artificielle
▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique
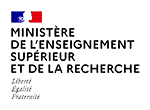
« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »
[1] Le masculin est utilisé à titre épicène et sans aucune discrimination de genre.
[2] La formation en humanités a pour objectif de doter ses élèves d’un solide bagage de compétences transversales, donner des clés de compréhension et des leviers d’action dans un monde complexe, en affirmant une vision socialement et écologiquement responsable.

INSA Lyon
« Gaston Berger voulait former des ingénieurs qui comptent »
« Modèle INSA » : deux petits mots pour une si longue histoire. Au sein de l’école d’ingénieurs lyonnaise, il existe une entité chargée de faire vivre cette histoire : l’Institut Gaston Berger de Lyon. Désormais directrice, Sonia Béchet cultive une relation toute particulière avec l’histoire de son école. Spécialiste en psychologie cognitive, elle avait été recrutée pour faire évoluer l’une des particularité du modèle INSA : les entretiens d’entrée des élèves-ingénieurs. Et depuis cette rencontre avec le modèle INSA il y a vingt ans, elle n’a jamais quitté l’étude de cette philosophie riche de sens. Dans une période où la notion de collectif est mise à rude épreuve par la crise sanitaire, le modèle INSA pourrait s’avérer être un concept fédérateur précieux. La nouvelle directrice de l’Institut Gaston Berger de Lyon explique. Interview.
Vous prenez la tête de l’Institut Gaston Berger de Lyon, est-ce une nouvelle ère qui accompagne votre nomination ?
Ce qui est certain, c’est que l’Institut Gaston Berger est capable de s’adapter à un environnement en perpétuelle évolution. À l’origine, le « Centre diversité réussite » créé en 2009 avait pour objectif de répondre aux questions d’ouverture sociale et de favoriser l’accès à tous aux études d’ingénieurs. Puis en 2015, l’intérêt témoigné pour le modèle INSA nous a obligés à nous transformer en « Institut Gaston Berger », en intégrant la problématique autour de la responsabilité de l’ingénieur. Aujourd’hui, le modèle INSA devient un axe stratégique commun à toutes les écoles du groupe INSA, chaque école est en passe de déployer un centre Gaston Berger. Notre rôle est d’accompagner l’INSA à continuer d’être ce que son fondateur avait imaginé : une école d’ingénieurs qui évolue avec les enjeux de son temps et qui impulse des changements. Cela se traduit par des missions très concrètes, comme l’accompagnement des lycéens et lycéennes, des étudiants et des étudiantes à travers des programmes de tutorat et de mentorat, ou encore grâce à nos recherches sur la responsabilité de l’ingénieur dont nous essaimons les concepts dans la formation des élèves en collaboration avec le centre des humanités. Et désormais, nous co-construisons aussi beaucoup avec nos entreprises partenaires où le modèle INSA est plébiscité. Il y a beaucoup de similitudes entre ce que nous vivons aujourd’hui et le moment où Gaston Berger a pensé le modèle d’école d’ingénieur : le sentiment que tout s’accélère, que la technologie prend beaucoup de place et que finalement on a la sensation de ne plus beaucoup avoir la main sur la question. Et je pense que notre modèle est très précieux pour avoir un cadre de référence et se projeter dans l’avenir. C’est très structurant.
La crise sanitaire a mis (ou remis) sur la table des questions de société et pointé du doigt des problématiques organisationnelles fortes. Conscientiser et apporter des réponses à ces questions est au cœur de votre métier : la pandémie a-t-elle apporté de nouvelles réflexions d’envergure ?
Dans ses travaux sur la prospective, Gaston Berger part du principe que les évolutions et les changements font partie du jeu, qu’il ne faut pas les subir mais les anticiper. Bon, des scénarios catastrophes ont bien été imaginés lors des travaux de prospective engagés par l’établissement, mais nous ne les attendions pas immédiatement il faut bien l’avouer. Par contre, s’il y a quelque chose que la démarche prospective avait déjà mis en exergue, c’est le besoin de chacun d’entre nous, de donner du sens à sa vie et à ses activités. Le confinement nous a mis face à cette question très rapidement : qu’est-ce qui est essentiel ? Je crois qu’au sein de l’INSA, ce qui s’est avéré essentiel, c’est le « faire-ensemble ». La crise sanitaire a démontré que l’on ne pouvait plus raisonner chacun dans son silo. Je suis convaincue que c’est une vraie bonne idée transformante : nous sommes tenus de travailler tous ensemble, et l’Institut Gaston Berger permet d’une certaine façon de mettre en lien toutes les parties prenantes du modèle INSA. Les alliances portées par la Fondation INSA1 sont une belle illustration de ce pourquoi nous travaillons les uns et les autres. Ces partenariats mettent autour de la table et au service d’un enjeu sociétal, plusieurs acteurs de la société civile. Enseignants-chercheurs, étudiants, entreprises, ONG et mécènes sont ainsi réunis autour de valeurs qui ont du sens dans le modèle INSA : la responsabilité, la solidarité et l’équité.
« Je veux comprendre, je veux agir », disait Gaston Berger. C’est une citation qui sonne un peu comme le crédo de l’IGB. Concrètement, comment l’Institut Gaston Berger transforme ses réflexions en actions ?
Effectivement, au sein de l’IGB, les équipes cogitent mais elles agissent aussi ! D’abord dans le dispositif d’accompagnement des étudiants sur les questions du handicap, de l’égalité des genres et de diversité pour permettre l’accès à toutes et tous aux études d’ingénieur. Pour mettre en place ces programmes, nous avons un lien fort avec la Fondation INSA Lyon et les entreprises partenaires avec qui nous co-créons au quotidien.
Nous avons également un important travail de recherche sur la responsabilité de l’ingénieur, et l’enjeu est de continuer à infuser ces notions dans la formation de nos étudiants. La traduction en actes a déjà bien essaimé au centre des humanités : par exemple depuis 2019, les cours à la carte permettent aux étudiants de se former à l’égalité de genre et aux questions de responsabilité de l’ingénieur. L’utilité des sciences humaines et sociales au service d’un établissement comme le nôtre n’est plus à prouver, je crois. Et cette fonction était d’ailleurs l’une des préoccupations majeures de Gaston Berger : l’INSA devait former aux questions sociétales, pour pouvoir faire des ingénieurs qui comptent, en agissant.
Pour finir, le modèle INSA est parfois difficile à saisir pour qui ne le pratique pas au quotidien. Pourriez-vous le décrire en 3 mots ?
Voyons voir… Si je dois le décrire, je choisirais : « équité, solidarité et éthique », mais si je dois le qualifier, ce serait plutôt « moderne, juste et transversal ». Je crois que c’est là que réside tout l’intérêt du mot « modèle ». C’est une vraie philosophie, un puits de ressources inépuisable. En 1957, Gaston Berger ne s’est certainement pas dit : « et si nous nourrissions nos ingénieurs d’arts, de sport ou même de sociologie pour voir ce que cela donne ? ». Son modèle a été établi selon des intentions très précises, et ces intentions étaient si bien pensées que le modèle est atemporel. Quels que soient les époques et les changements, cette identité fondatrice ne vieillit pas. Pour le petit secret, même après vingt années d’étude quotidienne des travaux de Gaston Berger, j’ai encore l’impression de le découvrir, sans cesse. C’est ce qui rend mon travail au sein de l’INSA, plein de sens.
1 Sonia Béchet occupe également les fonctions de directrice des programmes de la Fondation INSA.

INSA Lyon
Chaire Alumni / INSA Lyon : l’ingénieur INSA, ce philosophe en action
Avec la chaire « Ingénieur INSA, philosophe en action. Penser et agir de manière responsable », l’INSA Lyon et son association d’Alumni, la Fondation INSA Lyon et la filiale de valorisation INSAVALOR, souhaitent interroger le rôle de l’ingénieur et nourrir la réflexion sur son évolution dans une société transformée par de grands enjeux.
Urgence climatique, « robolution », crise des représentations et des pratiques… Le monde d’aujourd’hui connaît de profonds bouleversements et commence à percevoir les impasses de nos systèmes socio-économiques. Les enjeux actuels sont de taille et pour pouvoir leur faire face, le monde doit se réinventer.
À la croisée de ce nouveau monde et de ses défis : l’ingénieur. Humaniste comme le souhaitaient les fondateurs de l’INSA Lyon, l’ingénieur INSA devait porter en lui la responsabilité sociétale de ses actes mais aussi de sa pensée. Cette représentation formulée à la fin des années 60, lors de la création du modèle INSA, n’a pas pris une ride aujourd’hui, jusqu'à trouver un écho très fort dans un contexte en pleine mutation.
Comment cet « ingénieur, philosophe en action » évolue-t-il dans notre société contemporaine ? Quelle sagesse peut-il développer face aux défis du temps, à une révolution numérique incontrôlée et incontrôlable, à un futur incertain et imprévu ? À quelles valeurs pourra-t-il se référer et quel idéal cherchera-t-il à véhiculer dans un monde où l’humanité peine à se projeter ? Comment parviendra-t-il à allier pensées et actes, attentes et satisfactions, besoins économiques et nécessités vitales ?
C’est pour tenter de répondre à ces questions, et pour redonner à l’humanisme de l’ingénieur INSA tout son sens dans une époque bouleversée, que l’INSA Lyon et l’Association Alumni INSA Lyon lancent la chaire « Ingénieur INSA, philosophe en action. Penser et agir de manière responsable ». Parce que le monde bouge, qu’il faut anticiper et se mettre en mouvement.
En savoir plus sur la chaire : https://chaires.insa-lyon.fr/chaire-institutionnelle-alumni-insa-lyon
 Penser l’évolution du rôle et de la responsabilité des ingénieurs avec nos Alumni
Penser l’évolution du rôle et de la responsabilité des ingénieurs avec nos Alumni
Par Frédéric Fotiadu, directeur de l’INSA Lyon
L’INSA Lyon est engagé depuis deux ans dans une démarche Prospective, inspirée de la méthode élaborée par son père fondateur Gaston Berger. Ces travaux nous ont permis de mener une réflexion profonde sur les futurs possibles de notre établissement à l’horizon 2040, en envisageant divers scénarios, dont certains de rupture. La crise du Covid-19 nous a brutalement confrontés à ces hypothèses d’exception, qui, au début 2020, étaient encore considérées comme peu probables. Face aux enjeux résultant de ces circonstances, la question du rôle des ingénieurs, déjà au cœur dans notre démarche prospective, reste plus que jamais d’actualité.
Par la diversité des fonctions qu’elles et qu’ils occupent dans tous les domaines et secteurs d’activité, par l’infinie richesse de leurs parcours professionnels et de leurs expériences personnelles, les diplômés INSA constituent à la fois une extraordinaire source d’informations et d’inspiration, et une formidable caisse de résonance à ces questionnements. Ils sont aussi, par leur nombre, un puissant levier de transformation des entreprises et organisations de nos sociétés. Je suis donc particulièrement heureux et enthousiaste à l’idée de porter ensemble cette chaire Alumni INSA Lyon pour approfondir nos réflexions sur la place et la responsabilité de l’ingénieur dans le monde actuel et à venir.
Ce projet absolument passionnant va contribuer à resserrer les liens et renforcer les interactions entre notre établissement et son réseau d’Alumni. Il constitue également une très belle opportunité pour rapprocher de notre communauté de diplômés qui s’en étaient éloignés. Dans un monde en recherche de sens et de nouveaux repères, cette chaire est une invitation à nous mobiliser toutes et tous pour penser notre rôle au sein de la société sur la base de ce qui constitue l’essence même de l’INSA Lyon depuis sa création : le modèle d’ingénieur humaniste.
Cette « marque de fabrique INSA » repose précisément sur la capacité à s’ouvrir à d’autres disciplines, notamment les sciences humaines et sociales, pour saisir toute la pluralité du monde et s’interroger systématiquement sur l’impact sociétal et environnemental des technologies. C’est aussi l’ouverture au monde des arts, de la culture et du sport, pour nourrir notre réflexion et notre expérience d’autres formes de sensibilité, d’interactions, de pratiques, d’autres quêtes de la performance et de dépassement de soi. C’est enfin un véritable engagement citoyen en faveur de l’ouverture sociale et de toutes les formes de diversités pour construire un monde plus juste, inclusif, bienveillant et altruiste.
Formés selon ce modèle porté par l'INSA et nourris de ses valeurs fondamentales, nos diplômés sont particulièrement à même de percevoir la multitude de signaux forts ou faibles qui annoncent les mutations à venir. Ils ont la capacité à les penser non seulement sous l’angle de la technologie, mais aussi et surtout selon une approche intellectuelle globale. C’est précisément cette dynamique qui va être mise en œuvre au sein de la Chaire Alumni, au service de nos élèves, de nos enseignants-chercheurs, de nos partenaires et de la société d’une manière générale.
Il s’agira ici de toujours mieux nous préparer à affronter cet avenir incertain, complexe, bouleversé par le présent, en adoptant une vision systémique pour engager avec conscience et éthique les grandes transitions énergétiques, environnementales et écologiques, numériques, mais également sociales et sociétales, qui permettront de faire advenir un futur désirable.
 Repositionner le rôle de l’ingénieur dans la société
Repositionner le rôle de l’ingénieur dans la société
Par Daniel Louis-André, ingénieur INSA génie électrique 1977 et président de l’association Alumni INSA Lyon
L’ingénieur INSA, femme ou homme, est attaché, peut-être plus aujourd’hui qu’hier, à toutes les valeurs portées par le modèle INSA. Si ses caractéristiques, tout comme son état d’esprit, n’ont pas été érodés par le temps, je pense que nous pouvons constater que l’ingénieur INSA a beaucoup évolué.
Avec tout d’abord, la dimension internationale qu’il a pu acquérir, dans l’entreprise, et dans la société au sens large. Partir en échange pendant ses études il y a quarante ans était le privilège de quelques-uns d’entre nous. Depuis, la mobilité est devenue obligatoire pour tous les étudiants, et les moyens de communication se sont considérablement développés, rendant l’internationalisation beaucoup plus simple à gérer.
Dans ce monde où tout s’est accéléré, nous constatons par ailleurs que l’ingénieur INSA est de plus en plus en quête de sens. L’engagement, l’adéquation aux valeurs de l’entreprise, l’utilité donnée au métier exercé sont des moteurs dans la recherche d’emploi, tout comme dans la conservation d’un poste. Le salaire ne suffit plus au bonheur. Le modèle de société de ces dernières décennies ne fait plus rêver, il est même décrié. La société doit se transformer.
Dans ma spécialité génie électrique, les ingénieurs ont conscience d’être complètement au cœur de la transformation du modèle énergétique. Dans cette course vers la mobilité faible émission, les jeunes ont conscience d’un enjeu majeur : leur impact sur l’évolution des modes de vie pour faire baisser les consommations d’énergie.
Le volet environnemental et la place de l’humain sont devenus primordiaux.
Dans la projection de l'industrie du futur, de l’usine 4.0, au milieu du big data, des objets connectés, de l’ultra-technologie, il y a cette voie vers l’innovation à domicile, les circuits courts, les modèles personnalisés.
De manière plus globale, on va donc demander à l’ingénieur d’être toujours plus créatif. On va lui demander de trouver l’équilibre entre l’expertise qu’il va pouvoir développer en regard des technologies de pointe, et la nécessité de travailler avec une démarche plus large pour mieux intégrer la dimension environnementale sur l’ensemble du cycle de production, et replacer l’humain, tel qu’il doit l’être, au cœur des processus.
L’ingénieur de demain doit tenir ce rôle, avoir cette vision globale, développer cette approche systémique et exercer plus que jamais son sens critique. Il doit avoir la faculté de s’interroger au-delà de son « patrimoine » de compétences, quitte à remettre en cause les approches qui semblent évidentes.
J’aimerais enfin personnellement que l’ingénieur ait un rôle plus important dans la cité, par sa connaissance générale et son savoir-faire, alors qu’il a aujourd’hui peu d’impact. C’est peut-être ce qu’il faut transmettre à nos jeunes : apprendre à ne pas être passifs, face à des systèmes qui les enferment sur des modèles. Il faut repositionner le rôle de l’ingénieur, et mon optimisme me conduit à penser que c’est possible.
Mais pour parvenir à développer de nouvelles approches qui répondent à la fois à la quête de sens de l’ingénieur, et à la nécessité de repositionner son rôle dans la société, il faut s’interroger sur l’art et la manière.
Comment un ingénieur INSA doit se comporter au sein de l’entreprise pour jouer son rôle ? Comment cet ingénieur de demain va parvenir à jouer un rôle important dans son entreprise tout en exerçant son regard critique ? Comment pourra-t-il être à l’initiative du changement sans être perçu comme celui qui veut tout révolutionner ? Les notions de savoir-être et de compréhension du monde de l’entreprise sont ici fondamentales, et doivent guider la formation des élèves, au-delà bien-sûr des bases scientifiques qu’il faut conserver.
Je suis Président des Alumni depuis mars 2019 et, depuis, je suis régulièrement au contact des élèves et des diplômés INSA. Avec cette chaire, nous souhaitons apporter des réponses à leurs préoccupations, notamment au regard des enjeux sociétaux et environnementaux. Et nous allons pouvoir le faire ensemble, avec l’école et la Fondation INSA Lyon.
Cette dimension tripartite est pour moi indispensable au succès de ce projet, comme de beaucoup d’autres. En tant qu’Alumni, nous allons pouvoir faire le lien entre ceux qui pensent la formation à l’INSA Lyon, les ingénieurs en activité et ceux en devenir.
Nous souhaitons faire de cette chaire un terrain concret d’échange d’idées et d’expériences, qui produise des résultats tangibles pour tous les acteurs : École et enseignants, ingénieurs en activité, entreprises.
 Promouvoir le modèle d’ingénieur humaniste
Promouvoir le modèle d’ingénieur humaniste
Par Laure Corriga, présidente du directoire d’INSAVALOR
Nous soutenons cette chaire originale qui a toute légitimé pour exister, parce qu’elle colle à l’ADN de l’INSA Lyon. S’interroger sur le rôle de l’ingénieur fait partie des fondements de l’école, et c’est important de partager la réflexion avec notre écosystème, aux côtés des Alumni et de la Fondation INSA Lyon.
Pour moi, un ingénieur, c’est quelqu’un qui, face à des enjeux, des problèmes variés, apporte des solutions techniques et organisationnelles en prenant conscience des impacts et parties-prenantes qui l’entourent. Sa grande qualité, c’est son adaptabilité. Aujourd’hui, dans un contexte où les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux sont plus visibles, l’ingénieur devient un acteur dont le rôle devrait être plus grand, avec une place dans la société plus prépondérante. Son regard devrait être essentiel, nourri par cette démarche projet dont il a l’enseignement et la maîtrise.
Le rôle de l’ingénieur évolue parce que la société évolue. Dans un monde qui devient plus automatisé, l’ingénieur sera forcé de changer, de prendre en considération de nouveaux paramètres. Au-delà de l’innovation technologique, il devra mesurer l’impact de ses décisions sur le plan sociétal et environnemental, voir plus loin, inventer de nouveaux modèles, en faisant notamment appel à sa créativité. Il devra vivre avec le changement mais aussi l’initier. Il va évoluer dans un contexte plus internationalisé, avec des collaborations aux réponses moins immédiates.
L’INSA éveille ses élèves en ce sens, et souhaite leur apporter les connaissances et les compétences nécessaires. De cette chaire, j’aimerais qu’il ressorte une sorte de label d’ingénieurs humanistes, qui permettrait de témoigner du parcours INSA et de la démarche globale acquise au fil de l’enseignement.
INSAVALOR peut, sur un plan très opérationnel, apporter sa contribution au travail de la chaire sur les aspects de formation continue et développer des modules de formation en cohérence avec la démarche philosophique portée par cette chaire. De plus, en tant qu’acteur de terrain, nous allons pouvoir être récipiendaire des attentes des entreprises et être témoin de leurs changements. Certaines d’entre elles ont déjà entrepris une réflexion fondamentale et ont compris qu’elles devaient prendre leur essor avec de nouvelles générations plus engagées. D’autres travaillent leur marque employeur et vont, a priori, dans cette direction.
 Renforcer le lien entre les différentes générations d'ingénieurs en plaçant au cœur des échanges la philosophie-même du métier
Renforcer le lien entre les différentes générations d'ingénieurs en plaçant au cœur des échanges la philosophie-même du métier
Jean Guénard, ingénieur INSA génie civil 8e promotion et président de la Fondation INSA LyonL’environnement de l’ingénieur a évolué, depuis la création de l’INSA en 1957. Pour son co-fondateur, Gaston Berger, l’Homme était alors au centre de toutes les préoccupations. Aujourd’hui, plus de soixante ans plus tard, nous constatons que les élèves défendent une autre position : la Terre est désormais placée au centre de leurs préoccupations. Cette notion de « Terre en danger », qui n’était réservée qu’à quelques élites un peu marginalisées de l’époque, est devenue omniprésente aujourd’hui. Les notions de frugalité, réparation, économies, reviennent sur le devant de la scène et l’ingénieur humaniste a cette prise de conscience que les ressources de la terre ne sont pas inépuisables. L’ingénieur, qui doit dorénavant s’astreindre à ne pas penser qu’à lui-même, doit apporter sa contribution à l’évolution sociale, économique, intellectuelle et culturelle au monde qui l’entoure, et dans l’organisation du travail.
J’attends donc de cette chaire, avec beaucoup d’intérêt, une redéfinition concrète et actuelle de la notion d’ingénieur humaniste, où l’on se réfère à l’homme mais aussi à la Terre. Mais pour moi, l’ingénieur de demain n’est pas, hormis sur cet aspect environnemental, si différent de ce qu’il était hier. Avec une technique excellente, et une expertise pointue de sa spécialité, il présente une formation solide et une ouverture au-delà de son champ d’expertise, doublée d’une culture générale qui doit être la plus large possible.
Pour moi, un ingénieur, c’est celui qui s’intéresse à ce qui se passe autour de lui, et qui met ses compétences au service de ses valeurs. Des valeurs avec lesquelles il est en accord, dès sa formation sur les bancs de l’INSA. Ces valeurs fortes, l’école les portaient quand j’étais moi-même étudiant. Je fais partie de ceux qui ont eu accès à cette formation d’excellence, étant pourtant éloigné du monde de l’enseignement supérieur. Mes parents, agriculteurs puis épiciers, au Creusot, me soutenaient dans ma scolarité, plutôt satisfaisante. Grâce à eux, j’ai pu rentrer à l’INSA, puis bénéficier d’une bourse d’études dès ma deuxième année. À l’époque, je ne savais pas que je réussirais le pari fou d’aboutir dans une carrière riche de dizaines d’ouvrages d’art, de génie civil, de souterrains, de voies ferrées ou routières, de ports ou d’ouvrages maritimes à la construction d’un ouvrage unique : le viaduc de Millau. Chance ? Intuition ? Culot ? Ambition ? Sans doute un peu de tout cela, mais surtout un goût et une pratique développée de la motivation des équipes.
Seul, je ne suis rien. Ensemble, tout, absolument tout, est possible.
J’avais commencé comme conducteur de travaux et gravi les échelons chez EMCC puis chez Eiffage, jusqu’à en devenir Président de la branche Infrastructures. Dans ma spécialité, le génie civil, nous concevons, nous construisons, et nous pouvons suivre la réalisation. C’est un domaine où nous pouvons nous projeter. Aujourd’hui, le besoin de nouvelles infrastructures n’est plus aussi fort, l’heure est au renouvèlement du patrimoine, et à l’entretien préventif des bâtis. Il faut faire avec l’existant, un véritable défi pour les ingénieurs de ma spécialité. Grâce à cette chaire, impulsée par les Alumni, le lien entre les différentes générations d'ingénieurs va pouvoir être renforcé, en plaçant au cœur des échanges la philosophie-même du métier. Et, je l’espère à nouveau, faire en sorte que l’impensable ne soit pas impossible.

INSA Lyon
La Prospective à l’INSA Lyon : décollage réussi pour l’horizon 2040
Le vendredi 8 juin dernier, les salles de cours du premier cycle ont accueilli le séminaire qui a marqué le lancement de la démarche de prospective, stratégique pour l'INSA Lyon à l'horizon 2040. Quels sont les futurs possibles pour l’établissement ? Quels futurs choisis veut-on faire advenir ?
L’année anniversaire qui a marqué les 60 ans de l’INSA Lyon a apporté des éléments de compréhension du passé et permis de réaffirmer les valeurs et l’identité de l’école. Dans cette continuité et selon la méthodologie de son fondateur, Gaston Berger, l’INSA Lyon souhaite « retrouver l’esprit pionnier » en invitant ses acteurs à envisager l’avenir.
Focus sur une démarche collective et inédite dans l’enseignement supérieur.
Éclairer le présent grâce aux futurs
Ni « divination », ni concept fantaisiste, la méthode prospective propose d’observer le présent à la lumière des futurs possibles et souhaitables. C’est une démarche exploratoire qui interroge l’école autour de cinq grandes questions : « que peut-il advenir ? », « qui sommes-nous ? », « que pouvons-nous faire ? », « que voulons-nous faire ? » et « comment le faire ? ». Pour tenter de répondre aux préoccupations face à son avenir, l’INSA Lyon s’appuie sur la démarche de Gaston Berger, dont le travail s’était inscrit dans une dynamique avant-gardiste pour son époque. Allier la compréhension et l’action, telle est l’ambition de cette initiative.
« J’ai été ravie de participer à ce séminaire et j’ai beaucoup aimé l’ambiance qui s’en est dégagée ! Le travail en groupe était stimulant et j’ai tout de suite eu envie de m’impliquer dans cette initiative. Je me suis d’ailleurs prêtée au rôle de « reportrice » lors des séances plénières de la matinée et c’était un exercice très agréable d’échanger les différents points de vue de chacun des groupes. Ce fut également l’occasion de rencontrer des collègues que je ne connaissais pas et de nouer des contacts de tous horizons. En tant qu’ancienne étudiante INSA, j’ai trouvé la démarche prospective excellente et je suis impatiente de connaître les fruits de cette réflexion globale. » confie Sorina Pop, ingénieur INSA 2007 et ingénieur de recherche au laboratoire CREATIS.
La Prospective considère l’avenir en trois grands « domaines » :
- L’avenir, domaine de liberté : le futur n’est pas déterminé et n’est pas une fatalité mais une chance, constitué d’un ensemble des futurs possibles et imaginables
- L’avenir, domaine de volonté : il est le fruit de l’action ; il faut pour cela étudier les futurs possibles et agir pour advenir le futur choisi
- L’avenir, domaine de responsabilité : face à un avenir ouvert, choisir son avenir est une obligation qui relève d’une responsabilité collective
Pour appliquer cette méthode à son environnement propre, l’INSA Lyon suivra quatre grandes étapes : la mobilisation, l’anticipation, l’appropriation et la décision. Un premier séminaire, organisé le vendredi 8 juin, a permis à 80 personnels de l’INSA Lyon de travailler en ateliers doublés de séances plénières, sur la collecte et l’analyse d’idées reçues concernant l’enseignement supérieur et l’INSA Lyon, l’identification de facteurs de changement et des représentations passé, présente, futur, souhaitée et redoutée de l’INSA Lyon. Le même travail sera réalisé dans le cadre de prochains ateliers avec d’autres parties prenantes de l’école (élèves, alumni, membre du Conseil d’Administration, entreprises, partenaires académiques, institutionnels, responsables politiques, représentants du monde associatif…). À la suite de ces ateliers de lancement, un Groupe Prospective, comprenant des personnels INSA Lyon et des externes, sera constitué pour accompagner la réflexion prospective de l’INSA Lyon pendant toute la durée de la démarche. L’école lancera un appel à candidature en interne dans les prochains jours pour recruter les membres de ce groupe.
Une démarche par essence, collective
« Imaginer et préparer l’avenir, ensemble » : la Prospective est destinée à valoriser les collectifs humains. L’implication active et volontaire est une condition indispensable à l’efficacité de l’approche, car l’anticipation ne peut se transformer en action qu’avec l’appropriation des acteurs concernés. En cherchant à développer l’intelligence collective, en écoutant ses collaborateurs et en ouvrant la diversité des points de vues, l’INSA Lyon aspire à décloisonner les schémas de fonctionnement pour devenir une institution plus agile.
« J’ai trouvé très constructif de travailler de façon collective avec des équipes internes à l’INSA Lyon car cela créé une vraie proximité entre les gens et les entités. Nous pouvions nous exprimer librement et nous étions tous très impliqués dans la démarche réflexive. J’avais déjà assisté à un événement de présentation de la Prospective, et ces ateliers m’ont permis de comprendre les bénéfices de cette initiative en m’exprimant sur des sujets vraiment pertinents. L’encadrement par des animateurs internes à l’INSA et par Philippe Durance, spécialiste de la méthode Prospective nous ont permis d’aborder des questions intéressantes pour la suite du travail, même si j’aurais souhaité pousser la réflexion un peu plus loin malgré le temps imparti. Je ne peux qu’encourager toutes les parties prenantes de l’INSA Lyon à participer à cette démarche prospective ! » a déclaré Julien Serral, directeur adjoint de la direction du patrimoine.
L’INSA Lyon, pionnier de l’enseignement supérieur à se lancer dans la démarche Prospective
Fidèle à sa forte capacité d’adaptation à un monde changeant et à son esprit d’initiative, l’INSA Lyon s’est lancé le défi de la démarche, inédite en France et ambitieuse pour une institution aussi importante que l’INSA Lyon. L’attitude prospective exige une profonde analyse de son identité et de son environnement, une vision large pour s’extraire des forces du présent et replacer l’humain au centre des décisions.
Si de nombreuses entreprises et chefs d’Etat se sont auparavant engagés dans une démarche prospective, aucun établissement de l’enseignement supérieur français n’avait entrepris, jusqu’à présent, cette réflexion stratégique pour son devenir sur la base de cette méthodologie.

INSA Lyon
Prospective : « on peut avoir un coup d’avance sur ce qui va arriver »
Alors que le modèle INSA a été pensé il y a 60 ans par le père de la prospective, Gaston Berger, il est plus que temps de s’interroger sur la philosophie d’un modèle né pour durer. Entretien avec Philippe Durance, spécialiste de la prospective et accompagnateur de nombreuses organisations publiques et privées dans leur réflexion prospective et stratégique.
Qu’est-ce qu’une démarche prospective ?
La prospective est un outil de transformation, d’accompagnement du changement. C’est une démarche originale, qui a pour caractéristique principale de prendre explicitement en compte l’avenir, d’en faire un objet d’analyse à part entière. Elle s’organise généralement à travers trois instances : un comité de pilotage, qui suit le déroulement et évalue ; un comité d’études, qui produit un certain nombre de documents destinés au troisième groupe, celui de la prospective, dont les membres nourrissent la réflexion prospective et stratégique.
La prospective est une maïeutique : son objet se dessine au fur et à mesure que la reflexion avance. Éric Maurincomme m’a sollicité pour accompagner une démarche prospective à l’INSA. Elle est lancée sur 10 mois, de l’élaboration d’une réflexion stratégique à l’énonciation d’un plan d’actions.
Pourquoi avoir accepté d’accompagner cette démarche à l’INSA Lyon ?
L’INSA Lyon est un établissement majeur dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. C’est une école d’ingénieurs qui perpétue la pensée mise en action par l’un de ses fondateurs, Gaston Berger, de former des scientifiques avec une forte dimension humaine. Je pense que c’est à l’occasion des 60 ans de l’école que l’envie d’initier la démarche prospective est née, et que l’opportunité d’appliquer cette démarche au cœur de l’établissement s’est faite sentir.
Quel message pourriez-vous faire passer à ceux qui ont peur du changement ?
La peur du changement est inhérente aux institutions. Le changement est généralement repoussé parce qu’il est vu comme une incertitude. Le problème est que nous sommes entrés depuis quelques décennies dans une période d’incertitude globale. En explorant l’avenir, la prospective permet de réduire cette incertitude et, surtout, d’avoir un coup d’avance sur ce qui va arriver. Il ne s’agit pas de changer pour changer, mais de ne pas subir le changement imposé de l’extérieur, d’être le moteur du changement, d’être maître de son avenir. C’est un processus participatif, un endroit où on peut s’exprimer, débattre, échanger des idées. La prospective se nourrit de la différence de chacun. Il est possible de n’être pas d’accord et de le dire, mais avec bienveillance. L’idée est de construire quelque chose de commun et d’y aller ensemble.
Comment avez-vous découvert Gaston Berger ?
Par hasard ! J’avais un ami professeur à Saint-Denis, qui est parti au Canada pour prendre la responsabilité d’une chaire. C’est en l’aidant à monter son réseau de recherche que je découvre la prospective. J’ai rencontré alors Michel Godet, titulaire de la chaire prospective du CNAM depuis 1987, qui m’a fait découvrir la richesse de cette approche. Mais, si beaucoup d’outils avait été développés pour rendre la prospective plus rationnelle, il m’a semblé que sa véritable richesse venait d’ailleurs : de l’attitude vis-à-vis de l’avenir qui était proposée, de sa capacité à relier, de sa critique profonde de la décision, etc. C’est chemin faisant que je découvre Gaston Berger, père de la prospective.
Que dire sur Gaston Berger ?
Berger était un être exceptionnel. La prospective, c’est Gaston Berger. Elle est née dans son esprit à une époque de maturité : il avait une soixantaine d’années, une grande expérience et avait toujours été à cheval entre la réflexion et l’action. Comment faire pour agir de manière réfléchie et nourrir mon action de ma réflexion ? C’est ce qui l’a guidé tout au long de sa vie. La prospective n’a pu être nommée que parce que Gaston Berger a pu mettre un nom sur la pensée qui l’a animé pendant 20 ans, une pensée de philosophe en action ! C’est un petit miracle. Nous retrouvons des pensées proches de celles de Berger, notamment avec des philosophes allemands, mais elles ne vont jamais jusqu’au bout, jusqu’à l’action, la construction collective. Le seul à l’avoir fait, c’est lui.



