
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Milena TOSTI UMEMURA
Caractérisation du comportement à l'interface fibre-matrice des composites fibre de carbone/PEEK
Doctorante : Milena TOSTI UMEMURA
Laboratoire INSA : MATEIS - Matériaux Ingénierie et Sciences
École doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon
La qualité de l'interface fibre-matrice est cruciale pour la détermination des propriétés finales des composites renforcés par des fibres, car elle influence l'efficacité du transfert de contraintes entre la fibre et la matrice, affectant ainsi significativement le comportement mécanique du composite. Dans cette étude, les interfaces entre 4 nuances de fibres de carbone et une matrice thermoplastique de polyétheréthercétone (PEEK) sont étudiées à partir d'une approche multi-échelle, visant à caractériser le comportement des interfaces sous différents modes de sollicitation. En particulier, l'influence de la rugosité et de la composition chimique de la surface des fibres de carbone sur les propriétés interfaciales d'un composite modèle comportant une seule fibre dans la matrice a été étudiée. Dans un premier temps, une étude macroscopique de la fragmentation des fibres sous charge longitudinale, suivie par émission acoustique, a permis de caractériser les propriétés interfaciales en cisaillement par une analyse statistique. La fragmentation des fibres a été utilisée pour estimer les propriétés mécaniques des fibres de carbone. Une analyse complémentaire in situ par microtomographie synchrotron à rayons X a permis une observation détaillée des mécanismes de fragmentation, révélant un retrait en longueur des fragments, même après saturation de la fragmentation. Une analyse micromécanique innovante a été proposée à partir de ce retrait pour estimer la résistance interfaciale au cisaillement (IFSS), permettant d'estimer l'évolution décroissante de l'IFSS pendant l'essai de fragmentation. Les propriétés interfaciales sous chargement transversal ont également été caractérisées par des essais de traction in situ par microtomographie synchrotron à rayons X, révélant une relation entre la propagation de l'endommagement dans la direction axiale de la fibre et la qualité de l'interface. Les caractéristiques interfaciales déterminent aussi la présence d'amorces de fissures au niveau de l'interface, leur ouverture au niveau de la décohésion à l'interface, et leur propagation éventuelle dans la matrice. Une observation précise de l'initiation de l'endommagement interfacial a été obtenue par microscopie électronique à balayage lors d'essais de traction transversale in situ sur des échantillons composites modèles. Ils ont permis de montrer les effets induits par la qualité de l'interface sur les mécanismes d'endommagement au voisinage immédiat de la fibre. Ces résultats démontrent ainsi que la chimie de surface des fibres de carbone a une forte influence sur le cisaillement et l'ouverture à l'interface fibre-matrice, comparée à avec la rugosité de la surface de la fibre. Cependant, cette rugosité a un impact significatif sur la propagation de l'endommagement dans la direction longitudinale des fibres. De plus, une fois la fibre et la matrice complètement décollées, une rugosité plus élevée implique également une érosion plus importante de la surface du polymère en contact avec la fibre, ce qui entraîne une diminution plus rapide des valeurs de l'IFSS d'une part, et d'autre part une plus grande tendance à la formation de fissures qui se propageront dans la matrice.
Additional informations
-
Amphithéâtre Gaston Berger, 503 Rue de la Physique, 69100 Villeurbanne

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Marcelo DEMETRIO DE MAGALHÂES
Plasticité induite par transformation de phase dans les céramiques de zircone cériées à petites échelles
Doctorant : Marcelo DEMETRIO DE MAGALHÂES
Laboratoire INSA : MATEIS - Matériaux Ingénierie et Sciences
École doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon
Les céramiques à base de zircone dopée à la cérine (Ce-TZP) présentent des propriétés mécaniques uniques, notamment une transformation martensitique induite par la contrainte de la phase tétragonale vers la phase monoclinique (t-m), qui confère une plasticité induite par transformation (TRIP), une meilleure ténacité et une variabilité des contraintes à la rupture réduite par rapport aux céramiques conventionnelles. De plus, la réversibilité de cette transformation de phase positionnent les Ce-TZP comme des candidats prometteurs pour des applications comme céramiques à mémoire de forme (SMC), analogues à certains alliages métalliques, à condition que la transformation ne provoque pas de dommages microstructuraux significatifs. Ce travail vise à élucider le comportement micromécanique régissant les transformations réversibles t-m dans des micropiliers de Ce-TZP. L'objectif principal était de caractériser comment l'orientation cristallographique, les joints de grains et les défauts microstructuraux influencent l'initiation et la propagation de la transformation martensitique, ainsi que sa réversibilité et les effets de mémoire de forme associés. Pour cela, des micropiliers monocristallins et oligocristallins ont été fabriqués et soumis à des charges mécaniques à l'aide de techniques in situ telles que la microdiffraction Laue et la microscopie électronique à balayage (MEB), incluant la diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD). Des traitements thermiques ont également été appliqués pour étudier la transformation inverse (m-t), permettant l'observation directe de l'effet mémoire de forme et l'évaluation de la déformation résiduelle. Les résultats ont montré que la transformation martensitique dépend fortement de l'orientation, se produisant préférentiellement selon des directions cristallographiques qui maximisent les contraintes de cisaillement. Par ailleurs, les hétérogénéités microstructurales telles que les interfaces et les défauts ont un impact significatif sur l'initiation, la propagation et le comportement mécanique qui en découle. Des cycles mécaniques répétés combinés à des traitements thermiques ont confirmé la réversibilité partielle du changement de forme dû à la transformation, et révélé une diminution progressive de la contrainte critique. Ce comportement a été observé après un cycle initial de transformation t-m suivi d'une transformation inverse m-t. La transformation facilitée pourrait être attribuée aux défauts introduits lors du premier cycle, qui modifient le paysage énergétique. L'absence de récupération complète serait probablement liée à l'activité de dislocations, entraînant une déformation plastique résiduelle après chauffage.
Additional informations
-
Amphithéâtre Gaston Berger, 503 rue de la physique 69100 Villeurbanne

Sciences & Société
Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Pierre-Antoine Geslin
Elastic modeling of dislocations and solid solution strengthening in random alloys
Chargé de Recherche CNRS : Pierre-Antoine Geslin
Laboratoire INSA : MATEIS / ELyTMaX
Rapporteurs : Maryam Ghazisaeidi, Jérôme Weiss, Emmanuel Clouet
Jury :
|
Civilité |
Nom et Prénom |
Grade/Qualité |
Établissement |
|
Mme. |
Maryam GHAZISAEIDI |
Professor |
Ohio State University |
|
M. |
Jérôme WEISS |
Directeur de recherche |
CNRS / Université Grenoble Alpes |
|
M. |
Emmanuel CLOUET |
Directeur de recherche |
CEA Paris Saclay |
|
M. |
Sylvain PATINET |
Chargé de recherche |
CNRS / ESPCI-Paris |
|
M. |
Michel PEREZ |
Professeur des Universités |
INSA-Lyon |
|
M. |
David RODNEY |
Professeur des Universités |
Université Claude Bernard Lyon 1 |
Additional informations
-
Amphithéâtre clémence Royer, Bâtiment Jacqueline Ferrand, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Timothée JALLOUX
Développement de matrices alcali-activées pour la stabilisation, la solidification et le stockage des déchets dangereux
Doctorant : Timothée JALLOUX
Laboratoire INSA : MATEIS - Matériaux Ingénierie et Sciences
École doctorale : ED n°34 ML - Matériaux
Les Résidus d'Epuration de Fumée d'incinération d'Ordures Ménagères (REFIOM) constituent une part importante des déchets traités par les Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD). En raison de leur fraction soluble élevée et de la présence de métaux lourds facilement lixiviables, ces déchets nécessitent une étape de solidification/stabilisation (S/5) avant stockage, habituellement réalisée par l'ajout de ciment Portland. Cependant, les évolutions de disponibilité des matières premières, la production de nouveaux déchets plus difficiles à stabiliser et la dégradation de l'image du ciment en raison de son impact carbone sont autant de raisons pour SARPI MINERAL FRANCE d'explorer de nouveaux procédés de solidification/stabilisation. Cette thèse s'est donc penchée sur le développement de matrices alcali-activées pour la stabilisation et le stockage des déchets dangereux. Du laitier moulu de hauts fourneaux est ajouté aux REFIOMs en tant qu'aluminosilicate réactif et activé par une solution de soude et de silicates de sodium. Après une caractérisation fine des REFIOMs utilisés, trois axes d'étude ont été explorés: - l'influence de la concentration en activateur, - l'influence de la concentration en silicates de sodium, - l'optimisation de la formulation par l'utilisation d'un co produit industriel (calcin) et d'un inhibiteur de corrosion Ca(N03)2. Les caractérisations s'étalent sur des échéances allant jusqu'à 91 jours et ont porté sur la prise des matériaux (appareil de Vicat, étalement à la table à choc), ainsi que sur leur propriétés physiques et mécaniques (masse volumique, porosité et contrainte à rupture en compression). L'évaluation de la stabilisation des polluants a été réalisée par des essais de lixiviation de durée variable (24 h et 64 jours) avec des mesures de la fraction soluble, de la concentration en anions par chromatographie ionique et de la concentration en métaux lourds par ICP. L'identification et l'évolution des phases produites en fonction du temps par l'activation alcaline ont été étudiées par diffraction des rayons X (ORX), spectrométrie infrarouge (FTIR), analyses thermiques différentielles et thermogravimétriques (ATD ATG) et microscopie électronique à balayage (MEB). Cette étude a permis, dans un premier temps, de prouver la faisabilité de la 5/5 par activation alcaline dans des conditions cohérentes avec la pratique industrielle. L'efficacité des produits de réaction issus de cette activation sur la stabilisation des ions chlorure et la plupart des métaux lourds a été démontrée. La forte dégradation des propriétés mécaniques et de la stabilisation en présence de macroporosité générée par un dégagement de H2 au cours de la prise des déchets stabilisés a été clairement mise en évidence aux fortes concentrations en activateur. Cette étude a également permis d'approfondir les connaissances sur la dissolution et la précipitation des laitiers en conditions alcalines dans une matrice de déchets fortement salins. Finalement, des conditions de préparation d'une solution de silicates à partir d'un déchet riche en silice, le calcin, ont pu être mises au point et l'usage des nitrates de calcium en temps qu'inhibiteur de corrosion a démontré son efficacité pour résoudre les problèmes de lixiviation engendrés par le dégagement de H2.
Additional informations
-
Amphithéatre Laura Bassi, 23 Avenue Jean Capelle 0, INSA de Lyon, 69100 Villeurbanne

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Arthur PACQUELET
Vieillissement et mécanismes de dégradation de microbilles de zircone lors du procédé de broyage en voie humide
Doctorant : Arthur PACQUELET
Laboratoire INSA : MATEIS - Matériaux Ingénierie et Sciences
École doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon
La technique de broyage en voie humide au moyen d'un broyeur à billes agité permet de réduire et de contrôler la granulométrie de particules solides en suspension jusqu'à quelques centaines à quelques dizaines de nanomètres. Ce procédé repose sur la circulation d'une suspension à broyer dans une chambre de broyage, remplie de billes de broyage. Ces billes sont mises en mouvement par la rotation d'un arbre d'agitation, ce qui leur confère une certaine énergie cinétique. Les chocs engendrés par les collisions bille-particule-bille et bille-particule-paroi de la chambre entraînent la réduction de taille des particules et modifient leur distribution granulométrique. Néanmoins, ces chocs énergiques répétés entre les billes usent ces dernières, créant une pollution du produit à broyer ainsi qu'un coût supplémentaire pour l'utilisateur. Cette étude porte sur les mécanismes d'usure et de vieillissement de billes de broyage en zircone yttriée lors du procédé de broyage en voie humide. L'objectif des travaux réalisés était d'analyser de manière systématique l'effet de différents paramètres influant sur la dégradation des billes lors de leur usage en tests de broyage applicatifs et d'améliorer la compréhension des processus de dégradation des billes. Des études à différentes échelles ont été menées : à l'échelle du broyeur (effet de la vitesse de broyage, effet de l'usure de l'arbre de rotation, effet du revêtement de la chambre), à l'échelle du matériau de la bille (taux d'yttrium, structure cristalline et caractéristiques de surface) et à l'échelle de la suspension à broyer (effet du pH et de la température). L'étude de la dégradation des billes de broyage au moyen de diverses méthodes expérimentales (diffraction des rayons X, microscopie Raman, microscopie à force atomique, microscopie électronique à balayage et en transmission) a mis en lumière un mécanisme d'arrachement de grains lié à une dégradation subsurfacique des billes lors des impacts, ainsi qu'un changement de régime d'usure à partir d'une certaine vitesse de broyage. Un second axe d'étude, lié à la sensibilité des billes Y-TZP au vieillissement lorsqu'elles sont exposées à un milieu humide selon la température, a été mené au moyen de tests accélérés. Le vieillissement des billes en Y-TZP a ainsi été caractérisé à différents niveaux de pH et dans différents milieux (ammoniaque, acide nitrique et soude). Cette démarche nous a permis de mettre en évidence le rôle peu significatif de ce phénomène sur l'usure des billes de broyage. Une attention particulière a également été portée sur l'effet de la transformabilité des zircones Y-TZP (avec 2, 3 ou 4 mol.% en Y2O3) sur la dégradation des billes pendant le procédé de broyage en voie humide.
Additional informations
-
Amphithéâtre Gaston Berger, 503 Rue de la Physique, 69100, Villeurbanne

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Théo LANGLOIS
Empreintes sociétales et performances mécaniques dans les alliages multi-élémentaires
Doctorant : Théo LANGLOIS
Laboratoire INSA : MATEIS - Matériaux Ingénierie et Sciences
École doctorale : ED34 ML - Matériaux
Dans le contexte actuel de transition écologique, motivé par les préoccupations liées à la pollution, au réchauffement climatique et à la consommation des ressources non renouvelables, il est urgent de se tourner vers des sources d'énergie et des matériaux plus verts. Les métaux ont un rôle central dans cette transition écologique. Au cours des prochaines décennies, la demande en lithium, nickel et autres métaux stratégiques devrait augmenter de manière drastique. Les alliages à entropie moyenne (MEA) et à haute entropie (HEA), composés de plusieurs métaux en proportions approximativement égales, représentent des alternatives prometteuses aux alliages conventionnels. Certains HEA se distinguent par leurs excellentes propriétés mécaniques, résistance à la corrosion et stabilité des propriétés malgré les variations de composition, ouvrant une voie pour réduire la dépendance aux matériaux critiques. Parmi les HEA offrant une excellente performance en tenacité figurent l'alliage de Cantor (CoCrFeMnNi) et le ternaire CrCoNi, avec une amélioration des propriétés mécaniques à températures cryogéniques. Parmi les applications industrielles potentielles des HEA, le stockage et le transport de l'hydrogène offrent un support pour l'adoption de l'hydrogène comme source d'énergie plus verte dans la transition écologique. Cependant, l'utilisation du cobalt dans de nombreux HEA suscite des préoccupations en terme d'impacts environnementaux, économiques et sociaux. Ce travail vise à développer de nouveaux MEA axés sur la durabilité tout en maintenant leurs performances mécaniques. Nous étudions de nouvelles compositions autour de la base CrCoNi avec faible teneur en cobalt. Nous démontrons que l'ajout de silicium à nos nouvelles compositions réduit drastiquement l'impact durable de nos matériaux tout en maintenant des performances mécaniques exceptionnelles. Une méthodologie pour développer de nouvelles compositions de HEA a été développée. Nous avons développé un processus d'alliage rapide permettant une prédiction, une fabrication, une caractérisation microstructurale et mécanique à grande échelle et rapide d'un large éventail de HEA. Nous appelons ce processus « Fast Alloying » (FA). Cette méthode comprend l'utilisation de modèles de prédiction, suivie par fabrication de multiples compositions d'alliages (jusqu'à 30 par jour) par four à arc, traitements thermiques et techniques de caractérisation microstructurale (diffraction à rayons X, analyses chimiques et microscopie électronique à balayage). De plus, des essais mécaniques rapides en dureté et en compression sont effectués. Une méthode plus avancée implique la fabrication de quatre compositions prometteuses par four à arc, des traitements thermomécaniques (homogénéisation, laminage à froid et recuit), une analyse microstructurale (XRD, GDOES, EDS, EBSD) et des essais mécaniques (dureté, plastométrie, essais de traction à température ambiante et cryogénique). Nos résultats démontrent la possibilité de développer des alliages performants et durables, en réduisant la dépendance aux éléments critiques tels que le cobalt et en optimisant les compositions des alliages grâce aux modèles de prédictions.
Additional informations
-
Amphithéatre Ouest, Bâtiment Les Humanités, 1 rue des Humanités. 69621 VILLEURBANNE
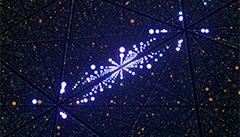
Sciences & Société
Conférence immersive : Alliages métalliques : quand le désordre devient une force
Rencontre est organisée par le CNRS et le Planétarium de Vaulx-en-Velin, en collaboration avec RSA cosmos.
Âge du bronze, âge du fer… Ces alliages métalliques ont marqué des étapes clés de notre Histoire et continuent de façonner notre quotidien. Pourtant, nous ne maîtrisons pas encore tous les secrets de leur formation et de leur déformation.
À travers des simulations numériques menées à l’échelle atomique, plongez au cœur de la matière pour explorer les mécanismes fondamentaux qui rendent certains alliages facilement déformables ou au contraire extrêmement résistants. Explorez comment les scientifiques repoussent les limites de la connaissance pour imaginer les alliages métalliques du futur, matériaux essentiels à la transition énergétique de demain !
L’univers visuel a été réalisé par l’artiste Alex Bourgeois.
Céline Varvenne et Pierre-Antoine Geslin sont métallurgistes au laboratoire Matériaux ingénierie et science (MateiS, CNRS | INSA de Lyon | Université Claude Bernard Lyon 1).
Illustration : © CNRS – Alex Bourgeois
Additional informations
- https://echappeesinattendues.cnrs.fr/event/alliages-metalliques-quand-le-desordre-devient-une-force/
-
Planétarium de Vaulx-en-Velin - Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin
Keywords (tags)

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Stephanie GROSSI ROEDEL
Robocasting de ciment de phosphate de calcium bifasique renforcé par du graphène pour l'ingénierie des tissus osseux
Doctorante : Stephanie GROSSI ROEDEL
Laboratoire INSA : MATEIS - Matériaux Ingénierie et Sciences
École doctorale : ED34 : ML - Matériaux de Lyon
La bioingénierie a considérablement bénéficié des techniques de fabrication additive, offrant des solutions hautement personnalisées pour accélérer la récupération des patients. En génie tissulaire osseux, ces techniques permettent la production de structures et d'implants personnalisés avec des géométries complexes adaptées aux besoins spécifiques de chaque patient. Parmi ces méthodes, le robocasting se distingue par la fabrication de biocéramiques pour les applications osseuses, en utilisant l'extrusion de suspensions céramiques concentrées pour construire les pièces couche par couche. Cette méthode permet l'utilisation d'«encres» enrichies d'additifs qui améliorent à la fois la résistance mécanique et les fonctionnalités biologiques de la pièce finale, favorisant ainsi l'interaction avec le corps. Les phosphates de calcium (CaP) présentent d'importants avantages par rapport à d'autres biomatériaux en raison de leur similarité avec la phase minérale des os, permettant une intégration naturelle sans provoquer de réponses inflammatoires, et étant progressivement absorbés pendant le processus de régénération osseuse. Cela élimine le besoin d'opérations supplémentaires pour retirer les implants. Parmi les différentes formes de phosphate de calcium, les ciments de phosphate de calcium biphasique (BCPC) sont particulièrement avantageux, car ils combinent l'hydroxyapatite (HA), qui fournit un soutien structurel, et le 13-tricalcium phosphate (13- TCP), qui est résorbable et favorise la régénération osseuse. Cette combinaison permet l'absorption progressive du 13-TCP tout en maintenant une intégrité structurelle de l'HA, rendant le BCPC idéal pour les applications de guérison osseuse à long terme. Les ciments phosphocalciques (CPC) se distinguent par leur consolidation à des températures proches de l'ambiante par des réactions de prise, éliminant ainsi le besoin de frittage, ce qui facilite l'incorporation de substances bioactives et thermosensibles, essentielles pour accélérer la régénération. Les nanoplaquettes de graphène (GNP) sont des exemples d'additifs qui peuvent fournir à la fois des améliorations mécaniques et des fonctionnalités biologiques lorsqu'elles sont combinées avec des phosphates de calcium. Les ciments à base de CaP peuvent être mis en forme par robocasting, à condition que leurs propriétés rhéologiques soient optimisées pour garantir la formation de filaments homogènes qui s'écoulent lors de l'extrusion mais conservent leur forme immédiatement après le dépôt, permettant d'obtenir des pièces structurellement solides avec une faible concentration de défauts. Ce travail se concentre sur le développement et l'étude de structures imprimées en 3D à l'aide de la technique de robocasting à basse température, avec des ciments de phosphate de calcium biphasique renforcés de nanoplaquettes de graphène. L'objectif est d'améliorer les propriétés mécaniques et le potentiel biologique du produit final. L'étude a analysé les aspects rhéologiques des pâtes viscoélastiques, l'imprimabilité des pâtes avec et sans graphène, la résistance mécanique des pièces imprimées par des tests de flexion à trois points, ainsi que des évaluations biologiques concernant la cytotoxicité et l'activité métabolique associées aux pièces imprimées.
Additional informations
-
Auditorium Bloc A de l'ingénierie Mécanique, Universidade Federal de Santa Catarina, Florian6polis, Brésil
Keywords (tags)

Sciences & Société
Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Aurélien Doitrand
Contribution à l'étude de l'amorçage de fissures dans les matériaux fragiles
Maître de conférences : Aurélien André Marie Doitrand
Laboratoire INSA : MatéIS - Matériaux Ingénierie et Sciences
Rapporteurs :
Djimédo Kondo (IJLRA, Sorbonne Université), Christophe Bois (I2M, Université de Bordeaux), Sylvain Drapier (LGF, Ecole des Mines de Saint-Etienne)
|
Civilité |
Nom et Prénom |
Grade/Qualité |
Etablissement |
|
Mr |
Djimédo Kondo |
Professeur des universités |
IJLRA, Sorbonne Université |
|
Mr |
Christophe Bois |
Professeur des universités |
I2M, Université de Bordeaux |
|
Mr |
Sylvain Drapier |
Professeur des universités |
LGF, Ecole des Mines de Saint-Etienne |
|
Mme |
Thouraya Baranger |
Professeure des universités |
LMC2, Université Claude Bernard Lyon I |
|
Mr |
Julien Réthoré |
Directeur de recherche |
GeM, Universite de Nantes |
|
Mme |
Nathalie Godin |
Maitre de conférences HDR |
MATéIS, INSA de Lyon |
|
Mr |
Sylvain Meille |
Professeur des universités |
MATéIS, INSA de Lyon |
Additional informations
-
Amphithéâtre de la bibliothèque universitaire Sciences La Doua Lyon 1 (20 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne)

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Sannem-Ahmed-Salim-Landry SAWADOGO
Constructions modulaire 3D béton : Caractérisations d'un béton fibré et évaluations expérimentale et numérique des structures constitutives d'une cellule représentative
Doctorant : Sannem-Ahmed-Salim-Landry SAWADOGO
Laboratoire INSA : MATEIS - Matériaux Ingénierie et Sciences
École doctorale : ED n°34 ML - Matériaux
Cette contribution vise la validation d'un concept de construction modulaire béton développé par Cubik Home et Francioli. L'approche couple une expérimentation à différentes échelles ainsi que la modélisation numérique. L'étude couvre un large spectre, depuis le matériau béton fibré à haut volume en fibres structurelles, avec sa caractérisation tout au long du processus de maturation, mais aussi l'étude de son comportement au feu, avec la gestion de son éclatement et d'un écaillage limité lors du test au feu réglementaire. Le comportement post-fissuration, avec l'énergie de fissuration Gf, est aussi étudié de façon approfondie au travers de tests réglementaires mais aussi sur la base d'essais plus représentatifs des structures minces ici visées. Une loi de comportement appropriée pour le béton fibré avec prise en compte du comportement post-fissuration a été recalée. Les paramètres du modèle élasto-plastique avec endommagement (CDP) du code Abaqus ainsi déterminés, ont permis de reproduire la réponse de divers éléments de structures constitutifs de ce concept modulaire (dalles et voiles minces nervurés). La problématique des liaisons entre les structures porteuses est aussi investiguée via l'expérimentation, et le dimensionnement des connexions sous traction et sous cisaillement validé. Des essais parfaitement représentatifs sont finalement menés au CSTB pour la partie comportement mécanique et au CERIB pour le comportement au feu selon la courbe normalisée 1S0-834. Ces derniers, réalisés sur des murs et des dalles, ont permis d'évaluer la capacité portante (R), l'étanchéité au feu (E) et l'isolation thermique (1). Les résultats sont concluants et confirment les études préliminaires en laboratoire. Pour finir, l'instrumentation par des accéléromètres d'un module complet et son suivi lors de son transport sur camion, a permis de quantifier les sollicitations induites et de vérifier l'absence de pathologies. Le concept a ainsi été validé en étudiant précisément toutes les étapes du process en ayant recours à une production en usine de préfabrication.
Additional informations
-
Salle de Conférence Bibliothèque Universitaire de Sciences, 503 Rue de la Physique, 69100 Villeurbanne, INSA Lyon

