
INSA Lyon
Célébration des diplômés 2024 de l'INSA Lyon
Les 28 et 29 mars, la communauté INSA Lyon s’est réunie pour célébrer ses 1 222 diplômés 2024, issus du bachelor international, des mastères spécialisés, et de la 63ᵉ promotion du cursus Ingénieurs. Ce week-end des diplômés s’articulait autour de trois grands temps : la cérémonie institutionnelle, la remise des diplômes dans les formations et départements, et le gala organisé par le Bureau des élèves. Retour sur la cérémonie institutionnelle.
Diplômés, familles, proches, anciens élèves et partenaires de l’école : ce sont plus de 2700 personnes qui se sont rassemblées vendredi 28 mars dans l’Amphithéâtre 3000, à la Cité Internationale. Organisée par la Direction de la communication, avec le soutien du bureau des élèves, cette cérémonie marque la fin d’un parcours et le début d’une nouvelle aventure professionnelle.

Voir l'intégralité de la cérémonie
Des discours inspirants pour inaugurer ce nouveau chapitre
La cérémonie a été ouverte par Frédéric Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon, qui a adressé un message puissant aux diplômés : « Chers diplômés, vous avez le courage de remettre en question les dogmes, de voir le monde différemment et de repenser la place de l’homme dans la société et la nature. C’est l’un des privilèges de la jeunesse : oser se lancer dans de grandes aventures, innover et créer. Nous avons une grande confiance en vous pour changer ce qui peut l’être et pour accompagner, avec force et sagesse, le changement positif du monde. » Ces mots ont résonné comme un appel à l’action et à l’engagement, guidant les jeunes diplômés vers un avenir marqué par l'innovation et la responsabilité.
Un parcours exigeant et une révolution en marche
Le Recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, Gabriele Fioni, a quant à lui souligné l’importance de cette étape décisive dans la vie des jeunes diplômés : « Vous avez fait preuve d'une détermination remarquable pour réussir ce parcours exigeant. Ce chemin vous a préparés à devenir des acteurs du monde de demain, un monde en pleine révolution. N'oubliez jamais la dimension humaine dans tout ce que vous entreprendrez. Vous êtes la lumière qui pourra éclairer de nouveaux chemins et contribuer à une société meilleure. Nous sommes fiers de vous et nous serons toujours fiers de vous. »
Un conseil précieux pour la route
Un moment particulièrement enrichissant de la cérémonie a été l’intervention de Pierre Dubuc, CEO d’OpenClassrooms et ancien étudiant de l’INSA Lyon (promotion 2009). Il a délivré un conseil de vie précieux : « Ce que je vous conseillerais, c’est d’apprendre à vous connaître. Pour moi, c'est hyper important. À 35 ans, je vois encore beaucoup de gens autour de moi qui ne se connaissent pas aussi bien qu’ils le devraient. Mais en cherchant des réponses, en découvrant qui vous êtes, en comprenant vos moteurs, vos qualités, vos défauts, et ce qui vous donne de l’impact, vous pourrez trouver votre voie. C'est un travail continu, et l’INSA m'a énormément aidé dans cette recherche. Ce n'est pas facile de trouver cette combinaison, mais elle existe pour chacun d’entre vous. Si vous l’avez trouvée, allez-y à fond. Et si vous ne l’avez pas encore trouvée, n’abandonnez pas, elle est là. Cherchez-la et vous finirez par la découvrir. »
Ce message, empreint de sagesse et d'encouragement, a trouvé un écho auprès de nombreux diplômés, alors qu'ils se lancent dans un monde professionnel en constante évolution.
La solidarité entre générations : un atout majeur
Le Président des Alumni, Daniel Louis-André, a également pris la parole pour rappeler l’importance de la solidarité et du réseau alumni : « Les liens entre générations d’insaliens sont essentiels pour avancer ensemble et se soutenir tout au long de nos carrières. L’INSA nous forme non seulement à être des leaders techniques, mais aussi à être des acteurs du changement social et professionnel. »
Un spectacle vivant pour conclure en beauté
La cérémonie a été ponctuée de moments artistiques. L’ouverture a été assurée par BLŪEM, un projet artistique d’un jeune diplômé, Maxime Bouhadana, accompagné de l’Ensemble vocal de l’INSA Lyon. Le collectif de danse INSANITY DANCE CREW a ensuite proposé le projet [EGO], une performance sur l’identité humaine, abordée sous des angles à la fois collectif et individuel. La soirée a par ailleurs rendu hommage à la culture asiatique avec une performance de danse K-pop, célébrant ainsi la diversité des talents présents à l’INSA Lyon. Enfin, l’Ensemble vocal de l’INSA Lyon a conclu cette soirée en chanson.
Félicitations à toutes et tous, diplômées et diplômés ! 🎉 Vous êtes désormais prêts à relever de nouveaux défis et à continuer à faire rayonner l’INSA Lyon dans le monde professionnel.
Copyright : Graines d'images
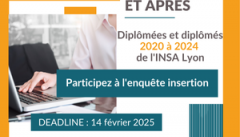
INSA Lyon
Diplômés INSA Lyon de 2020 à 2024, participez à l'enquête insertion !
📢 Diplômés 2020 à 2024 de l'INSA Lyon, à vos smartphones, tablettes ou claviers !
L’INSA Lyon a lancé l’enquête Conférence des grandes écoles (CGE) 2025 sur l’insertion professionnelle de ses diplômés.
Cette enquête est la référence en matière d'insertion professionnelle et votre réponse est indispensable à la réussite de celle-ci. 🎓
📧 Un mail vous a été envoyé (pour les diplômés 2024 : sur votre boîte mail INSA) de la part de "INSA Lyon" avec l’adresse d’expéditeur secure.cge-insalyon@sphinxonline.com.
Si vous n'avez pas reçu le mail ou si vous avez des questions sur l'enquête, contactez-nous : enquete.diplomes@insa-lyon.fr ou 04 72 43 89 21.
Merci d’avance pour votre participation ! 👍

Institutionnel
Jean-Michel Jolion : un parcours au service de l'enseignement supérieur et de la recherche
Après une carrière marquée par des contributions significatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, Jean-Michel Jolion, professeur des universités et spécialiste en informatique, a pris sa retraite en cette fin d’année 2024. Fort d'un parcours impressionnant, il laisse un héritage durable, tant au sein de la communauté INSA qu’auprès des acteurs publics de l’éducation et de la recherche. Retour sur une carrière remarquable au service de la communauté scientifique et universitaire.
De son rôle de conseiller auprès des ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, à son engagement au service du développement de la recherche et de l’enseignement supérieur à Lyon, Jean-Michel Jolion a façonné de nombreuses évolutions.
Un parcours académique de haut niveau
Jean-Michel Jolion rejoint l’INSA Lyon en 1979 en provenance de l’Allier. « Sur le campus de l’INSA Lyon, il y avait plus d’étudiants que d’habitants dans mon village ! » nous fait-il remarquer dans un sourire. Il y obtiendra le diplôme d’ingénieur en 1984. Sa passion pour la recherche sera le fruit des rencontres avec des chercheurs de l’INSA et notamment en physique des matériaux et en microscopie électronique. C’est ce qui le conduira vers le doctorat en informatique et automatique appliquées en 1987, sur un sujet à l’interface entre plusieurs disciplines, qu’il poursuivra par un séjour post-doctoral à l'Université du Maryland (États-Unis) au sein du Computer Vision Lab, grâce à un financement INRIA. « J’y ai découvert un monde de la recherche totalement nouveau : cosmopolite, largement financé, à la pointe sur les meilleurs équipements et surtout déjà tiré par la course à la publication scientifique ! ». À son retour en France, il devient maître de conférences à l’Université Claude Bernard Lyon 1, avant de rejoindre à nouveau l'INSA Lyon en 1994. « J’ai pu obtenir un poste de Professeur au sein d’un tout nouveau département « Génie Productique » qui allait ensuite devenir génie industriel. Ça me permettait de contribuer au développement de l’INSA ». Déjà passionné par l’organisation de l’enseignement supérieur, il occupera plusieurs fonctions importantes, notamment en tant que directeur de la toute nouvelle école doctorale en informatique et information pour la société, puis directeur adjoint de la recherche, chargé des études doctorales et de la culture scientifique. Passionné de médiation scientifique et conscient que la science doit rester en contact avec la société, il créera, avec d’autres collègues de l’INSA (Henri Latreille et Frédéric Arnaud), l’association Ebulliscience (avec le soutien de Georges Charpak), association qui existe encore 26 ans après.
Jean-Michel Jolion n’a cessé d’allier recherche de pointe et implication dans la gestion et l’évolution des formations supérieures. Responsable du comité technique TC15 Graphs based representations de l’International Association for Pattern Recognition de 1998 à 2002, il a également été expert pour de nombreuses activités de recherche au Canada, en Italie, en Suisse et aux Pays-Bas. Son expertise scientifique est également reconnue au sein du comité scientifique de l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) au début 2000. « L’INA préserve la mémoire de notre temps. En son sein, j’ai découvert les enjeux du numérique, au moment de l’explosion du big data ». Pendant plus de 10 ans, il bénéficie d’un soutien de France Télécom qui assume la totalité du financement de sa recherche « sans réelle pression en retour. Un statut et une liberté comme il n’en existe plus aujourd’hui » nous confie-t-il.
Un acteur clé dans la réforme de l'enseignement supérieur et des engagements au niveau national
L’un des aspects les plus marquants du parcours de Jean-Michel Jolion réside dans son rôle au sein des institutions publiques. « Je suis devenu membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en 1998(1). J’ai pu apercevoir la complexité de notre système mais également sa richesse. Œuvrer pour rendre ce système plus efficient est devenu une évidence pour moi et une nouvelle mission personnelle que j’ai pu exercer sur des postes variés entre niveau national et régional ».
En 2012, il rejoint la DGESIP où il dirige le service de la stratégie de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle. En mai 2014, il rejoint le Cabinet de Benoit Hamon, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en tant que conseiller en charge de l’enseignement supérieur. Au fil des différents remaniements entre 2014 et 2017, il rejoindra également le Cabinet de Geneviève Fioraso, puis de Thierry Mandon, secrétaires d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et surtout de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, entre septembre 2014 et mai 2017. À ces postes, il a été un acteur majeur des réformes qui ont marqué l’orientation et l’organisation de l'enseignement supérieur français durant cette période : le passage de l’habilitation des formations à l’accréditation des établissements, le transfert de la CSTI aux Régions, la réforme de la formation des enseignants, et surtout la réforme du master dont il a présidé le comité de suivi de 2006 à 2012. « Une expérience sensationnelle au cœur du pouvoir, loin des clichés de l’administration centrale ou de la politique politicienne. Et des grands moments comme les négociations interministérielles et surtout celles avec Bercy, le centre du pouvoir ! Mais aussi, et heureusement, de formidables rencontres et des expériences humaines inoubliables surtout quand vous êtes amené à gérer les « cas personnels », toutes ces demandes, parfois farfelues, souvent touchantes et émouvantes voire dramatiques, qui arrivent des français directement sur la boite mail ou le sms de la ministre ! ».
En décembre 2020, il est rappelé comme Conseiller au sein du Cabinet de Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’abord pour suivre l’ensemble des mesures RH de la loi de programmation pour la recherche (votée en décembre 2020) puis de la culture scientifique et des formations.
Cette mission assumée, il revient sur l’INSA début 2022 mais repart très vite sur Paris à la demande de Sylvie Retailleau, nouvelle ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle lui confie une mission consistant à organiser une concertation sur la vie étudiante touchée par une explosion de la précarité. Comme délégué ministériel (à mi-temps avec son poste INSA), il assiste la ministre pour convaincre Bercy de dégager des moyens exceptionnels en mars 2023, « je suis très fier d’avoir pu contribuer à l’augmentation du budget de la vie étudiante de 500 M€, c’est-à-dire 22 % sur le budget, en faveur des plus précaires ». Ses rapports à la ministre et notamment le dernier remis en juillet 2023 fondent la première étape de réforme des aides sociales aux étudiants qu’il accompagne au sein de la DGESIP jusqu’à fin 2023.
Enfin, de janvier à juillet 2024, il effectue une dernière mission auprès de la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle autour du devenir des écoles d’ingénieur. « Un peu comme un retour aux sources pour boucler la boucle avant de m’arrêter » remarque-t-il.
« Pendant ces douze années au ministère, j’ai mené de très nombreuses concertations avec la communauté, les syndicats… et j’ai adoré ces contacts humains. Bien sûr, il y avait très souvent des divergences, des oppositions, des désaccords mais j’ai toujours tenté d’écouter tout le monde et de trouver le bon compromis même avec les plus irascibles, même avec les patrons des sections CNU de droit ! » sourit-il.
Un engagement fort pour la région lyonnaise
En 2004, il devient conseiller du nouveau Vice-Président de la Région Rhône-Alpes en charge de l’enseignement supérieur et de la Recherche. « Tout en restant en poste à l’INSA » tient-il à préciser. « L’objectif était d’animer la concertation régionale avec les milieux académiques et construire le premier schéma régional de l’ESR. C’était une première en France ! ». Cet ancien insalien, toujours avec cet esprit pionnier qui nous caractérise a participé ensuite activement à la contractualisation de tous les établissements de la Région.
En 2007, il est recruté comme délégué général de la toute nouvelle Université de Lyon(2). Jean-Michel est chargé de créer cet établissement public qui devra, trois mois après sa création être un des acteurs majeurs du site face à l’arrivée des grands projets comme le plan Campus, le programme investissement d’avenir… « Pour cette mission, ma priorité consistait à faire de l’université de Lyon la maison commune pour le développement du site académique lyonnais, favorisant la collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités et les acteurs économiques de la région ».
En juin 2017, il devient délégué régional à la recherche et la technologie auprès du Préfet et du Recteur, « j’étais au cœur de l’innovation et de la négociation du CPER pendant 3 ans et demi ! ».
En 2022, en parallèle de sa mission nationale, à la demande des directeurs des 4 écoles (Entpe, Centrale Lyon, INSA Lyon et Mines Saint-Étienne), il accompagne la construction progressive de la démarche collective qui se traduira par la création du Collège d’ingénierie (alliance sans structure). « Une nouvelle dimension plus proche du terrain au sein d’un écosystème académique perturbé par l’échec de l’Idex mais surtout l’effervescence des nouveaux projets ».
Un homme de vision et d’innovation
Jean-Michel Jolion est également reconnu pour sa contribution à l’innovation dans son domaine de prédilection. Sa réflexion sur les outils d’analyse de données et les systèmes complexes lui a permis de contribuer activement à la reconnaissance de la recherche française dans le domaine des sciences et des technologies.
Sa recherche ? La reconnaissance des formes (et surtout les statistiques appliquées à des formes non conventionnelles) et plus simplement répondre positivement à la question « Comment mélanger des choux et des carottes ». Si vous le croisez, vous aurez peut-être droit à la recette ! En tous cas, nous souhaitons une très belle retraite à celui qui a démontré ce que veut dire l’esprit INSA tout au long de sa carrière.
(1) Il exercera cette mission jusqu’en 2007.
(2) Créée en février 2007 sous la forme d’un Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur.

Formation
« Je dois beaucoup à ceux qui m’entourent et dont j’ai croisé la route »
Quelques mèches blondes décolorées trahissant de longs jours de traversées en mer et un sens du contact sans commune mesure : Achille Nebout, 34 ans, est un skipper-ingénieur qui a le vent en poupe. La voile l’aura mené jusqu’aux bancs de l’INSA Lyon, au sein de la section sportive de haut niveau dont il sortira diplômé en 2016. Portrait d’un navigateur ingénieux, résilient et pour qui le sens du collectif représente quelque chose de précieux.
Entre persévérance et défis
Comme une ironie du sort, c’est une maladie de croissance touchant son talon qui pousse Achille Nebout vers la voile. Depuis l’Hérault, sa région de naissance, il découvre la navigation à travers l’expérience d’un skipper et ami de la famille. Kito de Pavant l’initie à ce sport qui n’est pas des plus connu en mer Méditerranée. Et Achille tombe dedans, petit : ce sport complet et physique réjouit le jeune montpelliérain qui trouve grisant de se retrouver seul sur les quelques mètres carrés d’un Optimist. De fil en aiguille, il pousse la porte de l’INSA Lyon. Il passera son diplôme d’ingénieur en 8 ans, en intégrant la section sportive de haut niveau. « Les premières années étaient si intenses et représentaient un gros changement par rapport au lycée, mais j’en garde des souvenirs très heureux. Dès la deuxième année, j’enchaînais les allers-retours entre Lyon et Marseille pour me rendre au Pôle France que j’avais tout juste intégré. À ce moment-là, je passais aux choses sérieuses : on visait l’olympisme », se remémore Achille Nebout. Dans une organisation logistique éprouvante, menant l’élève-ingénieur aux quatre coins de l’Europe, le ton est donné. Si la vie est faite de défis, Achille Nebout les relèvera tous, avec persévérance et humilité. « La voile implique des déplacements de longue durée, ce qui nécessitait un aménagement supplémentaire dans mon emploi du temps déjà aménagé par rapport aux parcours classiques. Je dois beaucoup à mes potes dans toutes mes années d’études, pour tenir le coup et ne pas être à la ramasse sur les cours ! Et heureusement, car en SHN, malgré les aménagements, il n’y a pas de traitement de faveur. On ne nous fait pas de cadeau et le niveau est aussi élevé que pour les autres élèves. »
De la rudesse du monde sportif
Fils d’architectes, Achille file tout droit au département génie civil et urbanisme1. Un domaine dans lequel il a baigné « depuis tout petit, mais dont il ressent l’envie d’explorer pour ouvrir le champ de ses compétences ». En parallèle de son entrée en département, le projet olympique se précise. Recruté par Nicolas Charbonnier, médaillé olympique en 2008, ils sont en lice pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Rio de 2016. « En voile olympique, la compétition est très rude : un seul bateau peut être qualifié pour représenter la France ». Par un concours de circonstances et malgré une seconde place décrochée en phase de qualifications, le projet s’arrête net. Le jeune voileux, encore étudiant, commence à saisir les difficultés du milieu ; une période de grands questionnements, durant laquelle il s’amarre à ses études. « J’ai réalisé à quel point c’était dur et j’avais la tête dans le guidon. J’ai soufflé un peu et j’ai mis la priorité sur la fin de mes études. Il fallait finir ce que j’avais commencé et d’ailleurs à cette époque, rien n’était écrit pour que je fasse de la voile mon métier. »
À peine diplômé en 2016, l’ingénieur fait de nouveau face à un choix. « Dois-je commencer à travailler en tant qu’ingénieur ou dois-je tenter l’expérience en tant que navigateur et sportif de haut-niveau ? ». La décision est vite prise pour celui qui commence à être rétribué pour naviguer. « Je venais de créer ma micro-entreprise pour être rémunéré en tant qu’équipier et le tour de France à la voile permettait de gagner sa vie sur une saison complète. En voile, les projets sont très précaires. Tout peut s’arrêter du jour au lendemain, il faut savoir s’adapter en permanence ». Et la fin de la saison ne fera pas exception : en 2018, un projet prend fin prématurément et la remise en question refait surface. Alors il se laisse inspirer par des skippers qu’il admire parmi lesquels, un ancien camarade d’école avec qui il partage quelques points communs. Achille Nebout entre dans les pas de François Gabart : « l’INSA Lyon, la voile… et la course au large ! ».
Dans la course des (très) grands : prendre le large
Après l’école de l’olympisme, il est l’heure pour le skipper de s’attaquer à une course mythique : la Solitaire du Figaro Paprec. Alors sans sponsor, Achille Nebout s’en va, auprès de sa banque, défendre son projet. « C’était l’année où le circuit Figaro changeait de bateau. Les compteurs étaient plus ou moins remis à zéro, même pour tous les ténors de la course. Alors j’ai investi dans un Figaro 3 et je me suis mis à faire de la recherche de sponsors. C’est une chose de naviguer et une autre que de créer une dynamique autour de soi ! Et puis j’ai été contacté par un grand Figariste, Xavier Macaire, avec qui j’ai mis au point le bateau et qui m’a beaucoup appris », ajoute Achille. Pour sa première Solo Maître Coq, Achille Nebout gagne la première manche, juste devant Armel Le Cléac’h. La machine est lancée. « Imaginez : gagner une première manche en tant que bizuth, alors que je passais ma première nuit en mer seulement deux mois auparavant et en prime, devant un marin qui m’a toujours fait rêver ! »
Après une 7e place pour la transat Jacques Vabre aux côtés de son mentor Kito de Pavant, l’année 2019 est une année de toutes les premières pour l’ingénieur voileux. « Je crois que je commence à marquer les esprits à ce moment-là. Je suis un outsider et j’ai la niaque. »

Podium en Figaro (Crédits : Alexis Courcoux)
Virtual Regatta : des salles informatiques de l’INSA Lyon au sponsor coup de cœur
Si Achille Nebout compte sur une détermination sans faille, l’homme qui célèbre les joies autant que les difficultés voit sa saison réduite comme beaucoup, à cause de la crise sanitaire. Poussé par son entourage, il renoue avec un vieil amour de ses années d’études ; le jeu Virtual Regatta, réplique digitale de la course du Vendée Globe. « Le jeu a explosé pendant le confinement et je le connaissais bien pour y avoir joué de nombreuses heures dans les salles informatiques de l’INSA, quand le réseau Wi-Fi faisait des siennes… Sauf que cette fois, j’étais identifié parmi les skippers pro ! » Une participation qui n’est pas passée inaperçue pour Claude Robin, président-fondateur d’Amarris qui lui propose de sponsoriser son bateau, numériquement. « C’était inouï et ça avait fait l’objet de nombreux articles de presse, car nous avons continué l’aventure dans la vraie vie, une fois la crise sanitaire passée. C’est d’ailleurs grâce à cette rencontre, couplée à mon autre sponsor, Primeo Energie, que je commence à faire des courses beaucoup plus confortablement et pour lesquelles j’obtiens de bons résultats. »
Par ailleurs, il fait interagir son projet de course au large avec le monde artistique, à travers diverses collaborations ; une façon de soutenir des personnalités dont il affectionne les créations et de nourrir leurs métiers respectifs. Franck Noto, street artist, intervient ainsi sur le design de son Figaro en 2021. « J’ai aussi rencontré le musicien Simon Henner, Franch79, avec qui j’ai collaboré sur plusieurs projets, dont un documentaire. Pour la petite anecdote, la première fois que j’ai vu Simon, c’était sur la scène de 24 heures de l’INSA, alors qu’il jouait avec son premier groupe ! Une dizaine d’années plus tard, on travaille ensemble », s’amuse le skipper.

Le bateau d’Achille Nebout designé par l’artiste de rue Franck Noto (Crédits : Robin Christol)
En 2022, Achille Nebout décroche la 3e place sur la Solitaire du Figaro. « Un grand moment de ma carrière, qui fait beaucoup de bien et concrétise énormément de travail avec les sponsors et tous les membres de mon équipe. »
Seul face aux éléments…
Premiers podiums : Achille Nebout est désormais dans la cour des grands. Il se professionnalise et son nom commence à être reconnu. Mais son plus grand défi d’alors, se trouve sur le bateau : entre lui et lui-même. « Dans ce sport, on est en prise avec des éléments qui ne dépendent pas de nous. Le vent est insaisissable et peut vous faire vivre des situations injustes et générer une frustration immense qu’il faut savoir gérer pour rester performant. On se met dans des états assez compliqués, avec peu de sommeil et pour certaines courses, on est coupé du monde. Tout se passe dans la tête et seul face aux éléments, on se rend compte que notre cerveau et notre corps peuvent faire des choses insoupçonnées. La préparation mentale est indispensable, en parallèle de la préparation physique et technique, car même si l’instinct de survie est vraiment très fort, il faut savoir développer ses bons réflexes ». Depuis cette année, Achille Nebout est devenu papa. Une nouvelle étape qui jouera dans sa navigation. « La perspective de tout ça a changé depuis que ma fille est arrivée. Je ne naviguerai plus de la même façon. »
… mais le sens du collectif comme boussole
Désormais sur un monocoque de la Class 40, c’est sur des courses transatlantiques que le navigateur évolue depuis ; avec plusieurs victoires et podiums en double et équipage à son actif. « La prochaine Route du Rhum sera en solitaire ! », annonce-t-il. Mais ne nous y trompons pas : une course en solitaire est toujours accompagnée. Achille Nebout n’a de cesse de souligner le rôle de son entourage et de son équipe dans ses différents succès. « Tous les marins le disent. Ce dont je suis le plus fier, ce sont les gens qui sont parfois dans l’ombre et à qui l’on doit 90 % de nos performances. J’ai beau être ingénieur, une casquette très pratique quand il s’agit de routage météo, de structure ou d’électronique, de conception ou d’amélioration de nos bateaux, mais la fidélité et le sens de l’humain sont des valeurs indispensables à tout bon skipper. Je dois beaucoup à ceux qui m’entourent et ceux dont j’ai croisé la route. »
[1] Aujourd’hui, le département génie civil et urbanisme s’appelle « génie urbain ».

Institutionnel
Symposium INSA Alumni 2025
Fédérées autour d’INSA alumni, les associations de diplômés des INSA vont se rencontrer à Lyon, les 13, 14 et 15 juin 2025 à l’occasion d’un grand symposium.
Tables rondes, ateliers et rencontres sont au programme et viendront questionner la place de l’ingénieur INSA dans notre société contemporaine.
Ce symposium aura pour thématique l’Ingénieur face au défi du XXIe siècle.
Vous êtes alumni INSA et souhaitez vous impliquer dans l'organisation du symposium ? Vous pouvez contacter l'équipe projet.
Additional informations
- https://symposium.insa-alumni.org/
-
INSA Lyon - Campus LyonTech La Doua - Villeurbanne
Keywords (tags)

Entreprises
« J’évitais les projets liés au handicap par peur d’être stigmatisé, mais j’avais une valeur ajoutée sur l'accessibilité numérique »
Diplômé du département informatique en 1988, Olivier Ducruix a mené une carrière d’ingénieur déterminé. Atteint d’une maladie rétinienne dégénérative, il conclut sa dernière année d’études à l’INSA Lyon, loupe en main et oreille attentive. Rapidement, il intègre France Télécom, dans une ère où l’accessibilité aux personnes en situation de handicap n’en est qu’à ses balbutiements. Qu’importe : il n’a jamais douté de sa capacité à contribuer à la valeur d’une entreprise malgré sa malvoyance. Aujourd’hui, ce passionné de voile est membre de l’équipe de France de paravoile, et aussi champion du monde en double. De cette passion, est née SARA, une application qui ouvre désormais la voie à l’indépendance des navigateurs malvoyants. Olivier Ducruix raconte son parcours.
Entré à l’INSA Lyon en 1983, vous avez effectué vos cinq années d’études d’ingénieur avec un trouble de la vision dégénérescent. Comment s’adaptait-on à la fin des années 1980 pour suivre une formation d’ingénieur avec un handicap visuel ?
J'ai passé cinq années extraordinaires à étudier, avec beaucoup de plaisir ! Cette déficience visuelle, due à une maladie de la rétine, a été détectée dès la maternelle, donc j’avais déjà développé une certaine capacité d’adaptation. J'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement hyper sympa où, malgré l'absence de dispositifs formels à cette époque, il y avait beaucoup de bienveillance et une vraie écoute de la part des professeurs. Ils faisaient attention à moi et adaptaient leur approche, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai terminé mes études avec l'aide d'une loupe et des photocopies A3, je prenais mes cours à l'oreille et comptais aussi sur mes amis pour me fournir des notes. Plus tard, quand l’ordinateur a commencé à se démocratiser, j’ai utilisé des outils de synthèse vocale et des logiciels de zoom qui facilitaient la prise de notes au clavier. En clair : avec un peu d’aide de la part de l’entourage et de la volonté, on s’adapte ! J’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur en 1988.
Vous menez toute votre carrière au sein de France Télécom, aujourd’hui Orange. Des postes techniques, au management, c’est finalement une loi et l’avènement du web qui créeront un poste né pour vous : vous devenez Directeur du Centre de Compétences en Accessibilité Numérique au sein de la société française de télécommunications.
Effectivement, j'ai commencé comme chef de projet, puis je suis devenu responsable réseau, architecte technique, puis responsable de département et directeur de projets transverses. Les postes techniques devenant de plus en plus difficiles sans la vue, j’ai rapidement pris des responsabilités, en manageant des équipes. Il y a des choses que l’on met de côté à cause du handicap, mais il y a aussi beaucoup de choses que l’on développe. Par exemple, puisque j’utilise mon oreille depuis tout petit, mon handicap devient un avantage aussi bien sur ma capacité à mémoriser, qu’à sentir la tempête se préparer à l’approche d’une réunion houleuse ! En 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances1 ouvre un nouveau champ : celui de l’accessibilité numérique. Les technologies et l'avènement du web offraient des opportunités incroyables pour rendre les outils plus accessibles. Pendant longtemps, je ne voulais pas être stigmatisé et je crois que j’évitais de travailler directement sur des projets liés au handicap. Mais j'ai compris que je pouvais apporter une réelle valeur ajoutée dans ce domaine. J'ai eu carte blanche pour développer des solutions techniques adaptées.

Le blind sailing est une discipline de voile destinée aux personnes aveugles © Jean-Louis Duzert
En matière de solutions techniques adaptées, la dernière en date est SARA, pour Sail and Race Audioguide, car plus qu’un ingénieur, vous êtes aussi champion du monde de paravoile en double. Comment est née SARA Navigation ?
J'ai découvert la voile grâce à des amis étudiants de l'INSA lors d'un week-end à Marseille, et j'ai immédiatement adoré. En 2009, j'ai rencontré Mathieu Simonet, président de l'association Orion lors d’un stage. Il avait développé des outils dans le cadre de sa thèse sur la problématique de la voile adaptée. En repartant de ce stage, j’étais un autre marin ! Lui avait développé un prototype sur PC qui permettait de naviguer avec davantage d’autonomie grâce aux informations fournies automatiquement, par un système d’annonces vocales. J’ai proposé à mon entreprise d’entamer ce projet en mécénat de compétences pour les dernières années de ma carrière. L’enjeu était de miniaturer cette application pour qu’elle tienne dans la poche des marins déficients visuels. Grâce au système GPS du téléphone et à une synthèse vocale, SARA donne des indications sur le cap du bateau, la vitesse ou le point de route à atteindre. Nous avons aussi développé une ceinture vibrante, avec Marine Clogenson, également ingénieure passionnée de voile, une sorte de girouette tactile, qui permet de ressentir la direction du vent par des vibrations. Désormais, j’emploie beaucoup de mon temps à promouvoir la voile pour les personnes déficientes visuelles, notamment avec le projet « Cécivoile », en lien avec l’UNADEV, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels. Ces initiatives ont offert à de nombreux marins aveugles une liberté et une joie de naviguer qu'ils pensaient ne jamais pouvoir expérimenter et j’en suis très heureux.

Olivier Ducruix est champion du monde de Paravoile © : World Sailing
Et puis vous avez une autre passion : la musique.
Tout à fait ! J’aime écrire des textes et j’ai déjà enregistré trois albums. D’ailleurs, je m’y remets avec ma fille, ingénieure INSA et chanteuse, elle aussi. Son mini-album s’appelle « Rédemption ». Pour ma part, je viens de sortir un single qui s’appelle « un vent de liberté », dans laquelle j’exprime la sensation de bonheur et de liberté que peut provoquer une sortie en mer pour un malvoyant. On a tendance à l’oublier, mais sans vision ou avec une vision déficiente, la mobilité sur Terre est réduite. La cécité est une embûche pour se déplacer dans l’espace, alors que sur un bateau, on est un peu comme des oiseaux, sans entraves. C’est un sentiment qui est partagé par beaucoup de pratiquants, si bien que cette chanson a été choisie comme hymne du prochain championnat du monde de blind sailing qui aura lieu sur le lac Léman (Sciez), fin juin. C’est une jolie récompense !
[1] La loi du 2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » fixe le principe d'une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps, qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif ou mental.

Entreprises
« Je travaille sur l’un des challenges opérationnels les plus complexes qu’ait connu Paris : organiser le plus gros événement
du monde ! »
Claire Penot, récemment diplômée du département informatique de l’INSA Lyon, a rejoint le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 depuis un an et demi. Après une année d’alternance en tant que coordinatrice de projets informatiques, elle est aujourd’hui chargée de relever, en équipe, l’un des challenges les plus complexes que Paris ait connu : l’organisation des JOP2024, dont une partie se déroulera dans l’espace public. Depuis septembre dernier, la jeune experte en systèmes d’informations vit sa première expérience professionnelle à plein régime, à la recherche de solutions opérationnelles.
Vous avez effectué votre dernière année d’études d’ingénieure en informatique en alternance au sein de Paris 2024, le Comité d’Organisation des Jeux. En quoi a consisté votre quotidien de Project Management Officier1 (PMO) ?
Paris 2024 est le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Depuis plus de six ans, il travaille à l’organisation et la planification des prochains Jeux. J’y ai décroché une alternance pour ma dernière année d’études, lors d’un évènement de recrutement, intitulé « Meet & Match ». De prime abord, on ne s’imagine pas les besoins en systèmes d’informations que peut nécessiter un évènement sportif comme les Jeux. Pourtant, c’est plus de 150 applications qui seront livrées pour les Jeux 2024, parmi lesquelles on retrouve : la billetterie, le logiciel de gestion des accréditations, l’arbitrage vidéo, des applications pour les athlètes, et bien d’autres ! Chaque application, plus ou moins critique, doit suivre un calendrier de livraison précis, découpé en grandes phases : design, appel d’offres, développement informatique… Mon rôle en tant que PMO était de coordonner la livraison de toutes ces applications. En étroite collaboration avec les équipes projet, il me fallait rapporter l’état de chaque chantier de manière fiable et précise, tout en identifiant les risques qui pourraient survenir. Ces rapports permettent ensuite aux responsables de prendre des décisions. D’ailleurs, pour l’anecdote, c’est Bruno Marie-Rose, diplômé du département informatique qui est le directeur de la Technologie du comité. Ancien sportif de haut niveau, il a même été médaillé de bronze au 4 x 100 mètres lors des Jeux de 1988 alors qu’il était encore étudiant à l’INSA Lyon !
Depuis septembre, vous travaillez à l’intégration opérationnelle de l’évènement dans la ville de Paris. En quoi consiste votre métier ? Comment sollicitez-vous vos compétences d’ingénieure informatique dans celui-ci ?
Les équipes de Paris 2024 sont organisées par « direction métier » et par « cluster géographique ». Je travaille à la direction des Opérations pour le cluster « Paris Centre », le plus dense et le plus challengeant ! En effet, ces Jeux présentent une particularité qui rend les opérations complexes : une partie des épreuves se dérouleront dans l’espace public : sur la place de la Concorde, l’esplanade des Invalides ou le pont Alexandre III par exemple. Les épreuves sur route comme les courses parcourront aussi le centre de Paris et de nombreuses épreuves auront lieu en simultané. Ce sont des opérations complexes, mais c’est aussi ce qui fait la magie de ces Jeux ! Au quotidien, je travaille avec les équipes internes, la Ville de Paris et la Préfecture de Police pour assurer la compatibilité et le bon déroulement de ces épreuves : il s’agit de garantir leur cohabitation avec les riverains et la vie économique parisienne, ainsi que de planifier la sécurisation de la zone, et le bon accès -à pied ou en transports- à ces sites pour les spectateurs, les athlètes et tous les accrédités. Pour cette mission, je me suis légèrement éloignée de l’informatique, mais les qualités d’ingénieur restent pour autant indispensables. En effet, un ingénieur INSA apprend à résoudre des problèmes complexes, et dans ce nouveau travail, nous relevons un des challenges opérationnels les plus complexes qu’ait connu Paris : organiser le plus gros événement du monde !

Une partie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se dérouleront
dans l’espace public : un défi d’organisation de taille (©AdobeStock)
Pouvez-vous nous donner une illustration des problématiques soulevées par l’organisation des JOP dans l’espace public ?
Comme vous le savez probablement, la cérémonie d’ouverture présente un concept unique avec le défilé d’athlètes sur la Seine, depuis Bercy jusqu’au pont d’Iéna. Des zones aménagées pour les spectateurs vont être mises en place tout le long de la Seine, sur les quais hauts et les quais bas. Dès le lendemain de la cérémonie aura lieu l’épreuve du Contre-la-Montre, une épreuve de cyclisme qui se court en extérieur et dont le début du parcours longe les quais. Ainsi, dans la nuit du 26 au 27 juillet, les équipes disposeront seulement de quelques heures pour démonter les aménagements, nettoyer, barriérer, sécuriser et habiller le parcours, tout en opérant dans une zone où la circulation sera particulièrement restreinte. Je dois ainsi coordonner les équipes de la cérémonie, les équipes en charge de la compétition et celles de la ville de Paris.
Qu’appréciez-vous le plus dans l’expérience professionnelle, assez unique, que vous êtes en train de vivre ?
Cette expérience, qui est mon premier CDD, est très différente des projets auxquels j’ai pu participer en stage. En effet, l’échéance est fixée au 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d’ouverture, et cette date ne peut sous aucun prétexte être reportée, aucun retard ne sera accepté. Chacun est très responsabilisé, très engagé et très enthousiaste, ce qui est particulièrement appréciable. Nous sommes plus de 2 000 collaborateurs et faisons partie de la même équipe, avec un objectif commun. À l’issue de mon aventure au sein des JOP, je commencerai par me reposer, car la période estivale s’annonce intense ! Pour la suite, rien n’est encore décidé. Le monde de l’événementiel sportif me plaît énormément, mais je reste très attachée au monde de l’IT et cela pourrait me manquer. Peut-être qu’il me sera possible de concilier les deux ? Affaire à suivre !
[1] Coordinatrice de projet en français.

Entreprises
« Les chaufferies collectives sont des lieux sombres mais leurs données peuvent éclairer la facture d’énergie des copropriétés »
Quelques petites actions peuvent permettre d’économiser beaucoup : c’est avec ce principe que Paul Chaussivert, s’est lancé dans le pari de réduire les consommations énergétiques des copropriétés. Avec son entreprise, Captain’ Conso, le diplômé du département génie énergétique et génie de l'environnement de l’INSA Lyon, a fait de sa préoccupation pour la performance énergétique et le bâti, son terrain de jeu. Entretien avec l’ingénieur qui invite les gestionnaires d’immeubles à entamer leur transition énergétique en visitant leurs propres chaufferies collectives.
Un cursus au département GEN, un passage par la Filière Étudiant Entreprendre (FÉE) et un engagement associatif au Proto INSA Club1 lors de vos années étudiantes à l’INSA Lyon… Avez-vous toujours eu cette fibre entrepreneuriale et un intérêt pour la performance énergétique ?
L’intérêt pour la question énergétique est très certainement présent depuis longtemps ! Ma toute première expérience professionnelle chez un exploitant de chauffage m’a fait réaliser l’importance de la performance énergétique. Mon travail consistait à maintenir des chaufferies de résidences, d’écoles ou de bâtiments d’entreprises. En plus de ce rôle, je développais des actions pour améliorer la performance de celles-ci. Ce premier emploi m’a permis de me confronter à la réalité du secteur : en sortant de l’école, j’imaginais un monde automatisé où les machines étaient optimisées. En trois ans, je me suis aperçu que ça n’était pas le cas, et qu’il y avait des choses à faire sur le plan de la performance énergétique. Par exemple au sein des copropriétés, il n’y a pas une grande connaissance technique du système de chauffage ni des consommations. Les copropriétaires ont souvent l’impression qu'une personne est mandatée pour suivre pour eux. En réalité, peu de personnes suivent de près cette question énergétique : ce n’est pas le rôle du syndic et c’est rarement inscrit dans les contrats de maintenance des chauffagistes… Pour résumer, il manquait un tiers de confiance entre la chaufferie et la facture : c’est pour cela que j’ai créé Captain’ Conso. L'objectif est d’effectuer une exploration approfondie des chaufferies, d'extraire et d'analyser des données précieuses de ces espaces souvent méconnus, puis de les communiquer efficacement aux copropriétaires. Et mon expérience au sein de la FÉE m’a certainement beaucoup aidé pour oser me lancer dans l’aventure entrepreneuriale !
Aujourd’hui, vous jouez ce rôle de tiers avec votre entreprise « Captain’Conso » qui est basée sur un modèle économique gagnant-gagnant. Comment fonctionne-t-il ?
On entend beaucoup que pour faire des économies d’énergie, il faut rénover tout son parc en priorité. Cependant, avec quelques petites actions comme l’optimisation des réglages, on peut mesurer une économie qui peut aller de 15% à 20%. Le pari avec Captain’ Conso est de se rémunérer sur les économies réelles. Effectivement, le modèle est basé sur un échange gagnant-gagnant : à l’issue d’une première visite de la chaufferie, je suis en capacité de définir les petites actions à mettre en place pour réduire les consommations. Si le pari est réussi et que la copropriété économise sur sa facture finale, alors nous partageons la moitié de ce montant sur 3 ans. Le client bénéficie de l’expérience d’un ingénieur et d’une réduction de sa facture. De plus, cela augmente le confort des occupants, car nous garantissons une température stable et homogène sur tout le bâtiment. Ce qui est aussi très intéressant dans la démarche, c’est que nous devenons un vecteur de compréhension pour le client autour de la transition énergétique. Même si l’argument principal est économique, les clients restent très intéressés par l’impact positif de leur décision. Il y a un vrai enjeu d’information car vulgariser ce monde de l’énergie, très technique, ça n’est pas toujours très simple. Aujourd’hui, je suis ingénieur mais aussi chef d’entreprise, commercial et plus encore pédagogue sur les enjeux de l’énergie. C’est assez valorisant et motivant car il y a un double effet à mon activité professionnelle. Certains clients vont même plus loin que l’objectif d’économie de 15% à 20% : grâce à la dynamique engagée, j’accompagne désormais l’un de mes clients vers l’étude de la rénovation totale de son parc.

Comment envisagez-vous la suite avec votre entreprise Captain’ Conso ?
L’année 2023 a été pour moi l’occasion du lancement d’une nouvelle entreprise, qui vient compléter l’activité de Captain’Conso pour aller plus loin dans l’optimisation énergétique et environnementale des bâtiments. C’est une histoire insalienne puisque je mène ce projet avec un ami de promotion, Badr Bouslikhin, diplômé du département génie électrique. L’idée est née d’une discussion où je lui partageais des problématiques rencontrées lors de mes interventions. En concevant nos propres objets connectés destinés à optimiser les chaufferies, nous faisons se rencontrer nos expertises respectives : la thermique et l’électronique. Nous commençons tout juste à poser nos premiers équipements avec notre entreprise Thermigo. Je suis très heureux de ce nouveau projet car nous allons aller plus loin dans l’accès à la transition énergétique des copropriétés et cette activité sera complémentaire à celle menée avec Captain’Conso. Pour la suite, les choses viendront d’elles-mêmes, en fonction de ce que nous trouverons sur le terrain. Il y a encore beaucoup à faire !
[1] Le Proto INSA Club (PIC) est une association étudiante qui conçoit et réalise intégralement des véhicules à faible consommation.

Sport
« La voile et la mer m’ont rapidement confronté aux problématiques environnementales »
Vendée globe, route du rhum, transat Jacques Vabre et recordman du tour du monde en solitaire : avec un palmarès long comme le bras, François Gabart, ingénieur INSA, est l’un des plus grands skippers français. Actuellement en direction de Fort-de-France en Martinique dans le cadre de la transat Jacques Vabre, le Mozart de la voile qui a bouclé le tour du monde en 42 jours est aussi un entrepreneur très engagé dans la recherche d’une mobilité plus durable. Portrait d’un skipper qui entend pratiquer la course au large avec le plus faible impact environnemental.
Rigueur, plan action et mise au point : trois compétences nécessaires au métier de marin… mais aussi à celui d’ingénieur.
« On met souvent en opposition mon diplôme d’ingénieur et mon métier de marin, alors que pour moi, c’est parfaitement complémentaire dans le sens où le métier de marin est en grande partie un métier d’ingénieur. Que ce soit à terre ou sur l’eau, le marin doit traiter un nombre de problématiques qui relèvent de l’ingénierie. (…) Plus jeune, j’aimais la technique et j’étais curieux de comprendre comment fonctionnait le monde. À l’époque où j’étais à l’INSA, je ne savais pas que j’allais faire de la voile mon métier. (…) La voile est un sport mécanique, dont une bonne partie du travail consiste à développer et faire évoluer un bateau. Lorsque j'étais étudiant, le week-end, je bricolais mon bateau en appliquant les théories apprises pendant la semaine. C’était quelque part une application très concrète de mes études. »
Passé par la filière ingénieur entreprendre de l’INSA Lyon, il créait pendant ses études « Mer Concept », l’entreprise qui accompagne encore son activité aujourd’hui.
« L’entrepreneuriat m’intéressait déjà et c’est d’ailleurs une compétence indispensable pour le métier de skipper. On ne devient pas marin en allant sur un bateau avec un CV… Il faut savoir trouver des sponsors et vendre son projet. Quand j’étais à l’INSA, j’ai créé Mer Concept, d’abord comme un outil juridique. Au fil du temps, je me suis aperçu que j’avais constitué une équipe autour de moi. Et puis, on se rend compte qu’une entreprise a une responsabilité sociétale et une responsabilité vis-à-vis des gens qui travaillent dans notre écosystème. Je pense profondément que l’entreprise a un rôle social, sociétal et environnemental à jouer et c’est pour cela que nous sommes devenus une société à mission. (…) Mon métier consiste à utiliser le vent pour se déplacer sur la planète ou battre des records pour mon cas. Je trouvais cela dommage d’utiliser ces compétences pour ne gagner « que des courses », entre guillemets. (…) S’est posé la question suivante : comment faire pour que la course au large puisse aider à faire progresser le monde maritime ? Mer Concept a pour objectif d’amener des transferts technologiques vers le monde maritime pour se déplacer plus efficacement. »

©Guillaume Gatefait
Peut-on être l’un des skippers les plus performants de la compétition et un navigateur écolo ? Pour François Gabart, recherche de performance et réduction de l’impact environnemental ne sont pas inconciliables.
« On a la chance d’utiliser dans 99,9 % du temps le vent qui est une énergie renouvelable pour se déplacer mais il est clair que dans notre activité, la construction de nos bateaux a un impact considérable et direct. Il y a également beaucoup d’impacts secondaires liés à l’évènementiel comme le déplacement du public qui vient au départ d’une course par exemple. Aujourd’hui, on en est qu’au début de cette démarche. Des innovations commencent à se développer comme par exemple les outils de détections d’animaux marins ou l’utilisation du panneau solaire qui s’est bien démocratisée ces dernières années. À mon sens, la révolution du vol [grâce à l’utilisation de foils, NDLR] en course au large est une vraie rupture technologique dans nos bateaux et résulte d’une vraie évolution du bateau. On a essayé de faire mieux avec moins : on essaie de moins frotter dans l’eau, grâce au foil qui surélève le bateau sur le niveau de l’eau. Et j’ai bon espoir que cette révolution soit utilisée à d’autres fins que pour l’unique but de faire de la performance. (…) Sur un bateau, on est sur un système isolé. J’ai découvert la voile très jeune, avec mes parents et j’ai vite compris que si l’éolienne ne tournait pas, il n’y avait pas d’électricité le soir au repas. J’ai aussi pris conscience très jeune de la problématique des déchets car sur un bateau, on doit les stocker jusqu’à la prochaine escale : on s’aperçoit du volume des déchets que l’on génère… La voile, la mer m’a permis d’être confronté aux problématiques environnementales très rapidement. Je crois que le bateau un très bon outil pour comprendre et faire face à ces enjeux (…) »

Entreprises
Rewall : des constructions écotouristiques en sacs de terre
Tout récemment diplômés de l'INSA Lyon, Maxime Feugier, Bastien Delaye et Lucas Gehin ont souhaité poursuivre l’aventure entrepreneuriale débutée au sein de la Filière Étudiant Entreprendre. Avec leur projet intitulé « Rewall », les trois jeunes ingénieurs souhaitent prouver que la construction peut allier esthétique, résistance et impact écologique positif à partir d’une idée née dans les années quatre-vingt : l’écodôme en Super Adobe. Ce type de construction bioclimatique sur mesure, couplée à un outil d’Intelligence Artificielle développé par leurs soins, pourrait déployer tout son potentiel.
De la terre et des déchets plastiques
C’est de l’esprit de Nader Khalili, architecte irano-américain, que la technique du Super Adobe est née : une construction en forme de calotte qui semble être tout droit sortie de la planète Tatooine dans Star Wars. Pourtant, sous ses allures de maison de hobbit, l’écodôme offre des possibilités architecturales infinies et une efficacité énergétique très performante. « Le Super Adobe consiste à empiler des sacs en polypropylène tissés remplis de terre et de déchets plastiques, en remplacement des parpaings. Empilés très rapidement et une fois enduits de chaux et de chanvre, ce type de construction présente des propriétés isolantes et mécaniques très intéressantes, avec une empreinte carbone très réduite », introduit Lucas Gehin, diplômé du département génie industriel. La forme conique assure à la construction une stabilité et une résistance capable de résister aux séismes et aux vents violents. Originellement développé pour les activités de la NASA, le Super Adobe pourrait même résister aux tempêtes de poussière lunaire. Quant à son efficacité énergétique, elle est sans appel. « Pour une surface de 20m2 construite en Super Adobe, on trouve une moyenne de 22 degrés de température en été, pour 35 fois moins de Co2 émis par rapport à une construction en béton », ajoute l’ingénieur. Face à ce constat, le groupe1 engagé dans le projet « Rewall » a vu une occasion concrète de faire rimer « génie civil » et « environnement ». Mais comment tirer parti de l’impact positif de cette technique capable d’allier esthétique, résistance et réutilisation des déchets ?

Remplis de terre du site et de déchets plastiques, empilés en un temps record et enduits à la chaux,
les sacs forment un dôme reconnaissable, confortable et qui garde la fraîcheur en été.
(©F DVIDSHUB - New eco-dome signals changes for local village, Djibouti)
Des hébergements écotouristiques
« Les constructions en Super Adobe sont très souvent utilisées comme hébergements dans les zones à risque, qui contrairement aux assemblages en tôle, peuvent représenter une alternative très durable et rapidement construite. Nous avons souhaité explorer une autre destination, celle du tourisme. Nous avons pensé que le Super Adobe pouvait être utile pour des hébergements touristiques, secondaires ou insolites et permettre de diffuser la culture d’une construction low-tech, qui contrairement aux idées reçues, ne fait pas l’impasse sur le confort », ajoute Maxime Feugier, diplômé du département génie civil et génie urbain.
Avec l’aide de certains camarades en double-cursus ingénieur-architecte et le concours de quelques enseignants-chercheurs du département GCU, ils travaillent les designs et la faisabilité technique de leurs écodômes. Résultat ? Pour un prototype final de 20 m2, la construction nécessite une cinquantaine de kilos de sacs en polypropylène, « soit quelques chaises de jardin », illustrent les jeunes ingénieurs. « Nous avons participé à un salon qui réunissait des acteurs majeurs de la construction et nous avons senti l’intérêt de bon nombre d’entre eux. Seulement, nous avons aujourd’hui un obstacle de taille : les assureurs restent encore frileux quant aux nouvelles techniques de construction. »

« Rewall One » : une habitation écologique et hors du commun, offre la possibilité d’accueillir deux personnes en autonomie totale sur le plan thermique et électrique. Avec ses 16m2, cet habitat dispose d’une kitchenette et d’une salle de bain. (©Rewall)
Un outil d’IA au secours des archis
En développant les constructions du projet « Rewall », Maxime, Lucas et Bastien ont fait un constat : dans le métier d’architecte, l'ébauche de plan est une activité très chronophage. « Pendant nos travaux préliminaires, nous avons développé une solution d’intelligence artificielle qui offre la possibilité de produire, à partir des dessins de nos prototypes à la main, une retranscription numérique. Nous souhaitons poursuivre le développement de cet outil pour soutenir les architectes dans leurs rendus visuels car aujourd’hui, certains logiciels ou plug-ins permettent d’ajouter de la texture ou de la lumière aux différents plans, mais c’est un travail très fastidieux. SamIA, qui est le nom donné à notre outil, permet de générer quatre propositions de prototypages à partir d’une ébauche manuelle. En travaillant avec nos camarades en double cursus ingénieur-architecte, nous avons vu le potentiel », conclut Bastien Delaye, également diplômé du département génie industriel.
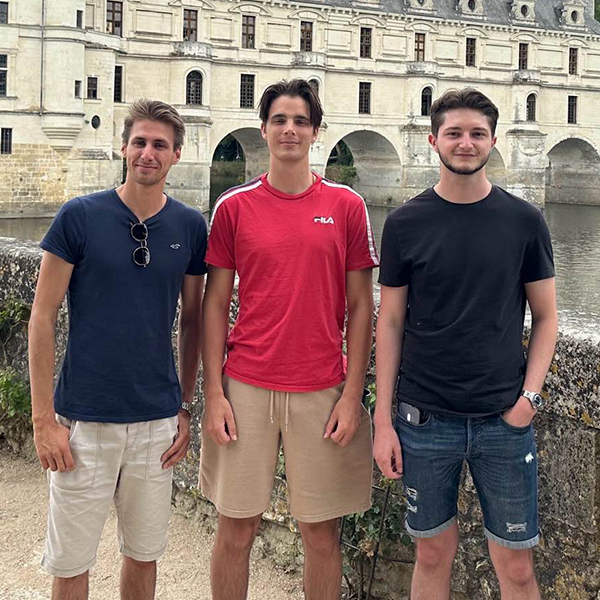
(De gauche à droite) : Maxime Feugier, Lucas Gehin et Bastien Delaye, diplômés de l’INSA Lyon,
veulent prouver que « construction » peut rimer avec « environnement ».
Le projet « Rewall » a été soutenu par les « coups de pouce entrepreneurs » de la Fondation INSA Lyon.
[1] Au commencement du projet, l’équipe était composée de six membres, élèves-ingénieurs et membres de la Filière Étudiant Entreprise (Maxime Feugier, Bastien Delaye et Lucas Gehin, Dimitri Lazarevic, Samia Tahiri et Walid Da Costa).

