
INSA Lyon
L’Édito de rentrée de Frédéric Fotiadu, directeur de l'INSA Lyon
« Cette rentrée est de nouveau, et plus que jamais, placée sous le signe de l’urgence climatique et environnementale avec une volonté, réaffirmée par l’INSA Lyon, de poursuivre et renforcer sa transformation pour relever le défi des transitions.
Cette transformation systémique de notre établissement face aux enjeux socio-écologiques est au cœur de notre stratégie Ambitions 2030, adoptée par notre conseil d’administration fin 2020. Le Contrat d’Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP), que nous nous apprêtons à signer avec notre Ministère, vise à accélérer cette dynamique dans les trois années qui viennent. En ce début d’année, je vous propose un point sur les éléments saillants de ce COMP, qui constitue une nouvelle modalité d’interaction avec notre Ministère.
En matière de formation, dans la continuité de l’évolution de nos enseignements menée en partenariat avec The Shift Project, nous allons déployer une approche par compétence totalement renouvelée pour confronter, toujours plus, nos élèves à des problèmes complexes et transdisciplinaires qui les incitent à proposer et mettre en œuvre des solutions technologiquement fiables, économiquement viables et qui contribuent à la transformation socio-écologique et numérique des organisations.
Afin de toujours mieux répondre aux besoins des entreprises sur de nouveaux types de profils dans des secteurs en tension, nous lançons aussi de nouvelles formations de Bachelors d’Assistant Ingénieur « Mutations Industrielles et Technologiques », accréditées par la Commission des Titres d’Ingénieurs. Ce projet est porté dans le cadre du Collège d’Ingénierie, l’alliance que nous avons mise en place avec Centrale Lyon, l’ENTPE et Mines Saint-Etienne en novembre 2022.
Toujours avec le Collège d’Ingénierie, nous allons poursuivre cette année l’élaboration d’une offre renouvelée de formation tout au long de la vie, portée par INSAVALOR, notre filiale de valorisation, afin de mieux accompagner la transition socio-écologique des entreprises.
L’INSA renforce également, de manière significative, son engagement dans l’entrepreneuriat étudiant. Notre filière Étudiants Entrepreneurs a notamment évolué depuis l’année dernière afin de générer et d’accompagner davantage de projets technologiques à impact positif.
L’évolution de notre formation passe aussi par de nouveaux projets à l’international, en particulier avec l’Alliance européenne ECIU (European Consortium for Innovative Universities), dont le groupe INSA est membre depuis 2019. Avec ECIU, nous souhaitons accélérer cette année le déploiement d’une approche innovante, basée sur une pédagogie par défi (challenge-based learning), en lien avec des problématiques concrètes d’acteurs institutionnels et économiques de nos différents territoires, confrontés à des enjeux de transition.
Au-delà de l’Europe, notre modèle d’ingénieur humaniste au service d’un développement soutenable suscite un fort intérêt au Maroc et en Chine. Nous allons ainsi poursuivre des discussions engagées à l’échelle du Groupe INSA, avec l’UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique) au Maroc et l’Université Beihang en Chine, afin de faire émerger des coopérations en matière de formation et de recherche.
En matière de recherche, après une première expérimentation à l’échelle du Collège d’Ingénierie, nous poursuivons le déploiement, à plus large échelle, de bouquets de thèses thématiques et pluridisciplinaires. Visant à favoriser des approches interdisciplinaires de problématiques liées à la transition socio-écologique, ces bouquets sont constitués de quatre ou cinq thèses, coordonnées autour d’un même enjeu et menées simultanément au sein de laboratoires de recherche, de disciplines et d’établissements différents, y compris dans le champ des sciences humaines et sociales.
À l’échelle du site Lyon-Saint-Etienne, nous allons également poursuivre, avec l’ensemble des autres établissements, nos réflexions afin de voir comment nous pourrions articuler et animer de façon coordonnée nos masters, écoles doctorales, unités de recherche autour d’un champ disciplinaire, en vue de favoriser l’émergence d’une stratégie partagée dans le domaine de la recherche et de la formation à la recherche.
Si la mobilisation pour la transition écologique et sociale est véritablement inscrite, à la fois au cœur des projets de formation, de recherche et de développement à l’international de l’INSA Lyon, nous avons aussi fait le choix, de l’aborder d’une manière singulière, avec « l’Assemblée INSA pour la transition écologique et sociale ». Lancée au mois de mai dernier, et financée en partie par la Fondation INSA Lyon, cette démarche participative et coopérative, inédite par son ampleur et son ambition, vise à interroger nos missions et activités, au regard des enjeux socio-écologiques. La stratégie de l’établissement sera actualisée en conséquence.
Plus que jamais engagés sur les enjeux de diversité, d’ouverture sociale et territoriale, nous poursuivons en cette rentrée les nouveaux dispositifs que nous avons initiés l’an dernier afin de faciliter l’orientation, renforcer l’accompagnement et favoriser la réussite des élèves : INS’AVENIR, le Premier cycle INSA Martinique Caraïbe, l’Include Campus ou encore la classe préparatoire aux études supérieures « sciences et technologies industrielles » ouverte par le lycée Arbez Carme sur le territoire d’Oyonnax.
À l’échelle du Groupe INSA, nous proposons également un ambitieux projet dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et Métiers d’Avenir » (AMI CMA), qui vise à élaborer et expérimenter de nouvelles approches pour diversifier le vivier de lycéens généraux intégrant l’enseignement supérieur, qu’il s’agisse de diversité de genre, de diversité sociale et territoriale.
Toujours dans le cadre de l’AMI CMA, nous proposons un deuxième projet, porté cette fois-ci par le Collège d’Ingénierie, afin d’accompagner et de former davantage de jeunes sur les métiers de l’industrie. Ce dispositif vise notamment à créer une année de « remédiation et d’exploration » post-bac, à poursuivre le développement de spécialités du Bachelor d’assistant ingénieur sur les mutations technologiques et industrielles, et à mettre en place une nouvelle voie d’accès au titre d’ingénieur, en s’appuyant sur des dispositifs de Validation des Acquis de l’Expérience et de Formation Tout au Long de la Vie.
Ces deux projets font l’objet de demandes de financements importants et leur mise en œuvre reste bien évidemment soumise à l’obtention des moyens humains et financiers requis.
Voici ainsi un aperçu, non-exhaustif, des axes prioritaires pour cette nouvelle année universitaire. Des engagements absolument majeurs pour renforcer la mobilisation de notre établissement, et de l’ensemble de ses parties prenantes, au service de la transition sociale et écologique à tous les niveaux de notre organisation.
Bonne rentrée à toutes et tous. »

Formation
Inauguration de l’Include campus
Mercredi 10 janvier 2024, Danielle BALU, Sous-Préfète de Nantua, Gabriele FIONI, Recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Catherine STARON, Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, Jean DEGUERRY, Président du Département de l'Ain, Michel MOURLEVAT, Président de Haut-Bugey Agglomération, Michel PERRAUD, Maire d’Oyonnax, Véronique RAVET, Maire de Bellignat, et Frédéric Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon ont inauguré l’Include campus.
Projet démarré dès 2020, l’Include campus répond à une priorité du gouvernement et de la région de développer l’enseignement supérieur en dehors des grandes métropoles. Sur le territoire aindinois, il permettra de former les talents dont a besoin la Plastics Vallée. Il répond également à la Stratégie Ambitions 2030 de l’INSA, visant à renforcer l’ouverture sociale et territoriale et toujours mieux accompagner les entreprises à relever les défis des grandes transitions.
Financé par l’Agence Nationale de Recherche « INCLUDE, pour une Université Inclusive » porté en 2021 par l’Université Claude Bernard Lyon 1 et dont l’INSA Lyon est l’un des partenaires, ce dispositif s’adresse à la fois aux futurs bacheliers, aux étudiants souhaitant changer de filière, aux salariés, aux demandeurs d’emploi et aux personnes en reconversion professionnelle. Ouvert à la rentrée 2023, l’Include Campus d’Oyonnax permet de suivre plus de 150 formations diplômantes en ligne.
Frédéric Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon, a souligné lors de l’inauguration que « l’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs à accueillir sur l’un de ses campus ce type de dispositifs. L’environnement scientifique, technologique, humain et les infrastructures dont nous disposons sur le site d’Oyonnax-Bellignat méritaient d’être mis au service d’une si belle ambition ».

C’est réellement un dispositif « tremplin » qui garantit à une promotion d’étudiants de mener à bien des études supérieures à distance, tout en bénéficiant des services et des facilités du campus d’Oyonnax. À ce titre, l’Include Campus répond à plusieurs enjeux et je voudrais en citer trois. L’enjeu de territoire. (…) 25 % des familles en milieu rural envisagent des études longues contre 45 % en milieu urbain et un lycéen sur deux « s’autocensure » dans le choix de son orientation post-bac en raison de difficultés liées à la mobilité. Un Enjeu économique. Aujourd’hui, dans un contexte de marché immobilier privé saturé, il est de plus en plus compliqué pour nos étudiants de se loger dans les grandes villes, le modèle d’université doit se réinventer, impliquant des changements d’organisation et d’articulation de nos campus avec la ville et les territoires. Un Enjeu d’inclusion : l’université se caractérise par l’autonomie de l’étudiant mais aussi de façon corollaire par un décrochage scolaire chaque année. Le tutorat et mentorat renforcés, personnel d’appui dédié, accès aux services et ressources d’orientation, de santé, hébergement… sont intégrés au campus d’Oyonnax ». Danielle BALU, Sous-Préfète de Nantua
« L'Include campus est une des briques d'un ensemble novateur de dispositifs déployées par l'INSA à Oyonnax, en partenariat avec l'Université Claude Bernard, grâce à l'investissement de l’État et des collectivités territoriales. Ce campus connecté vise à créer un dynamisme et un environnement propice à la réussite académique et à l’inclusion des étudiants. En offrant une multitude de formations, de ressources et de services, il ambitionne de faciliter leur parcours éducatif, favorisant ainsi leur épanouissement personnel et leur accomplissement dans leurs études. Cette approche intégrée illustre l'engagement de l'INSA à soutenir activement l'accès aux études de la nouvelle génération, sur le territoire d'Oyonnax, en fournissant un cadre stimulant et adapté aux défis contemporains. » Gabriele FIONI, Recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
« Inaugurer l’Include Campus Oyonnax de l’INSA, c’est répondre à deux engagements forts que nous portons avec Laurent Wauquiez : former plus d’ingénieurs et de techniciens pour nos entreprises et développer l’enseignement supérieur de proximité. L’offre proposée par l’Include Campus est une formidable réponse aux défis de la territorialisation des formations de l'Enseignement Supérieur que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est très fière de soutenir. Je me réjouis également qu’à la rentrée 2024, l’INSA Lyon, première école d’ingénieurs post-bac, proposera à Oyonnax deux nouvelles formations d’ingénierie pour soutenir la transformation du secteur de la plasturgie si important dans l’Ain et au cœur des enjeux du plan Région des ingénieurs et des techniciens. » Catherine STARON, Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l’Enseignement supérieur, à la Recherche et à l’Innovation

« L’Include Campus et les nouveaux dispositifs de formation développés par l’INSA sur son site d’Oyonnax servent une ambition sans cesse renouvelée et toujours adaptée au territoire. Je me réjouissais de l’année 2023 [Ouverture d’une Classe Préparatoire aux Études Supérieures « sciences et technologies industrielles », un nouveau collège à Saint-Didier-de-Formans, 75 places en première année de PASS (Parcours Accès Spécifique Santé) à Bourg-en-Bresse depuis 2023, …] mais 2024 illustrera encore le dynamisme de notre territoire avec un nouveau diplôme d’ingénieur de spécialisation, pour accompagner la transformation du secteur de la plasturgie et une formation de Bachelor, débouchant sur la fonction d’assistant ingénieur. » Jean DEGUERRY, Président du Département de l'Ain
« Avoir l’opportunité de suivre une des 150 formations diplômantes en ligne proposés dans tout un panel de domaines est une véritable opportunité pour tous les étudiants de notre bassin. Faire des études supérieures coûte aujourd’hui de plus en plus cher, et nécessite souvent de faire de longs trajets. Ce nouveau service offert à notre population est très précieux que ce soit dans une continuité ou pour des reprises d'études. » Michel PERRAUD, Maire d’Oyonnax
Cette inauguration s’est tenue en la présence de Christine Godet, Déléguée Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Polyvia, Benoît Dorsemaine, Directeur Emploi Formation de Polyvia, Joël Viry, Président de Polymeris et du Plasticampus, Béatrice DE COSAS, Proviseure du Lycée Arbez Carme, et les représentants de l’AEPV.
L’Include Campus s’inscrit dans le nouveau projet de développement du campus d’Oyonnax. A la rentrée 2024, deux nouvelles formations seront ouvertes : un Bachelor d’Assistant Ingénieur (BAC+3) et un diplôme d’ingénieur de spécialisation (BAC+6). Ces nouvelles formations veulent attirer de nouveaux talents sur le site d’Oyonnax et enrichir la vie de notre campus de ces étudiants venant de différents horizons, qui pourront s’y côtoyer.

Formation
Webinaire Intégrer l'INSA Lyon en 3e année
🎙️Vous souhaitez intégrer l'INSA Lyon en 3e année après une classe préparatoire, un BTS, un BUT ou un DUT ?
Les études d’ingénieur INSA sont aussi accessibles après un bac+2 en intégrant directement un département de spécialité.
🎙️Laurent Lebrun, directeur de la formation à l'INSA Lyon vous donne rendez-vous mardi 5 décembre à 19h00 pour parler des admissions en 3 année et répondre à vos questions.
✨ Webinaire ouvert à tous sans inscription => https://bit.ly/webinaire_admission_insalyon_3eannee
Additional informations
- https://bit.ly/webinaire_admission_insalyon_3eannee
-
En ligne => https://bit.ly/webinaire_admission_insalyon_3eannee

Vie de campus
Pique-nique de découverte étudiante des conseils de départements
Quoi de mieux qu'un pique-nique pour faire connaissance ?
Partager son expérience dans les départements l'année écoulée, parler des projets et des opportunités à venir, se présenter, discuter, s'informer sur les conseils de département, tels sont les buts de cette rencontre.
Plus particulièrement, il s'agit de :
- Faire se rencontrer les élèves-ingénieurs intéressés pour rejoindre les conseils de département pour monter des listes solides et construites ensemble.
- Rapprocher les différents départements (FIMI inclus) pour continuer à partager les problématiques, à s'entraider et à faire poids dans la politique des départements et de l'établissement.
- Passer un moment convivial.
Additional informations
- esteban.vaissiere@insa-lyon.fr
-
Pelouse des Humanités

Formation
SYSTRA-INSA Lyon : un nouveau partenariat au service de nos étudiants
Depuis cette année, le département Génie civil et urbanisme (GCU) de l’INSA Lyon propose un nouveau module de cours piloté par des collaborateurs de l’entreprise SYSTRA. Avec pour objectif de faire monter en compétences nos étudiants dans la gestion de projet, ces nouveaux modules ont été construits par les équipes de SYSTRA aguerries à cette thématique et proposés à 100 étudiants du département en 4GCU. La pédagogie est ainsi articulée autour de véritables cas d’études issus du monde professionnel.
Les étudiants ont ainsi pu développer leurs compétences dans le domaine du management de projet sous ses différents aspects de cadrage et de pilotage, les aspects financiers, les risques et les opportunités, la mise en œuvre puis la clôture.
Ces cours se sont tenus sur un semestre avec 30 heures de face à face (10 heures de cours et 20 heures de projet pour chaque étudiant).
« Le partenariat entre SYSTRA et le département GCU de l'INSA Lyon est un développement passionnant qui ouvrira de nouvelles opportunités aux étudiants. Cette collaboration a débouché sur un nouveau module de cours qui est désormais proposé aux étudiants du département GCU. Le module offre aux étudiants l'occasion de se familiariser avec les dernières techniques de gestion de projet en ingénierie. Avec ce nouveau module de cours, les étudiants peuvent mieux comprendre les rôles joués par les différents acteurs d’un projet d’ingénierie et ainsi accéder à des opportunités d'emploi au sein de SYSTRA et de ses partenaires.
« Cette collaboration entre l’entreprise SYSTRA et le département GCU de l'INSA Lyon est une étape innovante pour mettre en avant des exemples concrets pour nos étudiants. En effet, fournir à nos étudiants les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour devenir des professionnels performants passe par de réelles mises en situation et le retour d’experts. Une entreprise comme SYSTRA nous permet de montrer à nos étudiants leur futur rôle demain en entreprise. »
Jean-Francois Georgin, Directeur du département génie civil et urbanisme (GCU)

Formation
Former les élèves-ingénieurs à s’emparer des futurs souhaitables
L’ingénieur1 doit-il se contenter d’être le rouage d’un système qui étend les logiques d’exploitation et de marchandisation du monde ? Aujourd’hui, la représentation majeure de l’ingénieur ne peut plus être défini par le seul prisme d’une efficacité technique, posant l’Homme comme « maître et possesseur de la nature ». Désormais, comme pour beaucoup d’activités professionnelles, l’horizon de la fonction d’ingénieur se doit d’être repensé dans les limites planétaires.
Dans le cadre du chantier de l’évolution de la formation INSA, le groupe de travail « quels futurs possibles et souhaitables ? », s’est attelé à mettre en mots une vision répondant à la question suivante : comment amener les élèves-ingénieurs à retrouver la possibilité d’un futur souhaitable, quand le progrès scientifique et technique se heurte déjà aux limites physiques et humaines de notre planète ? À la convergence de la quête de sens des étudiants et celle d’un établissement dont la raison d’être est de former des individus conscients de leurs choix, il est nécessaire de construire une nouvelle dialectique et de nouveaux récits. Entretien avec quatre enseignants du groupe de travail.
L’ingénieur : un rouage dans un système
À travers son activité professionnelle, l’ingénieur alimente la construction et le développement de systèmes techniques qui s’imposent aux sociétés et aux écosystèmes. L’héritage de Descartes, par lequel l’Humain s’est posé en maître de son environnement, continue d’opposer l’Homme et la nature. L’urgence climatique et la quête de sens des individus tendent à remettre en question ce principe philosophique. « Dans notre système de société, basé sur l’exploitation et la marchandisation, il y a une difficulté croissante à contrôler le phénomène technique. Quand l’optimisation, la performance ou la production sont réduits à leur seule dimension technique, celui-ci peut souvent sentir lui échapper les conséquences de ses actions », introduit Romain Colon de Carvajal, enseignant en génie mécanique. Pourtant la technique, par les créations qu’elle rend possible, est un moyen privilégié de penser l’action de l’Homme sur le monde. « En réalité, ça n’est pas qu’un débat technique et scientifique. Admettre que l’innovation puisse répondre aux grands défis et aux crises contemporaines force à poser des limites qui ne sont pas seulement techniques et physiques. L’innovation, qui ne peut plus être envisagée liée à une société de consommation débridée, pose des questions très politiques. Quel type de société souhaite-t-on réaliser ? Quelles valeurs veut-on véhiculer à travers la technique ? »
Des futurs possibles et souhaitables
« Qui sommes-nous ? Que peut-il advenir ? Que pouvons-nous faire ? Que devons-nous faire ? ». Ces quatre questions empruntées à la démarche Prospective de Gaston Berger, ont constitué l’ossature de la réflexion des membres du groupe de travail. Elles soulignent également l’aspect démocratique et politique du débat. Si le fondateur de l’école entendait former « des philosophes en action » en 1957, quelle école imaginerait-il aujourd’hui, pour faire agir l’ingénieur dans un espace sûr et juste pour l’humanité ? « Gaston Berger parlait de relations sociales, d’identité et de sens. En ouvrant la formation technique aux Humanités2, il tentait d’introduire une capacité politique chez l’ingénieur afin de penser les conséquences de ses actions. Aujourd’hui, il est nécessaire d’intégrer à cette réflexion, les problématiques se rapportant à l’anthropocène : les limites de la Terre sont des phénomènes physiques qui amènent à nous questionner sur le sens de l’Humanité », poursuit Marie-Pierre Escudié, enseignante en sciences humaines et sociales. Alors à quels futurs possibles et souhaitables l’ingénieur doit-il se vouer ? La question, presque oratoire, soutient une obligation de démocratie. « Il ne s’agit pas de penser le futur à la place des élèves-ingénieurs, mais bien de les mettre en capacité de le construire par eux-mêmes. Pour cela, il nous faut instaurer un double mouvement, individuel et collectif. Notre rôle est de leur permettre de trouver un espace de responsabilité où ils se sentent en capacité d’agir. »
Une éthique renouvelée de l’innovation pour l’ingénieur
Si l’un des rôles premiers de l’ingénieur consiste à éclairer les choix de société par leurs connaissances techniques et en sciences humaines et sociales, l’enjeu pédagogique d’une telle formation est de donner les clés pour innover en conscience. « Il faut cultiver l’optimisme, car il permet de dépasser l’angoisse des défis qui se dressent devant nous et sert de catalyseur pour apporter des solutions innovantes. L’ingénieur en tant que philosophe en action doit être capable d’éviter la production de fausses bonnes idées, qui tendent à invisibiliser les problèmes ou conduisent à des effets rebonds », prévient Joëlle Forest, maîtresse de conférences en épistémologie et histoire des techniques à l’INSA Lyon. « Qu’il adopte une posture de médiateur ou de diplomate-polyglotte, l’ingénieur pour réarticuler l’innovation à un dessin moral pour la société devra s’interroger sur les valeurs que véhiculent ses innovations : vont-elles vers plus ou moins de liberté, d’égalité, d’autonomie, de sécurité ou de convivialité ? »
Prendre le chemin de l’éthique et de l’action collective
Pour amener les futurs ingénieurs à développer leur espace de responsabilité, les membres du groupe de travail ont ainsi synthétisé plusieurs objectifs d’apprentissages fondamentaux. « Notre réflexion et le livrable qui en a découlé sont majoritairement une synthèse des pratiques existantes au sein des départements et au centre des Humanités. Nous avons surtout travaillé à donner une meilleure visibilité des pratiques qui n’étaient pas nécessairement communiquées ni partagées au sein de la communauté et qui ont pourtant beaucoup à apporter à l’évolution de la formation d’ingénieur INSA », ajoute Thomas Le Guennic, professeur agrégé de sciences économiques et sociales à l’INSA Lyon. « Sur le principe, il s’agit d’aider les élèves à démêler les idéologies, à décoder les relations d’interdépendances et comprendre la nécessité d’adapter les moyens aux finalités et les besoins aux ressources. Aussi, au titre de citoyen, futur salarié ou chef d’entreprise, avant de pouvoir s’engager dans l’action collective et cultiver un futur, il est nécessaire que chaque élève puisse connaître les valeurs qui l’animent individuellement, avant d’accepter les chemins de traverse et les échecs comme faisant partie du changement. »
Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année. Elle est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :
▪️ Anthropocène et climat
▪️ Énergie
▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact
▪️ Enjeux du vivant
▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?
▪️ Calcul numérique
▪️ Sciences des données et intelligence artificielle
▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique
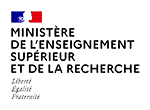
« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »
[1] Le masculin est utilisé à titre épicène et sans aucune discrimination de genre.
[2] La formation en humanités a pour objectif de doter ses élèves d’un solide bagage de compétences transversales, donner des clés de compréhension et des leviers d’action dans un monde complexe, en affirmant une vision socialement et écologiquement responsable.

Formation
"Il faut développer une approche critique du numérique dans la formation des élèves-ingénieurs"
Il apparaît aujourd’hui évident que le numérique bouleverse l’ensemble des domaines de la société ; une omnipotence qui transforme en profondeur nos existences et dont les enseignants investis dans l’évolution de la formation se sont saisis, avec deux objectifs : transformer la pédagogie pour consolider une culture minimale sur l’outil et développer une approche critique du numérique dans la formation des élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon.
Au sein du groupe de travail dédié aux « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique », la réflexion est partie du constat suivant : qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, de production logicielle ou d’appareils digitaux, les outils du numériques sont principalement créés par des ingénieurs. Il est donc urgent, au-delà de former les futurs professionnels à la maîtrise proprement technique, de leur faire entrevoir les réalités sociétales et philosophiques qui s’y rattachent. Lionel Morel, enseignant-chercheur au département informatique et laboratoire CITI, et David Wittmann, enseignant au centre des Humanités sont tous deux animateurs du groupe de travail « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique ». Dans cet entretien, ils résument les travaux menés pour intégrer ces enjeux à la formation INSA.
Lorsque l’on parle d’enjeux environnementaux du numérique, le premier « impact » criant se rapporte souvent à la réalité matérielle des objets. Cependant, les propositions et les objectifs pédagogiques établis par le groupe de travail veulent aller plus loin.
Lionel Morel : Environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liés au numérique. Le mythe du numérique « propre » ayant largement investi l’inconscient collectif, il est nécessaire de les former à développer des outils pour évaluer, contrôler et réduire l’impact du matériel numérique. Cependant, il est tout aussi indispensable de les initier à déconstruire ce mythe. Les effets d’une utilisation massive du numérique ne sont pas seulement matériels. Un objet technologique a des effets indirects et modifie une activité humaine en induisant des effets sur la société ; souvent, cet aspect n’est pas intégré par la personne qui conçoit ces objets numériques. À travers nos réflexions avec le groupe de travail, nous avons souhaité dépasser le cœur technologique et technique, et élargir le champ de l’acculturation de nos étudiants jusqu’à la politique, l’éthique et le juridique. L’ambition est de leur offrir une vision globale des enjeux engagés par le numérique. Nous voulons faire prendre conscience que la technologie n’arrive pas ex-nihilo ; elle est en interaction avec les sociétés humaines.
Vous avez ainsi débuté l’élaboration d’une méthodologie permettant d’aborder les enjeux environnementaux et sociétaux du numérique dans les enseignements, « à partir du réel ». En quoi consiste-t-elle ?
Lionel Morel : Une phase exploratoire assez conséquente a été nécessaire pour aboutir à une première ébauche de méthode pédagogique, avec une vision « en oignon ». L’idée principale est de mettre en évidence les impacts et les imaginaires sous-jacents, à partir d’un objet technique du réel. Prenons l’exemple de la vidéo-surveillance : les enjeux techniques sont ceux de la fabrication d’une caméra, de l’utilisation efficace et optimisée des données produites. Mais le déploiement de cette même technologie ne s’arrête pas aux enjeux techniques : il peut interroger le modèle économique des entreprises développeuses ou les potentiels lobbys impliqués. Ensuite, il comporte des dimensions éthiques et juridiques auxquelles il faut répondre : par exemple, la question des droits d’accès aux informations personnelles ou le droit à l’image. La couche supérieure de la réflexion peut porter sur les ressources nécessaires, le renouvellement du matériel défectueux, ses coûts écologiques… Enfin, la dernière couche s’intéresserait aux imaginaires liés à l’objet technique en lui-même. Pour le cas de la surveillance des populations, la littérature ou les médias internationaux en regorgent… Une fois ce travail réalisé, idéalement, il faudrait faire le travail dans le sens inverse, en faisant de la dernière couche, la plus importante : vers quel imaginaire voudrait-on aller ? C’est déconstruire pour mieux reconstruire.
Le groupe de travail a identifié quatre imaginaires très caractéristiques des manières usuelles et populaire de se rapporter au numérique. Quels sont-ils ?
David Wittmann : Effectivement, on pourrait croire que le fonds de commerce de la littérature dystopique ne dépasserait pas les pages des romans ni les écrans de cinéma, pourtant, les imaginaires du numérique sont très ancrés dans l'inconscience collective. Le premier se rapporte à l’immatérialité : c’est un mythe qui laisse penser que le numérique est propre et qu’il n’a pas d’impact environnemental. Le second se rapporte à l’immédiateté et consiste à considérer que le numérique permet de faire et d’avoir tout, dans l’instant. C’est d’ailleurs une notion qui camoufle totalement les médiations bien humaines qui nous permettent d’accéder aux applications comme les travailleurs de l’ombre, les modérateurs de contenus ou même les préparateurs de commande. Le troisième imaginaire est celui de la neutralité : penser que les algorithmes sont immunisés des biais humains et des jugements moraux. Pourtant, derrière les algorithmes, il y a des programmeurs et des organisations qui portent, en conscience ou non, des idées et des valeurs morales. Le dernier mythe que nous souhaiterions aborder est celui de l’absolue nécessité de la technologie numérique : souvent présenté comme solution à tous les maux, le numérique fait l’objet d’un grand récit solutionniste qui traverse notre société et évite d’interroger la réalité des besoins ou de contester l’efficacité du numérique face à des solutions plus traditionnelles.
Ces quatre grands mythes seront une base pour développer l’esprit critique des étudiants. Ce faisant, les futurs ingénieurs seront plus à même de construire des outils numériques socialement et écologiquement responsables, et seront aussi armés, en tant que citoyens, pour adopter une attitude réflexive et critique, et pour prendre part aux différents débats qui animent nos sociétés.
L’approche développée par le groupe de travail « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique » propose également d’enseigner les concepts à la base de la pensée algorithmique. Pour quelles raisons ?
David Wittmann : Il y a, à la base de la pensée algorithmique, l’idée qu’un problème, quel qu’il soit, peut être résolu par une machine qui sait lire et exécuter des commandes. Cependant, pour formaliser le problème, il faut en créer un modèle abstrait pour espérer que la machine le résolve. L’abstraction permet l’efficacité pratique, mais elle porte aussi en elle le germe d’une réduction de la complexité, en particulier du social. Il existe un caractère universel dans le numérique, qui prétend qu’une machine pourrait tout faire. Un raccourci se joue ici : on imagine que tout problème peut être résolu par un ordinateur ou une application numérique et par extension, par la technologie. Mais les informaticiens savent très bien qu’il y a des limites, des problèmes qui ne peuvent être résolus de manière exacte, par une machine. Faire comprendre cela à nos étudiants amène à les faire se questionner sur la différence entre innovation numérique et progrès social. Pour chaque objet numérique, il faut que l’ingénieur qui fait l’innovation se pose la question de savoir quelle est la société qui se construit à travers cet objet et si nous voulons d’une telle société. Quelle forme de vie, quelle humanité construisons-nous à travers les techniques que nous mettons en œuvre ?
Le groupe de travail dédié aux « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique » est composé de huit membres actifs : Frédérique Biennier (IF), Adina Lazar (BS), Lionel Morel (IF), Céline Nguyen (CDH), Christine Solnon (IF), Jean-François Tregouet (FIMI), Erin Tremouilhac (CDH) et David Wittmann (CDH).
Une (r)évolution de la formation d’ingénieur à l’INSA Lyon
Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année et est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :
▪️ Anthropocène et climat
▪️ Énergie
▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact
▪️ Enjeux du vivant
▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?
▪️ Calcul numérique
▪️ Sciences des données et intelligence artificielle
▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique
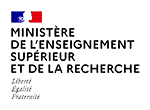
« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »

Formation
La formation des ingénieurs INSA aux enjeux socio-écologiques au cœur d’une chaire UNESCO
Engagé depuis 2019 dans un vaste chantier visant à former tous ses élèves-ingénieurs aux enjeux socio-écologiques, l’INSA Lyon se voit reconnu par la création d’une chaire Unesco. Ce label souligne la pertinence et la qualité du travail entrepris par les membres engagés dans le déploiement des nouveaux enseignements. Intitulée « former les ingénieurs aux enjeux de la transition socio-écologique », cette chaire qui réunit une quinzaine de partenaires nationaux et internationaux, a pour vocation d’amplifier les collaborations, partager les bonnes pratiques et approfondir les réflexions.
 Une chaire dédiée aux actions entreprises pour former les ingénieurs aux enjeux socio-écologiques
Une chaire dédiée aux actions entreprises pour former les ingénieurs aux enjeux socio-écologiques
Le cursus de formation d’ingénieur à l’INSA Lyon effectue progressivement sa mue, avec, à la rentrée dernière, la mise en place de ses premières applications. Pour que tous les élèves-ingénieurs développent une compréhension profonde et systémique des enjeux de durabilité et deviennent acteurs de la transition socio-écologique, plus de deux cents enseignants sont mobilisés pour poursuivre le déploiement de nouveaux enseignements. Le chantier, hors norme, s’étalera sur cinq ans. « L’idée de construire une chaire Unesco s’est imposée à nous assez naturellement », témoignent les deux initiatrices du projet, Laurence Dupont, enseignante en chimie, et Fatma Saïd Touhami, responsable de l’équipe d’appui pédagogique ATENA. « En effet, l’objectif d’une chaire Unesco est de promouvoir un ensemble intégré d’activités de formation et de recherche, d’information et de documentation autour d’une thématique choisie. Il s’agit aussi de contribuer à bâtir des passerelles entre le monde universitaire, la société civile, le monde socio-économique et l’élaboration des politiques. Avec un principe fondateur : l’échange de connaissances et d’expérience, et la collaboration. »
À travers ce label, reconnu dans le monde entier, l’INSA Lyon entend participer à la coopération mondiale pour l’Éducation, les Sciences et la Culture grâce à la force du réseau d’établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche réuni par l’Organisation mondiale. « L’Unesco est une référence mondiale dont les travaux en matière d’éducation sont particulièrement inspirants. Nous avons pensé qu’une chaire Unesco serait un atout considérable pour développer un réseau de partenaires autour de l’enjeu clé de la formation des enseignants. Car pour former des étudiants aux enjeux socio-écologiques, il faut d’abord amener les enseignants à se former », précise Nicolas Freud, chef de projet évolution de la format ion depuis 2020 et responsable de la chaire.
ion depuis 2020 et responsable de la chaire.
« Il s’agissait également de nous associer à des partenaires reconnus pour leur expertise en sciences de l’éducation. Nous nous sommes notamment rapprochés du laboratoire ADEF1, de l’Université d’Aix-Marseille, avec lequel nous avons lancé en 2020 la thèse de Hugo Paris sur l’intégration des enjeux socio-écologiques dans la formation des ingénieurs, avec un focus sur les changements que cela implique pour les enseignants », explique Fatma Saïd Touhami.
Un réseau international pour partager ses expériences et s’inspirer des différences
Si l’INSA Lyon pouvait déjà compter sur ses liens avec de très nombreux partenaires académiques internationaux, il n’existait pas jusqu’ici de collaboration spécifiquement dédiée à la formation aux enjeux socio-écologiques. C’est ce que permet désormais la chaire Unesco : un partage des réflexions et des expériences concrètes, avec l’immense plus-value d’une approche interculturelle. « Le plus grand intérêt d’une collaboration internationale, particulièrement avec des pays du Sud, est de pouvoir sortir d’une vision purement occidentale. Nos contextes locaux étant très différents, nous n’avons pas les mêmes préoccupations que nos partenaires tchadiens, tunisiens ou mauritaniens à propos des enjeux du climat, des ressources et de la biodiversité. Nos échanges n’en sont que plus intéressants et enrichissants », explique Valérie Lebey, chargée de projets Afrique à la Direction des Relations Européennes et Internationales. « Nous travaillons actuellement sur un projet intégrant une approche COIL (Collaborative Online International Learning) avec nos partenaires colombiens. Il s’agit d’une collaboration inter-universitaire à la fois entre enseignants, engagés dans une démarche de co-construction des activités pédagogiques, et entre étudiants, invités à suivre simultanément les activités d’apprentissage en ligne. L’objectif est de faire vivre une forme de mobilité virtuelle aux étudiants, en les amenant à s’enrichir mutuellement des approches et des expériences de chacun, sans les impacts associés aux déplacements internationaux », poursuit Laurence Dupont.
Apporter des réponses aux attentes croissantes du monde socio-économique
 Conduits selon quatre axes de travail, les travaux de la chaire Unesco n’a pas seulement pour ambition de transformer la formation des ingénieurs. Les porteurs de la chaire voient plus loin. « Les entreprises avec lesquelles l’INSA est en relation – via la Fondation INSA Lyon, par exemple – soutiennent les évolutions de la formation engagées par l’établissement. Elles commencent aussi à exprimer des besoins d’accompagnements et de formation de leurs personnels en activité, de leurs cadres dirigeants et de leurs ingénieurs ; les entreprises sont fortement intéressés par les nouveaux enseignements développés à l’INSA. Nous explorons cette question et échangeons notamment avec nos partenaires de l’Université de Sherbrooke, qui ont déjà une expérience en la matière », ajoute Nicolas Freud.
Conduits selon quatre axes de travail, les travaux de la chaire Unesco n’a pas seulement pour ambition de transformer la formation des ingénieurs. Les porteurs de la chaire voient plus loin. « Les entreprises avec lesquelles l’INSA est en relation – via la Fondation INSA Lyon, par exemple – soutiennent les évolutions de la formation engagées par l’établissement. Elles commencent aussi à exprimer des besoins d’accompagnements et de formation de leurs personnels en activité, de leurs cadres dirigeants et de leurs ingénieurs ; les entreprises sont fortement intéressés par les nouveaux enseignements développés à l’INSA. Nous explorons cette question et échangeons notamment avec nos partenaires de l’Université de Sherbrooke, qui ont déjà une expérience en la matière », ajoute Nicolas Freud.
Une chaire au service de la communauté INSA
L’un des enjeux de la chaire est de valoriser les travaux de l’INSA et de susciter de nouvelles collaborations dans le périmètre thématique de la formation des ingénieurs aux enjeux socio-écologiques. La chaire est ouverte à tout enseignant désireux de contribuer à l’un de ses axes.
Pour en savoir plus : https://chaires.insa-lyon.fr/chaire-unesco
 Le programme de chaire Unesco
Le programme de chaire UnescoLancé en 1992, le programme UNITWIN/Chaires Unesco vise à renforcer la coopération au niveau international entre les acteurs académiques. Avec plus de 850 établissements de 117 pays dans le monde, il favorise le partage de connaissances et les coopérations sur les questions prioritaires en lien avec les domaines de compétence de l’Unesco, à savoir l’éducation, les sciences exactes et naturelles, les sciences sociales, la culture et la communication.
Grâce à ce réseau, les établissements d’enseignement supérieur et les instituts de recherche du monde entier mettent en commun leurs ressources, tant humaines que matérielles, pour relever les défis pressants et contribuer au développement de leur société. Ces travaux ont prouvé leur utilité s’agissant d’orienter les décisions politiques, de mettre en place de nouvelles initiatives pédagogiques, de générer de l’innovation par la recherche et de contribuer à l’enrichissement des programmes universitaires existants tout en promouvant la diversité culturelle.
[1] Laboratoire "Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation"

Formation
8e édition du colloque pédagogie & formation
Conçu par OpenINSA et accueilli par l'INSA Rennes en 2023, ce colloque constitue un lieu d’échanges entre les enseignants, les enseignants-chercheurs, et tous les acteurs ayant trait à la formation de nos ingénieurs, architectes et paysagistes.
Continuellement au sein de chacun des établissements du Groupe INSA, des expérimentations pédagogiques sont conduites, les formations sont adaptées pour répondre aux évolutions tant des profils des étudiants recrutés que des besoins de nos diplômés.
De nouveaux dispositifs d’accompagnement des élèves et d’évaluation des formations sont mis en place. Cette rencontre permet ainsi de partager, valoriser et mutualiser ces expériences, afin d’enrichir et de faire évoluer nos pratiques et nos formations.
Additional informations
- https://colloqinsa2023.sciencesconf.org/
-
INSA Rennes
Keywords (tags)

Formation
Pourquoi enseigner les enjeux du vivant dans une école d’ingénieur ?
« C’est une crise dans la crise, un déni dans le déni ». L’érosion de la biodiversité est souvent mise au second plan lorsque l’urgence climatique est abordée. Pourtant intimement liée à la santé et à la nutrition de l’Homme, la santé des écosystèmes est indispensable à la vie de l’Homme sur la planète.
Cette thématique, les enseignants engagés dans l’évolution de la formation d’ingénieur INSA l’ont prise à bras-le-corps. Mais comment faire de la place au vivant dans une école régie principalement par les sciences dures ? Pourquoi former les futurs ingénieurs à ces enjeux ? Est-il possible de faire comprendre les bases de cette biochimie et du réseau d’interactions que constitue la multitude des espèces de nos écosystèmes dont notre développement dépend ? Hubert Charles, enseignant-chercheur et animateur du groupe de travail dédié, apporte des éléments de réponse.
 Il y a un exercice que l'enseignant-chercheur aime proposer à ses élèves ingénieurs pour travailler sur la relation entre l’Homme et la nature. « Je les invite à s’imaginer dans une situation tout à fait caricaturale de la vie urbaine, comme une soirée foot et pizza devant la télévision. Je leur demande de dresser une liste de tous les écosystèmes nécessaires pour les besoins de la soirée. Beaucoup de matériaux sont issus de la nature : le cuir du canapé, le bois de la table basse, les pommes de terre et l’huile qui ont servi à faire les frites, les levures pour faire la bière, les forêts qui absorberont le carbone de la retransmission du match, etc. ! Si l’exercice prête à sourire, il n’en est pas moins efficace pour faire prendre conscience de la dépendance de l’être humain au reste du vivant. Match de foot ou pas, nous sommes tous des éléments des écosystèmes redevables des services de la nature pour vivre et exercer nos activités favorites », introduit Hubert Charles.
Il y a un exercice que l'enseignant-chercheur aime proposer à ses élèves ingénieurs pour travailler sur la relation entre l’Homme et la nature. « Je les invite à s’imaginer dans une situation tout à fait caricaturale de la vie urbaine, comme une soirée foot et pizza devant la télévision. Je leur demande de dresser une liste de tous les écosystèmes nécessaires pour les besoins de la soirée. Beaucoup de matériaux sont issus de la nature : le cuir du canapé, le bois de la table basse, les pommes de terre et l’huile qui ont servi à faire les frites, les levures pour faire la bière, les forêts qui absorberont le carbone de la retransmission du match, etc. ! Si l’exercice prête à sourire, il n’en est pas moins efficace pour faire prendre conscience de la dépendance de l’être humain au reste du vivant. Match de foot ou pas, nous sommes tous des éléments des écosystèmes redevables des services de la nature pour vivre et exercer nos activités favorites », introduit Hubert Charles.
L’Homme est une espèce ingénieure. Comme le castor qui fabrique des barrages sur la rivière pour conserver de l’eau et protéger son gîte contre les prédateurs, l’être humain modifie son environnement pour son développement depuis le Néolithique. Maintenant, ses capacités de perturbations dépassent largement celles des autres espèces de la planète. « Ainsi, pour les plus urbains d’entre nous, nous avons complètement rompu les liens Homme – nature et perdu la conscience de nos dépendances aux écosystèmes. Dans nos environnements de vie artificiels et contrôlés, ce dualisme nature-culture est exacerbé. Pourtant, 40 % de l’économie de cette vie artificielle repose sur les écosystèmes ».
Au sein du chantier de l’évolution de la formation des ingénieurs INSA, le groupe de travail dédié aux « enjeux du vivant » a fait de ce lien entre nature et culture, une notion fondamentale à inculquer aux étudiants. « C’est un sujet qui implique de nombreux impacts sociaux et philosophiques et une montée en compétences en biologie des élèves et du corps enseignant. Dans les années 50, on s’est construit une vision écopaternaliste, considérant que toute nature qui ne serait pas dressée et contenue par l’homme n’aurait pas de valeur. C’est une vision issue de l’après-guerre, arrivée avec la mécanisation et les pesticides dans l’agriculture. On a cru qu’on pourrait dompter la nature avec des champs de monoculture et avec la technologie. Aujourd’hui, on se rend compte que cette agriculture industrielle rend nos champs improductifs et infertiles. Les questions que l’on veut adresser à nos étudiants sont : quelle est la valeur de cette nature dite « sauvage » ? Pourquoi et comment la soigner ? », poursuit l’animateur et scientifique.
Trop souvent polarisée sur les enjeux climatiques, la crise de l’érosion de la biodiversité menace la vie de l’Homme sur la planète et selon l’IPBES1, il existe 5 causes principales à cette crise : la destruction des habitats, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution et les espèces envahissantes. « Le changement d’usage des sols en est l'une des causes majeures. L’urbanisation, l’industrialisation et l’agriculture intensive ont dégradé la terre nourricière, garante d’un air pur et d’un sol fertile. Par ailleurs, des maladies de société liées à la dégradation de l’écosystème terre sont apparues telles que les cancers, les maladies cardio-vasculaires, les maladies respiratoires liées aux pollutions, et les épidémies… Elles sont les signaux faibles de l’urgence écologique, car il est illusoire de vouloir soigner l’Homme sans soigner l’écosystème : sans écosystèmes en bonne santé, pas d’êtres humains en bonne santé. C’est le principe de santé globale », poursuit l’enseignant.
C’est à cette interface entre biologie et sciences humaines que s’inscrit la réflexion de l’évolution de la formation des ingénieurs INSA sur les enjeux du vivant autour de quatre thèmes : la biodiversité, la santé, l’alimentation et la relation Homme-nature. Les futurs ingénieurs doivent comprendre que tout animal, n’existe pas en tant que tel. « L’homme notamment est un écosystème à part entière. Il ne survit que grâce aux relations qu’il entretient avec les microorganismes qui le colonisent et avec les autres espèces de l’écosystème dans lequel il vit ».
Initier les élèves ingénieurs aux enjeux du vivant est donc une étape clé dans la compréhension globale de l’urgence écologique. En reconnectant l’ingénieur INSA à la réalité de la nature, on lui permet d’avoir le recul nécessaire pour repenser la technologie et d’en réduire son impact sur le vivant. « Si nous voulons former des ingénieurs humanistes, il est de notre devoir d’enseignants de transmettre les bonnes valeurs du développement humain. Et quand je parle de développement, je parle d’amélioration de la qualité de vie et non pas forcément de l’extension de la colonisation de la planète. Il ne faut pas oublier que l’Humanité n’a que 500 000 ans. Parmi toutes les espèces de la planète, l’espèce humaine est très jeune et elle est la seule autant responsable que menacée. Tenter de faire perdurer l’espèce humaine durablement me paraît donc légitime. Pour cela, nous avons besoin de notre capacité à œuvrer collectivement, mais aussi de réaliser une transition technologique pour accéder à la durabilité à l’échelle du vivant. »
Ainsi, le travail collégial réalisé par le groupe de travail a permis de définir les éléments d’un programme pédagogique sur 5 ans ; objectifs dont les enseignants devront s’emparer pour les appliquer dans les départements de spécialité de la formation. « Nous avons initié ce travail au FIMI2 en première année au sein de l’équipe ETRE (Enjeux de la TRansition Écologique) avec un cours de 3h sur le concept de santé globale. En deuxième année à partir de l’année prochaine, nous sortirons de la salle de cours, sur le campus, observer les réseaux de pollinisateurs, la formation du sol, les espèces invasives, les aménagements du territoire et de l’espace naturel pour observer les écosystèmes et mesurer les impacts de l’homme. »
S’il reste encore beaucoup à faire comme le prévient Hubert Charles, ce petit pas est prometteur pour amener à la transition technologique nécessaire pour permettre une durabilité de notre développement à l’échelle du vivant et non à l’échelle temporelle de notre économie. « Faire évoluer la formation de l’ingénieur vers une réelle prise en compte du vivant est indispensable : la crise de la biodiversité ne résulte pas seulement de choix humains et de pratiques techniques, mais aussi de valeurs sur lesquelles s’est fondée notre modernité. C’est là toute la complexité du sujet. »
Une journée banalisée dédiée à l’évolution de la formation de l’ingénieur INSA permettra aux enseignants, enseignants-chercheurs et étudiants de réfléchir, échanger et se former à la transition socio-écologique et aux enjeux du numérique.
Cette journée proposera à la communauté INSA de découvrir et approfondir les sujets pour se mettre en action à travers des cours-conférences, des ateliers, des fresques, des forums d'échange.
🔒 Programme et inscriptions pour les personnels et les étudiants : Journée évolution de la formation - 14 mars 2023
Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves ingénieurs, de la 1re à la 5e année et est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :
▪️ Anthropocène et climat
▪️ Énergie
▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact
▪️ Enjeux du vivant
▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?
▪️ Calcul numérique
▪️ Sciences des données et intelligence artificielle
▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique

« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »
[1] : IPBES - Rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques - Résumé à l’intention des décideurs
[2] Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur

