
Art & Culture
Exposition Vie affective et sexuelle : on (s') (t') en parle
Une exposition qui reprend les grands thèmes de l’éducation à la vie affective et sexuelle (amitiés, genre, orientation sexuelle, pratiques, consentement …)
Une exposition qui reprend les grands thèmes de l’éducation à la vie affective et sexuelle (amitiés, genre, orientation sexuelle, pratiques, consentement …), conçue et prêtée par la mission égalité-diversité, la Chaire LGBTQI+ et le SSU de l'Université Claude Bernard.
Venez découvrir les illustrations de Marion Dubois qui rythment les diverses thématiques et informations proposées.
Additional informations
- clemence.abry-durand@insa-lyon.fr
-
Galerie des Humanités - RDC du bâtiment Humanités
Keywords (tags)

Formation
Premier cycle INSA Martinique-Caraïbe et INS’Avenir : les premiers bilans
Une réelle transformation de nos sociétés ne se fera point sans mixité ni diversité. Un an après la publication du tome 2 du Livre blanc « Diversités & ouverture sociale » par les équipes de l’Institut Gaston Berger du Groupe INSA, la rentrée 2023 a vu naître deux nouveaux dispositifs de formation pour favoriser la mixité sociale et territoriale : le Premier cycle INSA Martinique Caraïbe à Fort-de-France, et la filière INS’Avenir proposée à l’INSA Lyon. Le premier ambitionne de favoriser la réussite des étudiants ultra-marins ; le second de mener à l’intégration des bacheliers technologiques et de bacheliers généraux n’ayant suivi qu’une seule spécialité scientifique en terminale au cursus d’ingénieur.
« Se laisser le temps pour mûrir ses projets d’orientation, et se laisser aussi le temps de mûrir soi-même ». C’est un peu le point commun qu’ont manifesté les étudiants de la première promotion du dispositif Premier cycle INSA Martinique Caraïbe lorsqu’ils ont été interrogés sur le choix de première année d’études supérieures. Recrutés via la plateforme Parcoursup, les candidats suivent pendant deux années une formation généraliste équivalente à celle proposée dans les INSA en métropole, pour poursuivre ensuite leur cursus ingénieur au sein d’une des écoles du Groupe INSA. « Nous avons beaucoup de jeunes qui ne seraient jamais allés dans l’Hexagone pour poursuivre leurs études supérieures. Ils auraient choisi un BTS ou l’Université pour différentes raisons, parfois financières ou par peur du déracinement qui peut s’avérer trop brutal à 17 ou 18 ans. L’objectif est qu’ils puissent accéder à la 3e année avec plus de maturité, l’habitude de ne plus vivre chez leurs parents, dans une culture où les liens familiaux sont très forts, à 8000 kilomètres du cocon familial », explique Damien Jacques, enseignant au département FIMI1 de l’INSA Lyon et porteur du projet.

La première promotion du Premier cycle INSA Martinique Caraïbe compte 23 étudiants.
Grâce à des échanges pérennisés et réguliers de longue date avec des collègues de l’île aux fleurs, l’INSA s’est naturellement intégré au paysage enseignant martiniquais. C’est aussi le fort besoin de formation d’ingénieur et de formation scientifique qui a déterminé l’implantation de ce tout nouveau cursus. « Ce cycle vise à faciliter le retour des ingénieurs diplômés sur le territoire, notamment grâce à des spécialités ciblées qui répondent aux problématiques économiques locales. Lors des études de faisabilité, les entreprises nous remontaient des difficultés de recrutement sur des secteurs spécifiques. Le besoin en techniciens et techniciens supérieurs se fait aussi ressentir », ajoute l’enseignant. Aujourd’hui, la première promotion, composée de 23 étudiants montre une belle émulation. « Le groupe est composé d’élèves martiniquais, guyanais et métropolitains. Et il y a une quasi-parité filles-garçons ! C’est un groupe très hétérogène, ce qui constitue une richesse pour l’évolution de chacune et chacun. »
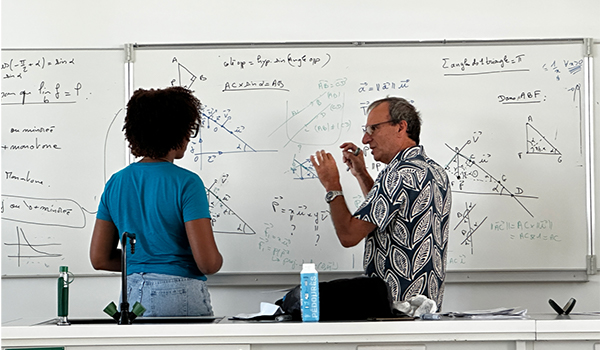
La diversité du groupe d’apprenants, c’est aussi le fer de lance du dispositif INS’Avenir, lancé à la rentrée dernière au sein de l’INSA Lyon. Accueillant des élèves issus de baccalauréats technologiques2 et de baccalauréat général ayant suivi une seule spécialité scientifique en terminale3, cette filière se déroule sur deux années préliminaires, avant de rejoindre la 2e année du département FIMI. « Grâce à un dispositif individualisé, cette filière laisse le temps aux élèves de s’adapter aux exigences de l’enseignement supérieur et, nous l’espérons d’améliorer le taux de réussite pour les bacheliers technologiques », indique Pedro Da Silva, Professeur des Universités au département FIMI et co-responsable de la filière. « L’ouverture aux bacheliers généraux ayant suivi une seule majeure scientifique permet d’élargir notre vivier et d’avoir des parcours que l’on n’aurait jamais eus autrement, par le cursus classique ».
Dans la première promotion, composée de 27 étudiants, la mixité et la diversité des parcours est donc un pari réussi. Dans cette classe, bacheliers spécialistes de disciplines littéraires, de sciences économiques et sociales ou encore d'histoire-géographie et géopolitique, cohabitent avec des bacheliers de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. « Il y a un vrai recul de certains étudiants sur les problématiques de transitions énergétiques et de problématiques de durabilité. Cela donne des regards et des façons de penser différentes et finalement assez complémentaires. L’interdisciplinarité les fait avancer », ajoute Sébastien Livi, Professeur des Universités et aussi co-responsable de la filière INS’Avenir. « Il ne faut pas oublier que dans notre système scolaire, nous demandons aux élèves de se spécialiser très tôt, dès le lycée. Pour l’accès aux écoles du Groupe INSA, il est requis de suivre deux spécialités scientifiques en terminale ; nous avons souhaité donner une chance aux bacheliers généraux qui n’ont qu'une spécialité scientifique. La filière INS’Avenir offre ainsi une souplesse dans les choix d'orientation des lycéens, qui se dessinent dès la fin de la seconde », conclut l’enseignant.
[1] La Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur correspond aux deux premières années du cursus ingénieur à l’INSA Lyon
[2] Baccalauréats STI2D et STL
[3] Mathématiques ou SI / NSI / PC + l’option Maths complémentaires

Formation
De Mayotte à l’INSA Lyon : oser les études supérieures
Il y a deux et trois ans, Aboubacar Assani et Elwafa Hamidi arrivaient en Métropole pour suivre des études d’ingénieur à l’INSA Lyon. Aujourd’hui en deuxième année de FIMI1, ils mesurent le chemin parcouru depuis qu’ils ont quitté l’île de Mayotte. Ils se revoient jeunes bacheliers, laissant derrière eux leurs repères. S’ils étaient bien décidés à suivre des études supérieures, ils ne pouvaient à cette époque ignorer les craintes suscitées par le départ du nid familial mahorais, les températures hivernales, les nouvelles habitudes alimentaires ou les nouvelles méthodologies de travail. Après avoir fait le grand saut vers le supérieur, ils ont souhaité faire profiter de leur expérience pour susciter les ambitions scolaires de leur cadets mahorais. C’est ainsi que, dans le cadre d’une intervention chapeautée par l’Institut Gaston Berger et les cordées de la réussite, les deux élèves-ingénieurs se sont rendus à Mayotte en février dernier. À la lumière de leur expérience personnelle et accompagnés par François Rousset, enseignant-chercheur, ils ont ouvert le dialogue avec des jeunes lycéens du 101e département français. Ils racontent.
« L’accès à l’information sur les études supérieures à Mayotte n’est pas toujours facilité »
Face aux assemblées de jeunes oreilles attentives, Elwafa Hamidi s’est revu, lycéen. Très bon élève, il se souvient que très peu d’établissements de l’enseignement supérieur métropolitain ne franchissaient l’Océan Indien. « Je ne connaissais les études supérieures qu’à travers le parcours de ma sœur, aujourd’hui infirmière. Plus jeune, j’ai longtemps nourri le souhait de rejoindre le milieu médical car c’était le seul exemple que je connaissais. Lorsqu’une enseignante de l’INSA est venue présenter les études d’ingénieur, le déclic s’est fait. Même si je n’avais pas tout à fait compris tous les contours du métier qu’elle avait dépeint, j’ai su que c’était ce que je voulais devenir : ingénieur. Je crois que ces rencontres de terrain sont très importantes pour informer les jeunes des territoires d’outre-mer et leur permettre d’avoir une chance d’accéder aux études de haut-niveau. »

Atelier de la fresque du climat, conférence d’initiation à la science appliquée et intervention
dans les cours de travaux pratiques ont permis de montrer comment les notions apprises
au lycée pouvaient être étudiées dans l’enseignement supérieur.
« On ne vit pas au même rythme en Métropole et sur une île »
L’île de Mayotte, département français depuis 2011, compte plus de 100 000 jeunes lycéens et collégiens2. Parmi eux, nombreux sont les élèves qui, malgré des capacités scolaires soulignées par les professeurs du secondaire, cachent sous le tapis la possibilité des études supérieures. « À la sortie du lycée, je n’étais pas sûr d’avoir le niveau pour faire des études poussées, même si mes profs me disaient le contraire. Ajouté à cela que la France vit sur un autre rythme, j’ai mis longtemps avant de faire le choix de poursuivre mes études à Lyon où je ne connaissais personne. Et puis avant d’arriver à l’INSA, j’avais peur de l’inconnu, pour des raisons qui peuvent peut-être paraître ridicules : la vie sociale différente, un pays plus grand, l’éloignement de ma famille, le passage du lycée au supérieur… Mais une fois que l’on saute le pas, on découvre ses propres capacités à s’adapter. C’est pour cette raison qu’il m’a paru important d’aller discuter avec des lycéens de mon île : pour les inciter à dépasser leurs craintes et leur dire que c’est possible », explique Aboubacar Assani, en deuxième année de FIMI.


Invités par des médias locaux, Elwafa et Aboubacar ont diffusé
leur message d’incitation jusqu’aux familles des lycéens mahorais.
« Bien sûr, les premiers amphis, c’était compliqué »
Pendant leurs rencontres sur l’île, les deux étudiants ont insisté. Si l’adaptation à la vie métropolitaine s’est faite naturellement pour eux, pour réussir ses études d’ingénieur, il faut être persévérant. « Je me souviens de mon premier cours en amphi : le prof parlait en faisant défiler sa présentation. J’attendais patiemment que l’enseignant nous donne du temps pour noter le cours. Et puis j’ai jeté un œil sur la feuille de mon voisin : il en était déjà à sa deuxième copie double ! Je n’avais pas l’habitude de la prise de note ; j’ai dû apprendre à apprendre, avec de nouvelles méthodes. Ça a été plus ou moins long pour moi, mais j’avais la chance de pouvoir compter sur mon colocataire et mes amis. Je ne me suis jamais retrouvé seul », poursuit Elwafa.
« Je voulais transmettre un message d’encouragement aux Mahorais »
Lors de leur mission, Aboubacar et Elwafa se sont montrés rassurants. « Beaucoup de lycéens s’interrogeaient sur l’aspect pratique de faire des études en Métropole : comment prendre l’avion, le train ou récupérer les clés de sa résidence sur le campus. Je crois que nous avons réussi à en rassurer certains avec ces petits détails. L’INSA proposant l’hébergement et la restauration sur le campus, c’est sécurisant lorsque l’on arrive dans un nouveau pays », indique Aboubacar. Et Elwafa d’ajouter. « Mayotte est un territoire en plein développement, en manque d'infrastructures, d'ingénieurs, de médecins... Encourager les jeunes à s'orienter vers des formations exigeantes est primordiale pour l'avenir de mon île. Je voulais transmettre un message d'espoir et d'encouragement aux étudiants mahorais. Je crois que nous avons réussi à passer le message que la peur de l'échec ne doit en aucun cas être un frein pour candidater dans des filières exigeantes. J'ai moi-même redoublé ma première année en arrivant à Lyon, et je l’ai vécu comme une seconde chance et qui m'a encouragé à redoubler d'efforts. »

Aboubacar devant une assemblée d’élèves, au lycée des Lumières à Mamoudzou.
« Il est difficile de se projeter dans un métier quand on n’a pas d’exemple autour de soi »
Faire germer la volonté de poursuivre des études ambitieuses dans l’esprit des élèves était donc le but principal de ces échanges comme l’explique François Rousset, enseignant-chercheur et ancien directeur de la filière Formation Active en Sciences, aujourd’hui INS’AVENIR3. « La question de la confiance en soi et de la légitimité est souvent la clé de voûte pour franchir le pas des études supérieures et éviter l’autocensure. La problématique est sociologique : il est difficile de se projeter dans un métier que l’on n’a pas en exemple dans son entourage proche. Il était important que les étudiants investis sur cette mission soient mahorais. La prochaine fois, j’espère que cette mission pourra aller plus loin et compter sur le partage d’expérience d’une étudiante pour faire naître l’ambition chez les lycéennes mahoraises. »
Pour en savoir plus :
[2] Présentation de l'Académie de Mayotte
[3] Nouvellement ouverte à la rentrée 2023, la filière INS'AVENIR accueillera des élèves issus des baccalauréats technologiques STI2D et STL et des élèves issus du baccalauréat général ayant suivi une seule spécialité scientifique en Terminale : Mathématiques ou SI / NSI / PC + l'option Maths complémentaires.

Formation
« Plus que l’égalité des chances, nous voulons faire de l’équité des chances »
En octobre 2021, les équipes de l’Institut Gaston Berger du Groupe INSA publiaient le premier tome du Livre blanc « Diversités & ouverture sociale » qui qualifiait avec précision l’état des lieux de l’inclusion des diversités au sein de ses écoles. Les conclusions de ce travail étaient alors sans appel : malgré les nombreuses actions menées sur le terrain pour aider les jeunes issus de milieux modestes à se projeter dans une formation d’ingénieur, les écoles INSA, à l’image de la plupart des grandes écoles françaises, contribuent malgré elles à renforcer les mécanismes d’assignation du système éducatif.
Un an après, la publication du tome 2 du Livre blanc renoue avec les ambitions du fondateur de l'INSA, Gaston Berger, livrant des préconisations à instaurer au sein de ses écoles pour recruter et mener au diplôme d’ingénieur davantage de jeunes d’origine sociale et territoriale diversifiée.
Carole Plossu et Sonia Béchet, respectivement directrices de l’Institut Gaston Berger du Groupe INSA et de Lyon font le bilan sur l’aboutissement de deux années de consultations collectives, de partages d’expériences et d’analyses consacrées à l’égalité des chances.
 Le premier tome du livre blanc faisait l’état des lieux de la diversité et de l’inclusion au sein du Groupe INSA. Il est notamment fait mention d’un « constat d’illusion ». Qu’entend-on par-là ?
Le premier tome du livre blanc faisait l’état des lieux de la diversité et de l’inclusion au sein du Groupe INSA. Il est notamment fait mention d’un « constat d’illusion ». Qu’entend-on par-là ?
Sonia Béchet : La question à laquelle nous avons tenté de répondre avec ce travail est la suivante : quels chemins sont accessibles à un élève1 sans proximité sociale ou culturelle avec l’enseignement supérieur pour que son potentiel se révèle, sans déterminisme social ? À l’INSA Lyon, nous conduisons déjà plusieurs programmes d’incitation permettant à des jeunes issus d’environnements moins favorisés de se projeter vers l’enseignement supérieur. Mais force est de constater que beaucoup se voient refuser une admission dans les établissements sélectifs. Le « constat d’illusion » est là. On a l’illusion de croire que l’école donne sa chance à tous, qu’il suffit de dire aux jeunes « vous pouvez y aller » pour qu’ils le fassent. En réalité, le système scolaire français participe à la reproduction des élites. Selon leur origine sociale et territoriale, les élèves ne sont pas tous égaux devant leur chance d’accéder aux grandes écoles. En tant qu’école publique de l’enseignement supérieur, nous souhaitons contribuer à compenser ces inégalités. Plus que de l’égalité des chances nous voulons faire de l’équité des chances.
 Le tome 2 propose de passer à l’action, listant une série de préconisations, applicables aux écoles du Groupe INSA. Pourriez-vous en détailler quelques-unes ?
Le tome 2 propose de passer à l’action, listant une série de préconisations, applicables aux écoles du Groupe INSA. Pourriez-vous en détailler quelques-unes ?
Carole Plossu : Ce tome 2 du Livre blanc n’a pas la prétention d’apporter LA solution mais se veut plutôt être un laboratoire d’idées. Il compile les résultats de consultations collectives menées dans les écoles INSA, une analyse de la littérature académique et une veille sur les actions mises en œuvre par d’autres établissements sur le sujet. Concrètement, ces préconisations peuvent se déployer à chaque étape du parcours d’un élève. D’abord avec des actions spécifiques auprès des collégiens et lycéens d’origine modeste afin de leur ouvrir le champ des possibles, d’inspirer leur ouverture scientifique, culturelle et sociétale et de renforcer leurs compétences et leur confiance en eux. L’objectif est de lever les freins et les mécanismes d’autocensure à la candidature, mais cela n’est pas suffisant. Une évolution des processus de recrutement du Groupe INSA est indispensable pour aller plus loin et tendre vers une plus grande équité dans l’accès aux formations sélectives : par exemple, en révisant nos critères de recrutement, en élargissant les viviers de recrutement et en développant des filières de formation favorables à l’ouverture sociale. Enfin, un accompagnement renforcé est nécessaire pour une meilleure réussite académique et pour renforcer l’inclusivité de nos écoles. Un traitement différencié plus équitable doit être assumé à chaque étape du parcours de l’élève, jusqu’à son insertion professionnelle.
À l’INSA Lyon, depuis presque quinze ans, l’Institut Gaston Berger vit au rythme des programmes d’incitation et d’accompagnement. Comment les préconisations proposées dans le tome 2 du Livre blanc pourront-elles prendre vie sur l’établissement lyonnais ?
Sonia Béchet : Ce travail nous a permis d’étayer nos constats statistiques et nous souhaitons approfondir le diagnostic dès le début de l’année prochaine, notamment en cherchant d’autres indicateurs de mesure de l’ouverture sociale. J’aimerais également nourrir le débat auprès de la communauté interne et mobiliser les forces vives sur la question. Nous avons désormais les choses en main ; à nous d’en faire quelque chose. Il est vrai que l’INSA Lyon fait figure de proue sur les actions menées pour faciliter l’ouverture sociale, mais ces travaux nous laissent entrevoir de nouvelles actions à mettre en place. Par exemple, un travail de détection des lycéens ayant le potentiel de réussir des études d’ingénieurs ou des actions en direction des familles pour lever les freins à la candidature peuvent être envisagées. Aussi, je souhaiterais pouvoir continuer à impliquer les personnes avec qui l’on travaille depuis très longtemps dans nos réflexions. Nous sommes associés à 14 lycées et 15 collèges de zones prioritaires ; ce sont eux qui connaissent le mieux le climat dans leurs écoles ; il faut continuer à travailler étroitement avec eux et à prendre soin de ces collaborations.
À la suite de la publication de ces deux tomes du Livre blanc, début 2023 verra l’élaboration de plans d’actions dans les INSA. Vous souhaiteriez également voir les résultats de ce chantier essaimer plus largement dans l’ESR2, n’est-ce pas ?
Carole Plossu : En effet, nous pensons que l’ESR peut agir en faveur d’un accès plus ouvert aux jeunes issus de milieux modestes grâce à des mesures d’équité et afin d’initier un cercle vertueux. Nos préconisations s’appuient sur une conviction partagée par une majorité des contributeurs à ce Livre blanc, à savoir que la seule application du principe de méritocratie, si profondément ancré dans notre société et notre système éducatif, n’est pas en capacité de garantir l’égalité des chances pour chaque jeune, quelle que soit son origine sociale, culturelle ou territoriale. Nous invitons donc à un changement de paradigme remettant en cause l’application du seul principe méritocratique que l’on a érigé en mythe fondateur de « l’égalité républicaine ». Nous avons récemment présenté au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ce nouveau dispositif d’ouverture sociale que le Groupe INSA propose d’expérimenter. Ce projet en rupture pourrait constituer un véritable démonstrateur pour l’ensemble de la communauté de l’ESR. Nous pensons que l’INSA a toute légitimité pour innover sur le sujet de l’ouverture sociale et nous espérons enclencher une dynamique collective en entraînant dans notre sillage d’autres grandes écoles et en influant sur les politiques publiques.
[1] L’emploi du masculin est utilisé à titre épicène.
[2] Enseignement supérieur et recherche

Recherche
« L’inclusion des minorités doit être une priorité pour l’IA »
Industrie, médecine, applications de rencontres ou même justice : l’intelligence artificielle (IA) inonde divers aspects de notre vie quotidienne. Seulement, certaines erreurs plus ou moins graves, sont régulièrement relevées dans le fonctionnement de celles-ci. En cause ? Des biais de représentativités présents dans les jeux de données.
Virginie Mathivet, ingénieure INSA du département informatique (2003) et docteure du laboratoire Liris1, est engagée sur la question. Pour l’auteure et conférencière, un maître-mot pour que l’IA ne soit pas un outil de duplication des discriminations déjà vécues dans la vie réelle par certaines minorités : la diversité. Récemment nommée experte IA de l’année 2022, Virginie a partagé son savoir à la communauté dans le cadre de « la semaine des arts et des sciences queer » organisée par l’association étudiante Exit+. Elle alerte sur l’extrême nécessité de porter une attention particulière à l'inclusion dans l’intelligence artificielle. Interview.
On connaît l’importance de la diversité pour faire une société plus égalitaire ; pourquoi est-elle aussi importante dans les jeux de données utilisées par les IA ?
Les intelligences artificielles sont des machines apprenantes : grâce à des bases de données, que l’on appelle des « datasets », des modèles sont fabriqués par des développeurs dans un but précis, par exemple pour détecter des défauts sur les chaînes de fabrication industrielles et pour lesquelles ils donnent de très bons résultats. Cependant, ces dernières années on a vu exploser les applications entraînant des prises de décisions sur les humains : l’accès à un crédit, le recrutement, des décisions de justice… On a aussi vu que ces IA étaient capables d’erreurs systématiques. On se souvient du logiciel de recrutement discriminant d’Amazon dont l’objectif était de faire économiser du temps aux ressources humaines en étudiant les candidatures les mieux notées par la machine. Il s’est avéré que l’algorithme sous-notait les profils féminins fréquemment car les jeux de données utilisés pour modéliser le logiciel s’appuyaient sur les CV reçus les dix dernières années, dont la plupart étaient des candidatures masculines. C’est ce que l’on appelle « un biais » : la machine ne fait jamais d’erreur aléatoire ; elle répète les biais -conscients ou inconscients- que les expérimentateurs ont commis en choisissant les données. Sans diversité, qu’elle soit de genre, culturelle, de génération, l’IA restera une extension des inégalités vécues dans la vie réelle.
Avez-vous d’autres illustrations de ce risque que représente le manque de diversité dans les jeux de données ?
Un exemple assez parlant est celui du système de reconnaissance faciale utilisée par les iPhones. La première version de FaceID n’était pas capable de reconnaître les propriétaires asiatiques car le dataset initial ne comptait pas assez de visages de ce type et l’algorithme n’avait tout simplement pas appris à les reconnaître ! Mais il existe des exemples aux conséquences beaucoup plus graves comme les systèmes de détection automatique des cancers de la peau : l’intelligence artificielle est tout à fait capable de reconnaître des mélanomes sur les peaux blanches, beaucoup moins sur les peaux foncées. Cela occasionne des problèmes d’accès aux soins considérables, en omettant une partie de la population. Pour aller plus loin encore dans l’illustration, de nombreuses applications ne considèrent pas les minorités sexuelles : aujourd’hui, on considère que l’on est soit un homme, soit une femme. Qu’en est-il pour les personnes transgenres, intersexes ou même non-binaires ? C’est le vide intersidéral, notamment lorsqu’il s’agit de traitements médicaux grâce aux IA.
Comment ces biais sont-ils remarqués ou relevés ? Ne peuvent-ils pas être détectés plus en amont ?
Aujourd’hui, les erreurs systématiques sont relevées car certaines personnes en sont victimes et dénoncent les manquements. Souvent, on a la très forte impression d’attendre des conséquences potentiellement graves pour analyser le dataset et tester le modèle. C’est ce qu’il s’est passé avec une voiture autonome d’Uber à Tempe (Arizona) qui a tué un piéton. La raison de l’accident s’est révélée après l’enquête : le dataset n’avait pas permis à l’IA d’apprendre à reconnaître les piétons hors des passages cloutés. La victime, qui marchait à côté de son vélo, a été percutée par la voiture qui arrivait trop vite malgré l’identification tardive de la personne comme un piéton. Il faut croire que les questions financières et les retours sur investissements sont plus importants pour ces entreprises que les dégâts que ces IA peuvent causer, par manquement ou négligence.
Existe-t-il une façon pour les expérimentateurs de se prémunir contre ces biais ?
Il existe une seule solution : diversifier les jeux de données au maximum. Est-ce que toutes les populations sont bien représentées par rapport à la réalité ? C’est la question qu’il faudrait se poser à chaque apprentissage, mais il faut penser à toutes les situations donc c’est extrêmement difficile. Si l’équipe chargée d’implémenter l’IA est composée de personnes venant de tous horizons, on peut arriver à limiter les biais. Chacun arrivant avec sa vision des choses, son quotidien et les situations quotidiennement vécues : celui ou celle dont la mère se déplace avec un déambulateur pensera à telle situation ; ou dont le mari est en fauteuil roulant à d’autres ; ceux avec des enfants penseront autrement, etc. Ça n’est pas tant que les modèles conçus contiennent des biais volontaires, mais il y a forcément des minorités auxquelles on pense moins car nous n’en avons pas de représentations dans nos vies quotidiennes. Autre piste, pour éviter que la technologie ne divise encore plus et ne cause plus de dégâts, un brouillon de loi européenne est actuellement en cours de validation. L’Artificial Intelligence Act doit être voté en 2022 pour une application en 2023.
Quelles seront les grandes lignes de ce règlement ?
Cette loi décompose l’utilisation de l’intelligence artificielle selon trois catégories : les « applications interdites » ; les « applications à haut-risque » ; et les « applications à faible risque ». Pour les « applications à haut risque », comme celles utilisées pour l’autorisation de crédit bancaire ou la justice, elles seront soumises à un certificat de conformité CE avant la vente et l’utilisation du modèle. Ces types d’IA seront certainement les plus surveillées car ce sont les plus propices à reproduire des biais discriminants. Cette législation permettra un premier pas vers l’inclusion, je l’espère, en Europe.
La conférence « Jeux de données - biais et impacts sur les femmes dans un monde numérisé » a eu lieu le mercredi 4 mai,
dans le cadre de la semaine des arts et des sciences Queer organisée par l’association étudiante exit+.
[1] Laboratoire Informatique en Images et Systèmes d’Informations
Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 6 - 19 mai 2022

INSA Lyon
Fidèle à son ambition originelle, l'INSA Lyon entend régénérer son modèle social
L'INSA Lyon a été fondé sur une promesse : celle de lutter contre la reproduction sociale qui existait déjà en 1957. En proposant un modèle en rupture avec les écoles de l’époque, l’INSA Lyon ouvrait le diplôme d’ingénieur, jusqu’alors réservé aux enfants de milieux favorisés, aux étudiantes et étudiants d’origine modeste. Depuis, en plus de 60 ans, le portrait social des candidates et candidats a évolué. Et si, aujourd’hui, les INSA sont les premières écoles d’ingénieurs demandées sur Parcoursup, l’un des revers de cette attractivité est qu’elle laisse de côté tout un pan d’élèves issus de familles de catégories socioprofessionnelles moins favorisées ou encore d’élèves habitant dans des territoires ruraux. Les INSA considèrent donc de leur devoir, en tant qu’écoles publiques fondées sur une philosophie d’éducation humaniste des ingénieurs, d’agir pour lutter contre le fatalisme de la reproduction sociale.
Un engagement humaniste, social et citoyen
Le diagnostic porté par l'Institut Gaston Berger montre une dégradation de l'ouverture sociale dans les INSA. Par exemple, 74 % des insaliens ont au moins un des deux parents de profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) très favorisée alors que seulement 2 % des élèves-ingénieurs ont les deux parents de PCS très défavorisées. Aussi, et malgré les dispositifs d’aides nationales et locales des INSA, 10 % des étudiants sont obligés de travailler pendant leurs études pour subvenir aux premiers besoins.
Face à ce constat et dans un esprit résolument prospectiviste, l'INSA Lyon et les autres INSA de France ont entamé depuis novembre 2020 un ambitieux projet de rénovation du modèle social avec une aspiration forte : agir pour faire découvrir les études et métiers d’ingénieurs à davantage de jeunes pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent et qui en ont le potentiel, d’intégrer un INSA et d’y réussir. Puisque l’humanisme de l’ingénieur implique une responsabilité sociétale, un engagement citoyen, il s’agit de contribuer à lever progressivement les freins économiques, psychologiques et culturels qui entravent actuellement la mobilité sociale d’un certain nombre d’entre eux : celles et ceux issus de milieux modestes et défavorisés.
Co-construire pour interroger les actions et les moyens
Pour répondre à cette ambition de transition sociale, l’INSA Lyon a lancé en février 2021 un travail de co-construction pour repenser les actions d’incitation menées dans les collèges et lycées, les modalités de recrutement, l’offre de formation, les aides à la vie étudiante et à l’insertion professionnelle, l’accompagnement à la scolarité et à la réussite ainsi que les conditions de vie pour toutes et tous au sein des campus. Autant d’éléments de l’environnement INSA qui sont actuellement examinés et débattus au sein des quatre commissions animées par l’Institut Gaston Berger, les vice-présidents élus des conseils de l’école et des élus étudiants. Ce travail, ouvert et démocratique, permet à tous les participants de prendre conscience de la complexité de la problématique, de mettre à l’épreuve des convictions bien établies, de confronter des idées, d’en mesurer parfois le décalage avec les nouveaux défis que notre école doit relever. Ces commissions sont attentives à toutes les opinions de la communauté insalienne qui produit un travail profond pour interroger l’existant et penser des actions transformantes et en rupture.
Parallèlement, afin que le modèle inclusif des INSA soit spécifiquement soutenu, des réflexions sont menées à l’échelle du Groupe INSA, avec des représentants des conseils d’administration des écoles, afin d’interpeller la puissance publique sur ces enjeux. De nouveaux programmes qui seraient portés par les fondations des INSA et des entreprises mécènes, ainsi que de nouveaux modes de mobilisation des alumni pour promouvoir une solidarité intergénérationnelle sont également à l’étude.
Interroger les droits d'inscriptions
Pour transformer les volontés en actes concrets, la question des moyens financiers est ainsi posée ; et c’est dans un esprit de solidarité et d’équité que l’INSA tente d’y répondre. Au centre des préoccupations : la question de droits d’inscription différenciés en fonction des revenus fiscaux de référence des parents ou responsables légaux, et plafonnés par l’État.
La proposition, encore à l’étude actuellement, amènerait les étudiants les plus favorisés à contribuer davantage, au bénéfice de tous, à un environnement qualitatif. Les étudiants provenant de familles aux revenus précaires ou modestes pourraient être intégralement exonérés des droits d’inscription ou bien rester les mêmes qu’actuellement, soit 601 €. Surtout, les étudiants issus des milieux les moins favorisés seraient bénéficiaires de nouveaux dispositifs de soutien et de mesures d’accompagnement à la scolarité, à la culture et à l’insertion professionnelle. Grâce à une commission spécifique, les fonds issus de la hausse des droits d’inscriptions seraient fléchés vers les dispositifs d’ouverture sociale. Cette hausse modulée des droits d’inscriptions, aurait vocation à ne concerner que les nouveaux arrivants.
Renouer avec l'esprit pionnier
L’enjeu principal de cette réforme n’est donc pas l’augmentation des droits d’inscription, mais bel et bien un retour aux valeurs, à la philosophie et à l’histoire de l’INSA Lyon. En impliquant une pluralité d’acteurs, la démarche s’interroge sur les termes et les idées reçues d’un modèle souvent difficile à cerner. « Excellence », « diversité », « ascension sociale » ou « méritocratie » ne résonnent plus aujourd’hui tels qu’ils résonnaient en 1957. La société a changé, les inégalités sociales, les inégalités de destin se creusent, et notre façon d’incarner ces valeurs doit être remises en perspective pour faire face aux défis du monde d’aujourd’hui.
À travers la refonte de leur modèle social, les instituts nationaux de sciences appliquées de France souhaitent ainsi retrouver leur raison d’être originelle : celle d'assurer l’inclusion et la réussite de toutes et tous.

INSA Lyon
Les brèves de la quinzaine
Recherche. Annie Malchere, Bérangère Lesaint et Thierry Douillard du laboratoire MATEIS (Matériaux, Ingénierie et Science, INSA Lyon/CNRS/Lyon1) ont reçu la médaille du cristal collectif du CNRS pour leur investissement quotidien au sein de la plateforme de microscopie, le CLyM.
Conférences. Dans le cadre de la Fête de la science du 2 au 12 octobre 2020, le département biosciences organise en partenariat avec la bibliothèque Marie Curie et le service culturel, un cycle d’exposition et conférences sur les thèmes suivants : « Les défis de l’agriculture de demain » et « Identification des criminels par leurs empreintes génétiques »
Diversité. Trois étudiants ayant bénéficié depuis le lycée du programme CAP’INSA ont fait part de leur expérience à la ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hai, à l’occasion de sa venue à Vaulx-en-Velin. Ils sont aujourd’hui tuteurs du dispositif mené par le centre Gaston Berger de l’INSA Lyon.
Bourses d'excellence. Victorien Aviles (2FIMI), jeune développeur chevronné d’applications numériques et Taha Boussaid (4GEN), très investi dans la vie associative insalienne ont été récompensés par une bourse d’excellence américaine. La Fondation américaine Ametek soutient les étudiants à haut potentiel avec une forte implication dans leur domaine d’études.

Formation
Le fabuleux destin de Mohamed
L’une des missions de l’INSA Lyon, à travers l’Institut Gaston Berger, est d’accompagner les élèves qui n’oseraient pas, au regard de leurs conditions sociales, territoriales ou financières, s’orienter vers des études d’ingénieur alors qu’ils en ont les capacités. Pour cela, plusieurs actions sont mises en place dans le cadre du programme CAP’INSA. Rencontre avec Mohamed Messalti, étudiant en troisième année du département informatique et ancien élève au lycée Marcel Sembat à Vénissieux.
Les cinq DROM (Martinique, Guyane, Guadeloupe, Réunion et Mayotte) et treize lycées de l’académie lyonnaise bénéficient de dispositifs pour informer les lycéennes et lycéens sur les formations d'ingénieurs et les accompagner en cas d'admission à l'INSA : tutorat, visite du campus, workshop en anglais, école d’été, bourses, ateliers sur les méthodes de travail, programme de mentorat... Mohamed a eu la chance d’en bénéficier.
Un bon élève qui ne sait pas quelle voie prendre
Arrivé en terminale scientifique avec d’excellents résultats, Mohamed doit choisir son orientation. Il hésite alors entre un parcours en médecine ou en école d’ingénieurs.
« Je ne connaissais pas le métier d’ingénieur, ni les formations qui existaient. En effet, dans mon entourage, je n’avais qu’un cousin éloigné ingénieur. Je commence à entendre parler de l’INSA Lyon grâce aux sessions de tutorat qui sont menées dans mon lycée. »
Le tutorat est organisé dans les lycées partenaires de la région. Pendant 2h, quatre insaliens et des étudiants de l’EM Lyon se mettent à disposition des lycéens pour les aider à réviser.
« J’ai pu leur poser des questions, découvrir les formations et le métier d’ingénieur. Et puis un jour, l’INSA Lyon a proposé aux élèves de mon lycée une journée d’immersion au sein du campus. J’ai pu participer à un cours, échanger avec des étudiants, dont un ancien élève de mon lycée, visiter un laboratoire de recherche et une résidence. Je me suis tout de suite projeté ici. En revenant chez moi le soir, j’avais une vision plus claire de ce qu’était le campus et le métier d’ingénieur. Quelque temps plus tard, le résultat des admissions est tombé, et j’ai su que j’étais accepté à l’INSA Lyon ! »
L’aventure insalienne peut commencer
Il bénéficie alors des actions mises en place par l’Institut Gaston Berger : école d'été, bourses, logement sur le campus, mentorat…
« Une fois le processus enclenché, tout est allé très vite et j’ai été très bien accompagné. L’école d’été, mise en place pour tous les étudiants bénéficiant du programme CAP’INSA, est le dispositif qui m’a le plus marqué. Deux semaines avant la rentrée, nous avions tous les matins des révisions de mathématiques et de physique. Nous devions être une cinquantaine et je me suis enrichi au contact de gens venant d’horizons variés. Nos cultures sont tellement différentes !
Également, les étudiants sont logés dans les résidences du campus les deux premières années. Grâce à ça, je n’avais pas à chercher de logement et j’ai tout de suite été dans des conditions propices au travail. Même maintenant que je suis en troisième année, je continue à vivre dans les résidences du campus ! »
Mohamed rejoint la filière Amerinsa en première année. Dans cette filière, 50% des étudiants proviennent d’Amérique Latine et l’autre moitié est française.
« J’ai toujours été passionné par la culture hispanique et d’Amérique du Sud. Et l’INSA m’a permis de partager mon quotidien avec des étudiants provenant de ces pays. J’ai adoré ces deux années ! J’ai même eu l’occasion de réaliser mon stage ouvrier de première année en Bolivie, dans la compagnie aérienne AMASZONAS. Avec trois autres amis de ma promotion, on a trouvé notre logement grâce à nos camarades boliviens. Nous trois, un guadeloupéen, un guyanais et un rhônalpin, nous nous retrouvions plongés en plein cœur de la culture bolivienne. Si la convention diversité n’avait pas existé, nous ne serions certainement pas à l’INSA et nos chemins ne se seraient jamais croisés ! »
Le suivi des élèves proposé par CAP’INSA s’effectue tout le long de la première année. Le mentorat est mis en place depuis des années et permet aux élèves de rencontrer des ingénieurs INSA.
« Cinq fois par an, des ingénieurs nous proposent des temps d’échange en petits groupes autour de tables rondes. Au début, je dois avouer que j’y allais à reculons en pensant qu’il s’agissait d’une perte de temps… Mais à chaque fois, je découvrais une nouvelle facette du métier de l’ingénieur. Ces échanges m’ont rassuré et j’en suis ressorti grandi. »
Les rôles s’inversent
Maintenant en 3e année, Mohamed s’investit à son tour. Tuteur dans son lycée 2h par semaine, il consacre une partie de son temps à l’aide aux devoirs des lycéens. Il leur montre que le métier d’ingénieur leur est accessible, même s’ils viennent d’un milieu défavorisé. Également, il a accompagné dix-huit lycéens pendant six jours à l’INSA Euro-Méditerranée. En effet, pour fêter les dix ans de CAP’INSA, l’Institut Gaston Berger a organisé ce voyage en avril dernier. L’objectif était de faire réviser les mathématiques, la physique et l’anglais, aux lycéens, tout en découvrant une nouvelle culture.
« Le matin, j’aidais l’enseignant à donner ses cours aux lycéens et l’après-midi nous avions des activités culturelles : visite de la médina, des sites archéologiques, de la vieille ville… Les lycéens ont ainsi pu découvrir une nouvelle culture et un campus, tout en renforçant leur niveau scolaire. Et de mon côté, j’ai pu visiter une partie du Maroc ! Quand je prends du recul sur mes trois dernières années, je me rends compte de la chance que j’ai eu. Si l’INSA n’était pas ‘venu me chercher’, je ne me serais peut-être jamais orienté dans cette voie et je n’aurais pas vécu tout ce que j’ai déjà pu vivre. Il me reste encore deux belles années avant d’obtenir mon titre d’ingénieur, et qui sait, je pourrais revenir à l’INSA en tant que mentor ! »

Formation
« Ma langue, c’est celle des signes » : parcours d’un élève-ingénieur sourd à l’INSA Lyon
La surdité est un trouble mal connu qui requiert quelques stratégies de communication. Kévin Mayeux rassure : « Ne paniquez pas quand vous rencontrez un sourd ! Si vous ne connaissez pas la langue des signes française (LSF), vous pouvez mimer, écrire, faire des gestes comme si vous parliez à un copain qui porte des écouteurs ! ».
Immersion dans le quotidien silencieux de cet élève-ingénieur en première année à l’INSA Lyon.
Si le système éducatif tend encore à réserver aux sourds des métiers manuels et des études courtes faute de moyens suffisants, l’INSA Lyon et son Institut Gaston Berger œuvrent quotidiennement à l’accompagnement et à la réussite de tous les étudiants en situation de handicap comme Kévin.
« Je suis arrivé à l’INSA en septembre après une année de classe préparatoire difficile. Il m’est difficile de suivre les cours lorsqu’il n’y a pas d’interprète LSF disponible, et certaines matières scientifiques se heurtent parfois aux limites de la langue des signes. L’interprète ne peut pas traduire systématiquement des expressions mathématiques ou des concepts très techniques1. J’avais peur de ne pas bien m’intégrer aux autres étudiants mais j’ai trouvé un réel accompagnement de la part de l’INSA en réponse aux contraintes imposées par mon handicap. »
C’est avec la Cellule Handicap Étudiants pilotée par l’Institut Gaston Berger, le service médical de l’INSA et l’élève-ingénieur lui-même que les moyens à mettre en place tout au long de la scolarité sont définis.
« L’objectif est d’éviter la dispense au maximum. Nous cherchons des moyens de compensation adaptés aux besoins de chaque étudiant. Ces adaptations sont possibles grâce à l’investissement des enseignants, de tous les personnels concernés et des camarades de classe », explique Eliane Roupie, coordinatrice de la Cellule Handicap Étudiants de l’INSA Lyon.
L’adaptation au cas par cas est donc privilégiée comme l’explique Marion Fregonese, professeure au département FIMI :
« En amont de chaque rentrée, les professeurs sont réunis par l’IGB autour d’intervenants spécialisés pour comprendre les perceptions de chacun de nos élèves porteurs d’un handicap. Cela nous permet d’adapter la pédagogie et les méthodologies de travail. Par exemple, nous fournissons à Kévin les supports de cours écrits à l’avance, nous interagissons par e-mail pour répondre à ses interrogations ou nous faisons intervenir un interprète LSF si la matière le permet. Chaque handicap nécessite d’ajuster les besoins selon l’environnement. »
Dès son arrivée à l’INSA Lyon, Kévin a par ailleurs été intégré dans une famille au sein de laquelle il a rapidement trouvé sa place.
« J’étais très content de rencontrer une fille qui connaissait la LSF et surtout surpris de voir autant d’étudiants s’intéresser à ma langue. Cela m’a permis de me sentir bien à l’INSA et de prendre confiance en moi ».
En effet, les étudiants ont naturellement souhaité s’informer et parfois même se former à la LSF pour permettre une meilleure intégration de leur camarade.
« Le handicap est l’affaire de tous. Étudiants, enseignants et services de l’INSA sont impliqués dans l’accueil de près de cent étudiants en situation de handicap sur le campus, et c’est pour cela qu’il est nécessaire de mener un véritable travail de sensibilisation », indique Eliane Roupie.
Environ 80% des handicaps sont invisibles, mais les besoins sont réels. Pour aider à ce travail de sensibilisation, l’association Handizgoud propose des ateliers ludiques et marquants, lors de la semaine du Handicap (du 15 au 23 novembre) : danse en fauteuil roulant, dîners dans le noir, handi-café, soirée handisports…
« Tous les handicaps ne sont pas nécessairement moteurs ou sensoriels », aime à rappeler Cloé Mendoza, présidente de l’association étudiante. « Nous voulons proposer des expériences significatives aux étudiants et personnels de la communauté INSA en leur permettant d’accéder aux différentes sensations associées à chaque handicap. »
« Si la dimension légale relative à l’accueil et à l’accompagnement des étudiants en situation de handicap revêt un caractère obligatoire, il est important de souligner l’investissement et la mobilisation de la communauté INSA, dont le modèle est fondé sur des valeurs sociales et humaines », précise Carole Plossu, Directrice de l’Institut Gaston Berger. L’établissement a souhaité, à travers un Schéma Directeur Handicap adopté par le CA en décembre 2017, faire de cette question une thématique transversale et l’objet d’un travail collaboratif entre une cinquantaine d’étudiants, professeurs et personnels INSA. « Beaucoup d’échanges, de mobilisation et d’investissements nous poussent à vouloir développer des actions renforcées en suppléments de celles déjà en place, notamment en termes de formation, pour continuer à faire évoluer le regard de chacun sur le handicap. »
1 A l’INSA Toulouse, un glossaire en Génie Civil en LSF a été créé.

Formation
Maxime Lohya : science avec conscience vers le salut de l’Humanité
Étudiant en 4e année de Génie Mécanique, Maxime s’est questionné sur le sens de ses études. Doté d’un esprit scientifique, il découvre à l’INSA la diversité et grâce à sa participation au TEDxINSA, la conscience d’un système… à refaire.
« Je suis né carré. Est-ce qu’il y a des cercles dans la salle ? » Voilà comment Maxime Loyha, élève-ingénieur de 21 ans, a introduit son propos lors de TedxINSA, le 22 mars dernier. Seul sur scène, il prend la parole pour la première fois devant un public, avec le challenge de faire passer un message, d’engager une réflexion. Et c’est sur l’éducation qu’il a souhaité éveiller les consciences, et plus particulièrement sur la conviction qu’il faut parvenir à changer la société par ce biais.
« Ce sujet m’est apparu comme une évidence quand j’ai décidé de participer à cette édition du TEDxINSA qui avait pour thématique cette année, « Break the rules », qu’on peut traduire par « enfreindre les
règles ». Je suis revenu sur mon parcours scolaire dès mon plus jeune âge, et sur le fait que les professeurs ne se rendaient pas compte du pouvoir qu’ils pouvaient avoir sur notre scolarité. On prône la réussite scolaire selon des normes établies, sans permettre à chaque enfant, chaque élève, d’exprimer sa différence. »
Et c’est avec sa propre expérience que Maxime va étayer son discours. Né « carré » donc, il dit avoir un équilibre entre sciences et littérature mais manquer d’habilité manuelle, avec une sensibilité à l’art proche de 0… Il manquera de redoubler son CP à cause de grosses difficultés en écriture et en lecture.
« Je n'aimais pas écrire, alors quand je m'ennuyais, je mettais ma feuille en format paysage et suivais les colonnes au lieu des lignes. Et la maîtresse me disait que je ne progresserai pas tant que je ne ferai pas comme tout le monde, en mettant ma feuille droite et en suivant les lignes. On me disait que je faisais mal quelque chose car je ne le faisais pas comme on me l'avait enseigné » explique le jeune homme, qui 3 ans plus tard, va se balader en CM1, grâce à la découverte des mathématiques avec lesquels il révèle une appétence. Il manquera d’ailleurs de sauter cette classe !
« Naître dans une société où les maths sont mises à l’honneur, quelle chance ! Et pas seulement en France mais dans tous les pays du monde ! Mais trouvez-moi un seul pays qui met l’art plastique au même niveau que les maths ? Qu’en est-il des cercles, des triangles et des octogones qui ont une intelligence plus créative, mis en échec scolaire par un système éducatif généraliste, surtout au collège, qui repose sur un cadre proche du carré ? »
Maxime s’interroge et sa pertinence est d’autant plus audible compte tenu de sa propre réussite scolaire. À l’aise avec les outils mis à disposition par l’Éducation nationale, il ne peut s’empêcher d’observer les choses d’un autre œil, sensible aux difficultés de ceux qui ne réussissent pas à rentrer dans ce cadre imposé.
« Qui peut me définir ce qu’est l’intelligence ?... Personnellement, j’ai beaucoup de mal ! C’est une sorte de savoir et de savoir-faire, une aisance d’esprit mais peut-elle se traduire par des faits manuels ? Je le pense. Mais pourquoi une partie de ce qu’est « l’intelligence » n’est pas reconnue dans la société ? Peut-on vraiment être fier d’avoir réussi quand on sait que l’on force les autres à devenir un « idéal » sans même leur mettre autre chose dans la main qu’un crayon ? Pourquoi un plombier aurait moins de mérite qu’un ingénieur ? Pourquoi un financier se sent plus à l’aise dans cette société qu’un maçon ? »
Pour le jeune homme, il faut changer l’éducation, à la base.
« Nous devons admettre le fait que l’intelligence est un arbre avec plusieurs branches, et donc que plusieurs chemins mènent au tronc. Nous pensons le monde avec tous nos sens : l’ouïe, la vue, mais également par le toucher, le goût et l’odorat. Certains sont plus enclins à se représenter une chose quand un de leurs sens est sollicité. »
Poussé par sa réflexion, Maxime avance sa certitude : le salut de l’Humanité existe dans l’expression de la diversité, qui permet à la créativité de chacun de s’exprimer.
« Sait-on vraiment de quoi allons-nous avoir besoin dans 20 ans ? Dans 30 ans ? De quoi la société aura-t-elle besoin si l’on continue à consumer notre planète comme une peau de chagrin ? Elle aura besoin d’un miracle. Et ce miracle ne se trouvera pas dans un manuel scolaire, n’en déplaise à mes professeurs, il se trouvera dans un cerveau créatif. Nous devons miser, pour l’avenir, sur la seule constante de l’humain : son intelligence brute, sa capacité à être créatif. C’est un don, que nous devons utiliser avec précaution. Car il me vient une citation de Jonas Salk, un biologiste américain, qui disait que si les insectes venaient à disparaître, en l’espace de 50 ans ce serait la fin de toutes espèces vivantes ; mais que si l’humain venait à disparaître, en l’espace de 50 ans toutes espèces vivantes prospéreraient. »
Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 2 - 29 avril 2021

