
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Sophie GUILLAUME
Hybridation de modèles pour une prise de décision fiable
Doctorante : Sophie GUILLAUME
Laboratoire : REVERSAAL - REduire Réutiliser Valoriser Les Ressources Des Eaux Résiduaires
École doctorale : ED 206 Chimie de Lyon
Dans le contexte du changement global, les villes s'orientent vers des pratiques plus durables et résilientes en matière d'eau. Les solutions fondées sur la nature contribuent aux approches de gestion intégrée de l'eau en gérant localement les volumes d'eau et en traitant la pollution, tout en préservant la biodiversité et en soutenant la dynamique socio-économique dans le paysage urbain à un coût raisonnable. Ces solutions fleurissent dans le monde entier sous de multiples terminologies et manquent de lignes directrices pour leur mise en œuvre. Ce défi est relevé par le projet MULTISOURCE, dans le cadre duquel cette thèse vise l'aspect technique du pré-dimensionnement des unités technologiques développées pour le traitement des eaux usées. En particulier, les filtres plantés sont confrontés à un manque de compréhension de la relation entre leur conception et les méchanismes de traitement impliqués, ainsi qu'à un manque de données comparables sur ces systèmes. Les modèles de conception actuels sont simples et conservateurs, tandis que les modèles basés sur des données ne sont pas fiables. Cette thèse propose, dans un premier temps, le développement d'une ontologie afin de clarifier les ambiguïtés terminologiques, d'unifier les connaissances sur les filtres plantés et de mieux identifier leurs principales caractéristiques en termes d'élimination des polluants. La deuxième étape de ce travail propose d'homogénéiser les contrôles de qualité des données grâce à une méthodologie de validation des données avec une évaluation quantitative de la qualité des observations. Dans un troisième temps, deux méthodologies d'hybridation des modèles mécanistes et des modèles basés sur les données sont développées pour fournir des estimations de conception basées à la fois sur les connaissances et les données. Enfin, cette méthodologie est appliquée à l'ensemble des données validées, et des méthodes d'optimisation de la conception sont mises au point pour tenir compte de l'incertitude inhérente à la prise de décision.
Additional informations
-
Salle Rhône, Bâtiment INRAE, 5 rue de la Doua, 69100 Villeurbanne

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Okba MOSTEFAOUI
Étude expérimentale du transport de microparticules plastiques modèles au sein d'une bifurcation à surface libre
Doctorant : Okba MOSTEFAOUI
Laboratoire INSA : LMFA - Laboratoire de Mécanique des Fluides et Acoustique
École doctorale : ED n°162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique
De nombreux produits plastiques en fin d'usage échappent aux filières de traitement et de valorisation et se retrouvent, volontairement ou non, dans les compartiments de la biosphère, notamment les environnements aquatiques (rivières, lacs, océans). Les zones urbaines constituent la principale source de génération des microplastiques, issus, principalement, de la fragmentation des emballages plastiques, de l'abrasion des pneus sur les routes ou du relargage de fibres synthétiques dans les machines à laver. Cette thèse se concentre sur le transport des microplastiques au sein des déversoirs d'orage, interface entre le réseau d'assainissement urbain et l'environnement et principal vecteur urbain de pollution en microplastiques. L'objectif principal est d'identifier les zones d'accumulation et les modes de dispersion des microplastiques dans un écoulement de bifurcation à surface libre modélisant un déversoir d'orage. L'enjeu est donc de comprendre « comment les microplastiques, selon leurs caractéristiques physico-chimiques, sont distribués dans la branche latérale d'une bifurcation ? » Pour répondre à cette problématique, des protocoles d'élaboration de microparticules modèles, reproduisant les caractéristiques de microplastiques présent dans les milieux environnementaux, ont été développées pour une utilisation au sein d'un dispositif expérimental. Le premier protocole a permis de concevoir des particules aux propriétés physiques contrôlées, intégrant un colorant fluorescent pour améliorer leur suivi par des méthodes optiques. Le second protocole a permis un vieillissement accéléré des microparticules par photo-oxydation UV, simulant la dégradation chimique des microplastiques prélevés dans un bassin de rétention urbain. Concernant l'écoulement de bifurcation, une méthode de mesure 3D a permis de caractériser les structures tridimensionnelles présentes dans la branche latérale. Les mesures ont révélé l'absence systématique de fermeture de la zone de séparation. Deux formes d'écoulements de recirculation hélicoïdale ont été identifiées : l'une portée par un axe vertical, associée à un temps de
résidence plus long dans la zone de recirculation, et l'autre portée par un axe horizontal, favorisant un meilleur mélange transverse. En aval, ces deux structures génèrent des écoulements secondaires qui accentuent le mélange entre l'écoulement lent et rapide à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de séparation. La dynamique des microparticules modèles a ensuite été étudiée expérimentalement par PTV-4D dans un écoulement de bifurcation, en faisant varier leurs caractéristiques physiques et leur position d'injection. Au-delà de l'effet de densité qui donne lieu à une accumulation près du lit ou en surface, il est observé que les microplastiques possédant un faible nombre de Stokes (caractérisant le temps de réponse des particules) se dispersent plus et sont susceptibles d'entrer dans la zone de recirculation. Par ailleurs, la position d'injection joue un rôle clé dans la formation initiale des zones d'accumulation, bien que cette hétérogénéité tende à s'atténuer en aval. Cette thèse a aussi conduit au développement d'un code numérique de transport de microparticules, adapté aux écoulements aqueux à petite échelle, sans ajustement de coefficients. Les résultats de la thèse améliorent la compréhension du comportement des microplastiques dans un écoulement turbulent et de bifurcation à surface libre modélisant un déversoir d'orage. Ils mettent en évidence l'influence des caractéristiques physico-chimiques des particules sur leur dispersion et leur taux d'accumulation, pilotés par les formes des structures d'écoulements. De plus, le développement de protocoles d'élaboration de microparticules modèles, représentatives de microplastiques, et d'un code numérique adapté, ouvre la voie à de nouvelles études et une meilleure prédiction de leur dynamique dans les environnements aquatiques urbains.
Additional informations
-
Amphithéâtre Émilie du Châtelet, Bibliothèque Marie Curie de l'INSA Lyon, 31 Av. Jean Capelle 0, 69100 Villeurbanne

INSA Lyon
Point de bascule // la sélection du mois de janvier 2025
Microplastiques : pourquoi sont-ils partout, même dans les bouches d'égout ?
Les bouches d’égout seraient-elles gardiennes défaillantes d’une pollution purement anthropique, qui a désormais franchi les barrières de nos corps humains ? Invisibles à l’œil nu mais omniprésents, les microplastiques s’infiltrent partout, jusque dans les entrailles de nos villes. Si l’on sait le plastique très présent dans les milieux marins, jusqu’à constituer des continents, on connaît moins son voyage insidieux depuis les bouches d’égout jusqu’aux écosystèmes aquatiques, sous la forme de microparticules. Pourquoi cette pollution est-elle plus présente en milieux urbains ? Quelles en sont les principales sources ? Quels sont les facteurs qui influencent leur transport dans les eaux pluviales ? Comment arrivent-ils jusqu’au milieu naturel ?
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/sous-les-grilles-d-égout-les-microplastiques
Ingénieurs-concepteurs : ce que la low-tech a à vous apporter
L’ingénierie n’est-elle qu’affaire de technique ? Romain Colon de Carvajal, fait partie de ces scientifiques pour qui l’ingénierie est bien sûr une affaire de technique, mais aussi d’éthique et de philosophie. Enseignant en génie mécanique à l’INSA Lyon, il est aussi spécialiste des low-techs. Selon lui, il est temps de préparer demain, et pour cela, il faut que les ingénieurs sortent du rang et partent à la reconquête de leur liberté.
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/ingénieurs-concepteurs-ce-que-la-low-tech-a-à-vous-apporter
Recyclage des silicones : une initiative pour donner une nouvelle vie aux manchons pour prothèses
Prisés pour leur stabilité chimique et leur haute résistance, les matériaux silicones sont omniprésents dans notre quotidien. Toutefois, une fois usagés, peu de chance pour que ceux-ci soient recyclés car l’incinération et l’enfouissement sont privilégiés. Pour François Ganachaud, chercheur au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP) (2), le véritable enjeu de leur recyclage réside autant dans le procédé que dans la chaîne logistique en amont de celui-ci.
Avec une société spécialisée dans les silicones pour manchons orthopédiques, COP Chimie, l’IMP tente de donner une autre vie aux silicones issus des déchets de fabrication, à travers une filière de recyclage des rebuts.
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/recyclage-des-silicones-une-initiative-pour-donner-une-nouvelle-vie-aux-manchons-pour-prothèses
Quand l’enseignement de la transition socio-écologique transforme la pratique enseignante
Dérouler un catalogue des derniers événements climatiques extrêmes sur la planète, aussi dramatiques soient-ils, ne suffit pas. Pour enseigner les enjeux environnementaux et sociétaux qui bouleversent nos sociétés et donner les meilleures clés aux ingénieurs de demain qui auront à les affronter dans le cadre de la transition écologique, les pratiques d’enseignement en la matière doivent nécessairement se remettre en cause.
Comment accompagner l’intégration des enjeux socio-écologiques dans la formation en école d’ingénieurs ? C’est justement la question qu’a explorée Hugo Paris dans le cadre de sa thèse de doctorat à l’INSA de Lyon. Interview.
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/quand-l-enseignement-de-la-transition-socio-%C3%A9cologique-transforme-la-pratique-enseignante

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Clément FAGOUR
Pollutions causées par les inondations urbaines : Modélisation expérimentale du transport de polluants issus de déversements locaux
Doctorant : Clément FAGOUR
Laboratoire : INRAE Riverly Fonctionnement des hydrosystèmes
École doctorale : ED 162 MEGA
Travaux de thèses dirigés par Monsieur Emmanuel MIGNOT et Monsieur Sébastien PROUST
Composition du jury proposé :
M. Sébastien PROUST INRAE Co-directeur de thèse
M. Philippe GOURBESVILLE Université Côte d'Azur Rapporteur
M. Emmanuel MIGNOT INSA Lyon Directeur de thèse
M. Koen BLANCKAERT Vienne University of Technology Rapporteur
Mme Lylia KATEB CEA Cadarache Examinatrice
M. Pietro SALIZZONI École Centrale de Lyon Examinateur
Mots-clés : advection,mélange,dispersion,diffusion turbulente,laboratoire,risque sanitaire
Résumé :
Les pollutions causées par les inondations urbaines s’inscrivent dans une problématique largement négligée par la sphère scientifique et celle des gestionnaires, contrairement à d’autres risques déjà bien étudiés (déstabilisation et entraînement des véhicules, du mobilier urbain, des bâtiments, des piétons). Notamment, l’effet des processus hydrodynamiques complexes dans un réseau de rues inondées sur le transport de polluant a été très peu étudié. Cette thèse s’attache donc à explorer le transport de polluants issus de déversements locaux, représentant principalement des matières chimiques ou biologiques présentes dans les eaux de ruissellement à la surface des rues et susceptibles de pénétrer dans les bâtiments, au plus près des habitants. Ce travail s’appuie sur des expériences de laboratoire conduites sur un modèle urbain représentant un réseau de rues très simplifié et à échelle réduite. Nous explorons un écoulement d’inondation en régime stationnaire, déjà étudié dans des travaux précédents. L’originalité de cette thèse réside donc dans l’étude du transport d’une pollution dans cet écoulement. Pour cela, nous mesurons les débits massiques et les champs de concentration au sein des rues, au sein d’un îlot urbain percé d’ouvertures, ainsi qu’en sortie du réseau de rues, à partir de techniques de mesure par conductimétrie et colorimétrie. Le premier objectif de la thèse est d’identifier les effets prédominants de l’hydrodynamique sur ce transport ainsi que l’influence du lieu de rejet sur la répartition de polluant dans les différentes rues. Le deuxième objectif de la thèse est d’identifier les paramètres qui gouvernent la dynamique d’une eau polluée introduite par des ouvertures dans un îlot urbain, en faisant varier le nombre d’ouvertures de cet îlot ainsi que la durée de rejet de pollution. Les principaux résultats de cette thèse sont alors (i) la distribution des débits massiques de polluant dans les différentes rues diffère de celle des débits d’eau, à la fois dans les rues et en sortie du réseau de rues. Cela s’explique par un mode de transport de polluant qui est spatialement hétérogène dans le réseau de rues. On constate que le mélange le plus intense a lieu dans les rues en aval des intersections. La diffusion turbulente et la dispersion par les courants secondaires y sont les deux modes de mélange dominant et contribuent toutes deux à l’homogénéisation de la concentration de polluant. Aux intersections, le transport des polluants est principalement causé par l’advection dans les directions longitudinale et transversale. Les panaches de polluant se fusionnent ou se séparent simplement, suivant les lignes de courant de l’écoulement moyenné en temps. En conséquence, (ii) la distribution des polluants dans le réseau de rues est très sensible à la position exacte du rejet par rapport à la position des lignes de division des bifurcations et carrefours de rues. (iii) Un modèle simplifié est proposé pour décrire et prédire la distribution de polluant aux intersections, et sa précision dépend de la capacité à localiser précisément les lignes de division. (iv) Dans le cas d’un îlot urbain (pâté de maison) poreux, le nombre d’ouvertures influence fortement les concentrations maximales atteintes au sein de l’îlot urbain, ainsi que les temps de remplissage et de résidence, ainsi que les variations spatio- temporelles des concentrations. (v) La durée de remplissage initial joue un rôle important sur le temps de vidange de l’eau polluée suite à l’arrêt de la source de pollution. En revanche, le taux de renouvellement de la pollution ou de l’eau claire est constant, indépendamment de la durée de remplissage, et est piloté exclusivement par l’hydrodynamique de l’îlot urbain poreux. (vi) Une adaptation du modèle de zone morte agrégée est enfin proposée pour valider la possibilité d’ajustement des concentrations moyennées spatialement dans l’îlot.
Additional informations
-
CS 20244, 69625, 5 Rue de la Doua, 69100 Villeurbanne - Salle : Rhône - centre INRAE Lyon
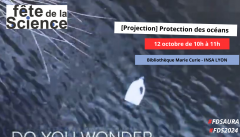
Sciences & Société
[Projection et débat] La protection des océans - Annulée
Intervention ANNULÉE // Projections de 2 films courts : "Plastic tracker " et "Les baleines changent le climat" qui sera suivi d'échanges avec des bénévoles de Seacleaners
Une animation proposée dans le cadre de la fête de la Science 2024.
Intervenants : bénévoles de Seacleaners
- « Plastics tracker » est une modélisation permettant de suivre un bidon en plastique qui passe de la rivière à l’océan, pour le suivre pendant 20 ans, et expliquer ainsi la constitution des Gyres (7ᵉ continent, ou continent de plastiques). Durée 30sec. Il s’ensuit un débat sur la dégradation des plastiques et son incidence sur le réchauffement climatique, les conséquences pour notre organisme ainsi que sur la faune en général.
- « Les baleines changent le climat » explique l’interaction entre baleines et plancton, ainsi que leur rôle dans notre écosystème et le réchauffement climatique. Durée 32 sec.
Additional informations
- scd.animation@insa-lyon.fr
- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/7059
-
INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie salle 202-203 au 2ᵉ étage
Keywords (tags)

Recherche
Modes de vie et transformations de l'environnement : faire face aux maladies de sociétés.
Deuxième séminaire organisé dans le cadre du projet let’s look up “Ingénierie et recherche par le prisme du concept One health” soutenu par la Maison des Sciences de l’Homme Lyon-Saint-Etienne (MSH-LSE) et l’Institut des systèmes complexes (IXXI).
Nous accueillerons Thierry Baron, Directeur de recherche à l'ANSES et chef de l’unité de l’Unité Maladies Neurodégénératives de Lyon. Il nous parlera notamment de la maladie de Parkinson, exemple emblématique qui permet d’illustrer les interactions complexes entre la susceptibilité de l’hôte et les facteurs environnementaux multiples qui peuvent favoriser ou au contraire limiter l’apparition de la maladie lors du vieillissement.
Puis Gwenola Le Naour, maîtresse de conférences en science politique à Sciences Po Lyon et co-auteure du livre « Vivre et lutter dans un monde toxique », présentera les impacts des pollutions sur la santé et les mobilisations qui en découlent, à partir d'études menées dans différentes régions du monde.
Nicolas Lechopier, maître de conférences, au laboratoire S2HEP et enseignant à la Faculté de Médecine Lyon Est jouera le rôle de “discutant” avec les conférenciers et le public.
Les conférences seront également accessibles en visioconférence.
Additional informations
- hubert.charles@insa-lyon.fr
- https://letslookup.sciencesconf.org
-
Amphi Est du bâtiment des Humanités (1er étage) - INSA Lyon - Villeurbanne
Keywords (tags)

Recherche
« À base d’algues, nos emballages jetables sont compostables et comestibles »
Le plastique n’est plus du tout fantastique : omniprésent, on le sait désormais nocif pour l’environnement, la santé humaine et les écosystèmes. Seulement, le plastique est pratique. Ou tout du moins, l’emballage jetable l’est pour bon nombre de situations de la vie courante. Pierre-Yves Paslier, diplômé du département matériaux, a fondé l’entreprise « Notpla ». Avec elle, il met en évidence un fait : dans la nature, l’emballage existe et ne dure jamais plus longtemps que son contenu, comme la peau d’un fruit. L’entreprise de l’ingénieur-produit a trouvé la recette pour fabriquer des emballages jetables et même comestibles à partir d’algues. L’innovation a récemment été récompensée par le Prince William, à travers le Earthshot Prize 2022, dans la catégorie « Construire un monde sans déchets ».
Avec « Notpla », vous introduisez une innovation de taille dans le monde du packaging : remplacer le plastique des emballages jetables par un matériau biosourcé, l’algue. Pourriez-vous résumer ?
Nos produits sont des emballages dits « jetables » dédiés à la consommation instantanée ou hors de chez soi comme les repas à emporter ou les snacks pendant les évènements sportifs. Nous avons souhaité nous concentrer sur l’industrie du déchet jetable car c’est souvent celui qui est le plus à même de se retrouver directement dans la nature. À la différence du packaging plastique ou carton généralement utilisés dans ces cas-là, nos solutions sont naturellement biodégradables puisqu’elles sont fabriquées à base d’algues. L’idée était de ne pas produire un déchet que la nature ne pourrait pas gérer. Concrètement, il suffit de mettre l’emballage au compost ou même, de le manger pour que celui-ci disparaisse !

Différents types d’emballages jetables à base d’algues proposé par Notpla. ©Notpla
Pour arriver à cette solution, vous avez exploré l’industrie des algues, à force d’essais et de recherche. À partir de quelles algues travaillez-vous ?
La plupart de celles utilisées dans nos produits sont des algues brunes et rouges. Selon les usages, nous avons appris à utiliser des espèces différentes, mais c’est un monde très vaste. En Europe, l’industrie des algues n’en est qu’à ses balbutiements contrairement à l’Asie du Sud-Est par exemple, où elle est très développée. En réalité, beaucoup de produits du quotidien élaborés à l’échelle industrielle en contiennent déjà : dans les glaces, des produits pharmaceutiques, en cuisine… Nous avons adapté certaines de leurs propriétés pour en faire du packaging et remplacer le plastique. Du géant de vente d’articles sportifs aux entreprises de livraison de repas à domicile, beaucoup d’entreprises sont intéressées.
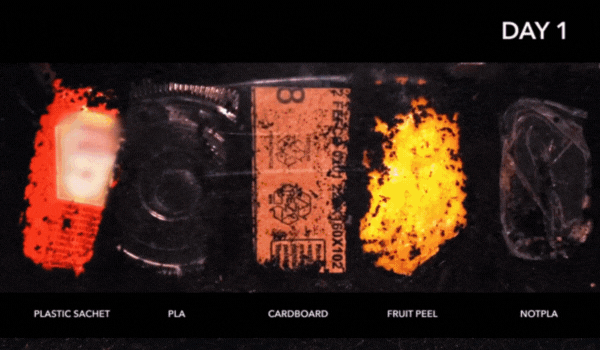
La décomposition du déchet à base d’algues est très rapide. © Notpla
On dit souvent que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Êtes-vous en accord avec ce principe ?
Bien sûr, la solution la plus simple pour réduire les effets néfastes du plastique est de réduire sa consommation d'emballages, et c’est d’ailleurs le premier réflexe à avoir. Seulement parfois, l’emballage est nécessaire, pour sa fonctionnalité. Le meilleur déchet plastique est celui que l’on ne produit pas car si ce matériau est très performant, il est à haut risque pour les océans, les écosystèmes et même notre santé. Le recyclage du plastique ne fonctionne pas en l’état actuel des choses : dans le monde, seulement 9 % des déchets plastiques sont réellement recyclés. La manière dont on emballe est très déconnectée de la réalité et c’est un fait que j’ai éprouvé les premières années de ma vie professionnelle : j’étais ingénieur-produit dans un grand groupe de produits cosmétiques et d’hygiène. En quelques secondes, de grandes quantités de plastiques sont produites, et mettront des milliers d’années avant de disparaître.
Pierre-Yves Paslier et son associé avaient fait le buzz sur les
réseaux sociaux grâce à leur technique à base d’algues
Zoomons d’ailleurs sur votre parcours professionnel. Comment êtes-vous passé de l’INSA à « Notpla » ?
En sortant de l’INSA Lyon, j’ai été embauché à la suite de mon stage de fin d’études dans un grand groupe. Ayant suivi l’option « design » pendant mes études d’ingénieur, je trouvais intéressant de travailler dans le domaine du packaging : les enjeux de matériaux et d’industrialisation liaient vraiment l’ingénierie et le design. Je travaillais sur les lancements de packaging plastique produits à des centaines de millions d’unités : des produits jetables qu’il était impossible de faire entrer dans des circuits vertueux comme le réemploi par exemple. La situation me pesait. J’ai décidé d’approfondir mes compétences en design avec un master en Innovation Design Engineering dispensé entre l’Imperial College London et the Royal College of Art. À cette occasion, j’ai rencontré mon cofondateur, Rodrigo Garcia Gonzalez avec qui nous nous sommes mis en tête d’explorer des matériaux naturels pour produire un emballage biodégradable. Dans notre cuisine, nous avions tourné une vidéo « tutoriel » qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à une technique inventé par Unilever à base d’algues. Cela nous a motivés à trouver une solution plus aboutie et à transformer ces expérimentations en un projet solide et scientifique. Les financements et les fonds d’investissements nous ont permis d’embaucher ingénieurs, designers et chimistes. Aujourd’hui, nous avons remplacé plus de trois millions de plastique à usage unique et nous sommes 70 salariés chez Notpla.
Vous avez suivi une option « design » lors de vos études d’ingénieur. Quels liens faites-vous entre les deux domaines d’expertise ?
Le rôle de l’ingénieur est de résoudre des problèmes et cette capacité peut se traduire de plein de manières différentes. Je crois qu’il est important de pouvoir dialoguer précisément avec les techniciens, mais aussi d’être capable d’expliquer le raisonnement logique derrière la technique. C’est peut-être ici que se rejoignent les deux métiers : le designer s’attarde sur l’usage et le besoin des utilisateurs, il n’est pas nécessairement face à un problème technique, mais prend en compte la problématique sociale à laquelle le produit doit répondre. Avoir les deux casquettes permet finalement d’être à la confluence de la réalité technique et la réalité de la société.
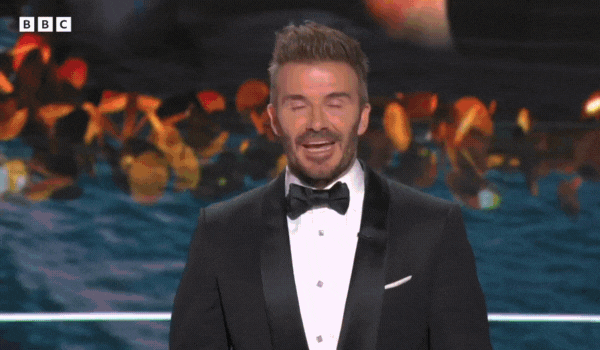

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Thomas LUBRECHT
Numerical and Experimental Analysis of the Tribological Performance of a Diamond-Like Carbon Coated Piston Ring Cylinder Liner Contact
Doctorant : Thomas LUBRECHT
Laboratoire INSA : LaMCos
Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon
Motivé par l’urgence climatique et les normes d’émissions de polluants, l’industrie automobile mondiale initie l’électrification de sa flotte de véhicules. Cependant, cette technologie est, en l’état, incapable de répondre aux challenges de la mondialisation. Pour cette raison, les moteurs à combustion interne seront toujours utilisés dans les années à venir. Ainsi, améliorer leur efficacité, fiabilité et réduire leurs émissions de polluants est aujourd’hui plus que nécessaire. Les revêtements de surface, tel que le Diamond-Like Carbon (DLC), peuvent par leurs excellentes propriétés tribologiques améliorer le rendement et la durée de vie d’un moteur. Leur application au contact primordial Segment-Piston-Chemise (SPC) a peu été étudiée, mais semble prometteur. Afin d’évaluer la pertinence d’une telle solution, une étude expérimentale et numérique du contact SPC revêtu DLC est menée. Un solveur semi-analytique, transitoire, linéique pour la résolution du contact lubrifié est développé. Contrairement aux habituelles théories stochastiques, cette méthode repose sur un calcul déterministe du contact entre rugosité à partir du relevé topographique de la surface. L’influence de la macro- géométrie des pièces sur le contact est pris en compte par l’implémentation de coefficients analytiques. Ainsi, le solveur permet l’estimation rapide des forces de frottement du contact tout en considérant les phénomènes de sous-alimentation et de transport d’huile. Le solveur est validé expérimentalement et numériquement. En parallèle, un moyen d’essai dit à « chemise-flottante » équipé de vraies pièces moteur est améliorer. La réalisation d’une étude vibratoire du banc d’essai à permit l‘obtention d’un meilleur ratio signal sur bruit mesuré. En outre, une méthode permettant de reproduire des conditions d’essai à hautes vitesses tout en fonctionnant à basses vitesses est présentée.
A partir des méthodes développées, d’excellentes performances tribologiques sont observées pour le contact SPC revêtu DLC. Une réduction significative du frottement ainsi qu’une excellente résistance à l’usure pour une variété de lubrifiant sont obtenues.
Additional informations
-
Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Recherche
« Airxôm offre une réponse immédiate aux personnes dont la vie dépend de la qualité de l’air qu’elles respirent »
L’invention, présentée début janvier au salon des innovations électroniques de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, a fait parler d’elle. Alors que la vague du variant Omicron déferle dans le monde entier, le masque « Airxôm » promet une protection « active » contre les risques viraux et infectieux et la pollution atmosphérique.
Trong Dai Nguyen, ingénieur INSA diplômé du département génie mécanique et docteur du laboratoire LMFA1 a rejoint la start-up lyonnaise en 2020. Cet expert en mécanique des fluides revient sur les enjeux techniques et les limites d’un tel produit.
 Le masque Airxôm a fait une arrivée tonitruante lors du salon CES Las Vegas. En quoi consiste l’appareil ?
Le masque Airxôm a fait une arrivée tonitruante lors du salon CES Las Vegas. En quoi consiste l’appareil ?
C’est un dispositif portable de purification d’air, le premier masque actif du monde, qui permet de protéger les individus contre les particules fines, les composés organiques volatiles, les virus et les bactéries. Concrètement, le masque possède plusieurs niveaux de protection. D’abord, il filtre l’air entrant et sortant puis il décontamine et détruit les particules grâce à la photocatalyse. Il est composé de deux filtres : le premier neutralise les virus et les bactéries et le second détruit les particules résiduelles polluantes en émettant des rayons UVA sur un catalyseur. C’est la raison pour laquelle il est utilisé avec une batterie. Notre produit repose sur l’utilisation de plusieurs brevets techniques et a été pensé avant l’arrivée de la Covid, pour protéger les personnes avec des maladies chroniques respiratoires, des porteurs de greffes ou des personnes fragiles pour qui la question de l’air est très sensible. Nous avons bien sûr par la suite effectué des tests sur le SARS-CoV-2, et Airxôm s’est avéré très efficace.
Avec deux diplômes d’ingénieur et de docteur en génie mécanique et en mécanique des fluides à l’INSA Lyon, vous êtes le responsable technique parfait pour ce projet. Quels ont été les enjeux scientifiques derrière la conception de ce masque ?
Cela fait plusieurs années que je travaille sur la filtration et le traitement de l’air, notamment dans le cadre d’un post-doc sur la qualité de l’air dans les habitacles de véhicule automobile. J’avais donc une vision globale de l’offre des filtres techniques en photocatalyse qui ont fleuri sur le marché ces dernières années. Pour la conception du masque, j’ai surtout été occupé aux mesures dont les protocoles très rigoureux nous ont permis de construire et de tester les différentes couches filtrantes pour trouver un bon compromis entre la meilleure respirabilité, le tissage efficace et la recyclabilité des matériaux.

La Covid a mis en lumière les effets de la pollution de l’air, intérieure et extérieure, et ses effets sur la santé. Le masque Airxôm est également un bon prétexte pour sensibiliser à la question, mais sommes-nous condamnés à porter des masques filtrants pour respirer un air pur ?
La pollution de l’air est un problème systémique auquel aucun objet technique n’apportera jamais une solution miracle. Je pense que l’innovation-produit n’a pas vocation à traiter les enjeux à la racine et j’ai conscience que notre masque ne représente qu’une solution de surface face à l’immense problématique de la pollution atmosphérique. Cependant, elle offre une réponse immédiate aux personnes dont la vie dépend de la qualité de l’air qu’elles respirent, pour vivre plus longtemps. C’était d’ailleurs la volonté première de Vincent Gaston, le président de la start-up qui travaille à ce projet depuis le décès de son fils atteint d’une mucoviscidose. Si Airxôm avait été conçu avant, Mathieu aurait pu bénéficier d’une « béquille » pour avancer dans le quotidien avec plus de sécurité. C’est pour cela que cette innovation a du sens pour moi, même si elle ne fera pas directement reculer les dangers de la pollution atmosphérique qui pèsent sur les individus. Il faut garder en mémoire que la technique ne peut pas se substituer aux transformations de fond nécessaires pour faire réduire les tensions qui pèsent sur la santé humaine et la biodiversité.
▪️ Pollution atmosphérique : mesurer les risques grâce à la modélisation cartographique
▪️ Alliance Atmo/INSA Lyon : pour une recherche qui a le vent en poupe
[1] Laboratoire Mécanique des Fluides et d’Acoustique (CNRS/Lyon 1/ECL/INSA Lyon)
Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 3 - 9 février 2022

Recherche
Activités sociales et environnements urbains : quels effets sur les pollutions urbaines et les enjeux de santé publique ?
Ce séminaire rassemblera des interventions en urbanisme, sociologie, sciences politiques, anthropologie et sciences de l’environnement.
L'UMR 5600 Environnement Ville Société organise lundi 1er mars après-midi et mardi 2 mars matin un séminaire sur les rapports entre activités sociales, environnements urbains et pollutions – que ces activités soient de production, de consommation ou d’usage.
De quelles manières les environnements urbains et les objets qui les composent (constructions, mobiliers urbains, équipements, objets personnels, etc.) orientent-ils les pratiques sociales, sources des pollution du sol, de l’air et de l’eau ? Quel est leur rôle dans les pollutions observées et l’observation de ces pollutions ? Comment les rapports entre activités sociales, environnements urbains et pollutions sont-ils intégrés dans les politiques environnementales et de santé publique ? Par qui ? Etc.
Compte tenu de la situation sanitaire, il aura lieu en distanciel.
Légende de la photographie : 1-8-13, nouvelles boîtes à ordures [dépôt des poubelles sur le trottoir dans les rues de Paris] : [photographie de presse] / [Agence Rol], 1913, via Gallica

