
Formation
Satellites de télécommunications et cybersécurité : un élève-ingénieur de l’INSA Lyon au CNES
Dans l’espace gravitent une multitude d’objets. Parmi eux, des satellites de télécommunications, placés en orbite autour de la terre, jouent le rôle de messagers, fournissant entre autres, services Internet, téléphonie, télévision et assistance à la sécurité civile et à la Défense. Parmi les menaces de cybersécurité guettant les satcoms, l’interception de données est reine. En 2020, un doctorant d’Oxford démontrait lors de la Black Hat Conf aux États-Unis qu’il était parvenu à intercepter les données de dix-huit satellites à l’aide d’un équipement bon marché. Cette expérience soulignait déjà la nécessité d’un renforcement urgent de mesures de cybersécurité, dans un secteur en pleine expansion.
Nicolas Lepotier, étudiant au département télécommunications, est en alternance au Centre National d’Études Spatiales. Co-auteur du livre « La cybersécurité de zéro » et passionné par le sujet, il brosse un portrait des enjeux liés à la cybersécurité et aux satellites de télécommunications.
C’est une affaire qui avait finalement causé peu de bruit dans les médias français, mais qui avait suscité autant l’admiration que le trouble chez les spécialistes des satcoms : en août 2020, James Pavur, jeune étudiant américain d’Oxford, avait démontré la vulnérabilité d’une quinzaine de satellites à haute orbite. À l’aide d’une antenne parabolique et d’un tuner satellite DVB-S achetés pour moins de 300 dollars en ligne, le jeune White hat1, montrait comment il était possible d’intercepter du trafic non-chiffré échangé par satellite, en temps réel. « En interceptant certains des flux de ces satellites qui transitaient des informations non-sécurisées vers un fournisseur d’accès à internet, il a réussi à récupérer des données envoyées à des internautes, mais aussi à des avions et des bateaux. Cela a rappelé l’importance de renforcer les mesures de sécurité, et la marge de progression dans le domaine de la sécurité des télécoms par satellite », explique Nicolas Lepotier, élève-ingénieur au département télécommunications de l’INSA Lyon et passionné de cybersécurité.
Les satellites de télécommunications : kesako ?
Placé dans l’espace pour répondre à des besoins de communication, un satellite de télécommunications relaie des signaux diffusés par des stations émettrices, vers des stations réceptrices. Apparue dans les années 1960, cette technologie a d’abord été développée pour transporter des communications téléphoniques et télévisuelles sur de grandes distances, pour ensuite être étendue à la télévision et à internet. « La plupart du temps, nous communiquons grâce à des réseaux présents sur Terre. Par exemple, notre téléphone transmet nos appels, sms et data par réseau cellulaire à des antennes, qui relaient le trafic au destinataire. Nos box internet sont aussi reliées grâce à la fibre optique ou l’ADSL, des réseaux terrestres très vastes. Cependant, toutes ces infrastructures ne sont pas toujours suffisantes pour assurer la communication. Certaines zones ne sont pas équipées, ou ces infrastructures peuvent être endommagées lors de catastrophes naturelles par exemple. Les télécommunications par satellite pallient ce vide ; et sont souvent utilisées par les services de sûreté comme les pompiers par exemple », introduit Nicolas Lepotier.

Illustration du satellite de télécommunications Telecom 1, premier satellite de télécommunications multi-mission associant missions civiles militaires. (©CNES/DUCROS David 2023)
Le « New Space » a rebattu les cartes du monde des satcoms
Parmi les constellations de satellites qui ont fait beaucoup parler d’elles ces dernières années : Starlink, le fournisseur d’accès par satellite de Space X, dont l’explosion du nombre d’appareils en orbite basse soulève encore de nombreuses questions en matière de pollution spatiale, de souveraineté nationale, de réglementation et de sécurité dans plusieurs pays du globe. Cette technologie semble apparaître, dans l’histoire de l’exploitation spatiale, comme une ultime illustration des limites du New Space, un terme désignant les nouvelles formes d’économie liées à l’espace. « Depuis le début des années 2000, le monde du spatial s’est libéralisé. Au lieu d’avoir une agence nationale qui concentre les savoir-faire et expertises, on a ouvert la possibilité aux entreprises de proposer leurs services », explique l’étudiant en alternance au Centre National des Études Spatiales (CNES). « En France par exemple, le CNES a désormais un rôle fédérateur des entreprises du spatial, et est chargé d’élaborer et proposer au gouvernement français un programme spatial national. En résumé, il s’agit d’un rôle de maîtrise d’ouvrage, de régulateur et de financeur pour développer l’industrie du spatial, plutôt qu’un cavalier seul assurant tout en interne. »
Ce nouvel espace économique a ainsi segmenté le monde du spatial et celui des satellites de télécommunications. Constructeurs, opérateurs, orbites… Ce monde, pas toujours lisible pour les entreprises et institutions utilisatrices, est au cœur du domaine de compétence de CESARS, le centre d'expertise et de support pour les usages en télécommunications par satellite, créé par le CNES. « Notre rôle est d'accompagner les entreprises, les chercheurs et les entités publiques qui souhaitent découvrir le domaine et tester leurs solutions sur nos infrastructures », ajoute l’étudiant de l’INSA Lyon en alternance dans ce même centre.
Les satcoms : des objets dont il faut garantir la sécurité
Également co-auteur du livre « La cybersécurité de zéro », Nicolas Lepotier participe à améliorer la sécurité des échanges pour pallier les écoutes pirates sur les communications par satellite. « Il y a des informations plus sensibles que d’autres qui transitent, mais dans certains cas, comme pour les communications militaires, cela peut avoir des conséquences très graves. Parmi les mesures de sécurité prometteuses, il y a le VPN, qui masque et chiffre les informations ». Car le principal enjeu de sécurité des satcoms réside dans l’interception de données. Si Nicolas ne travaille pas spécifiquement sur l’aspect offensif de la sécurité, il expose : « il est reconnu que certains pays perturbent parfois les satellites d’autres pays pour les étudier ou les brouiller, mais l’écoute est le plus gros enjeu en matière de cybersécurité des satcoms. »
Comme pour un réseau terrestre, des « paquets » d’information transitent entre la station émettrice, le satellite et la station réceptrice. Le VPN, pour « virtual private network » (ou réseau privé virtuel en français), sécurise les informations en les chiffrant. Sans clé de déchiffrement, celles-ci sont rendues impossibles à lire. « En revanche, du fait de ses propriétés physiques, un lien satellite n’a pas une bande passante très grande et ne permet pas autant de liberté qu’un lien terrestre. Ainsi, le VPN ajoute des bits supplémentaires, ce qui peut engendrer une saturation, et donc réduire la rapidité avec laquelle les informations sont relayées. Actuellement, nous cherchons l’équilibre entre la sécurité et la rapidité du lien, notamment en explorant des systèmes de PEP2 », décrit l’alternant en optimisation, sécurisation, accélération et hybridation.
L’autre mission de Nicolas au CESARS : la médiation technique
À l’arrière du camion baptisé « Victor », une table en forme de U, des écrans et des antennes. L’outil de médiation roulant est une vitrine pour le centre d'expertise et de support pour les usages en télécommunications par satellite du CNES. « C’est un outil de démonstration assez convaincant lorsqu’il s’agit de mimer des situations de gestion de crises via des télécommunications par satellites. Nous le présentons régulièrement aux pompiers et au SAMU, dont les besoins de terrain font souvent appel aux satcoms, spécifiquement en cas de crise ou de zone blanche. On m’a proposé de travailler à l’amélioration de cet outil de médiation ; je suis notamment chargé de trouver un routeur, permettant la répartition du trafic entre la 4G et le lien satellite, ajoutant de l’intelligence réseau ».

Le camion Victor permet de faire de la médiation auprès des jeunes publics ou des pompiers dont les besoins font régulièrement appel aux satcoms. / Crédits : CNES/OLLIER Alexandre, 2022
En 2021, le marché des télécommunications par satellite représentait 9026 millions d’euros et offre un potentiel de croissance très élevé, spécialement en raison du développement de l’Internet des Objets (IoT), et de la 5G NTN3.
À l’échelle Européenne et dans le cadre de la transition numérique, les États membres s’apprêtent à se doter de leur propre réseau internet par satellite, souverain et plus sécurisé. Le programme IRIS2 pour « Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite4 » sera le premier réseau de satellites multi-orbitaux souverain en Europe. Cette constellation, constituée d’environ 300 satellites, devrait voir le jour en 2030.
[1] Les White hat désignent les « hackers éthiques », qui décident de mettre leurs expertises en sécurité informatique pour trouver les vulnérabilités et améliorer la sécurité des systèmes d’information.
[2] Performance Enhancing Proxy.
[3] Les réseaux non terrestres (NTN) sont des systèmes de communication sans fil qui fonctionnent au-dessus de la surface de la Terre, impliquant des satellites en orbite.
[4] Infrastructure de Résilience et d'Interconnexion Sécurisée par Satellite.

Recherche
Un lubrifiant solide adapté à l’air comme au vide spatial
Il n’existait jusqu’alors aucun lubrifiant capable de protéger les mécanismes spatiaux en toutes circonstances. Après plus de dix ans de travaux collaboratifs avec plusieurs acteurs impliqués dans la tribologie en ambiance spatiale dont le CNES1, des chercheurs du LaMCoS2 de l’INSA Lyon ont vu leurs résultats de recherche prendre forme. Du décollage à la mise en orbite, en passant par l’air et le vide, leur prototype semble résister à toutes les conditions. Explications.
Dans l’espace, l’énergie est une denrée rare. Puisqu’il n’existe pas de moyen de faire le plein de son engin et que les panneaux solaires ont une capacité limitée, l’énergie utilisée pour chaque mouvement compte. Pour minimiser sa consommation, la lubrification de ces mécanismes est alors optimisée. Seulement, dans le vide spatial, les matériaux utilisés à cette fin n’ont pas le même comportement que sur Terre. Un lubrifiant insuffisamment maîtrisé sous air et sous vide peut même faire échouer toute une mission. « Dans les années 80, des satellites ont été lancés dans l’espace sans jamais n’avoir pu déployer leurs panneaux solaires car le lubrifiant n’avait pas supporté l’enchaînement des tests en salle blanche sur Terre, puis les vibrations du lancement et enfin les conditions de l’espace. Ces satellites se sont alors avérés inutilisables ! », explique Aurélien Saulot, professeur des universités au LaMCoS.
Le MoS2 est le lubrifiant de référence dans le domaine. Également appelé « bisulfure de molybdène », ce matériau (poudre ou dépôt mince) utilisé comme « troisième corps » solide, n’est en réalité pas le plus fiable qui soit. « Le MoS2 perd significativement ses propriétés lubrifiantes en présence d’humidité. Cette dernière est difficile à contrôler par exemple lors des phases d’assemblage et d'essais en salle blanche. Nous avons donc cherché à synthétiser un troisième corps plus stable quel que soit l’environnement (air humide, ultra-vide..) : une solution avec un coefficient de frottement maîtrisé et stable, pour minimiser la consommation d’énergie des mécanismes spatiaux et ainsi accroître leur durée de vie », ajoute le chercheur.
 Alors comment améliorer les propriétés de ce bisulfure pour qu’il résiste aux conditions extrêmes du vide spatial ? Les chercheurs, réunis sur le projet, ont parié sur le dopage du MoS2 par un additif métallique inédit au vu de ses propriétés tribologiques. « Tous les matériaux qui avaient été testés avaient de bons résultats soit sous air, soit sous vide. Nous avons misé sur le dopage du MoS2 par du tantale (Ta) dont le comportement s’est avéré particulièrement homogène dans les deux conditions. » Déposé en couches successives sur une épaisseur micrométrique et grâce à un procédé en phase vapeur (PVD), les chercheurs trouvent la composition et la microstructure optimale. Le premier prototype, testé sur des mécanismes réels, a déjà montré son efficacité pendant toutes les phases d’utilisation. Les résultats ont d’ailleurs été publiés dans la revue internationale Advanced Functional Materials et fait l’objet d’un dépôt de brevet.
Alors comment améliorer les propriétés de ce bisulfure pour qu’il résiste aux conditions extrêmes du vide spatial ? Les chercheurs, réunis sur le projet, ont parié sur le dopage du MoS2 par un additif métallique inédit au vu de ses propriétés tribologiques. « Tous les matériaux qui avaient été testés avaient de bons résultats soit sous air, soit sous vide. Nous avons misé sur le dopage du MoS2 par du tantale (Ta) dont le comportement s’est avéré particulièrement homogène dans les deux conditions. » Déposé en couches successives sur une épaisseur micrométrique et grâce à un procédé en phase vapeur (PVD), les chercheurs trouvent la composition et la microstructure optimale. Le premier prototype, testé sur des mécanismes réels, a déjà montré son efficacité pendant toutes les phases d’utilisation. Les résultats ont d’ailleurs été publiés dans la revue internationale Advanced Functional Materials et fait l’objet d’un dépôt de brevet.
Avant d’être véritablement utilisé dans l’espace, le nouveau lubrifiant devra passer encore quelques tests, pour s’assurer de son comportement en conditions réelles. L’équipe s’attachera à trouver un « optimum », notamment grâce au tribomètre « Pedeba » du LaMCoS, un appareil capable de recréer des conditions spatiales, depuis le campus de la Doua. « Ce nouveau lubrifiant, déposé grâce à nos collègues du LIST au Luxembourg, sera testé et caractérisé à l’échelle élémentaire au LaMCoS et au Femto-ST puis sur des composants standards tels que des roulements à billes au CNES en France. Ces derniers sont souvent utilisés, par exemple sur les antennes de pointage de communication de satellites qui sont en perpétuel mouvement, et ont besoin d’une durée de vie très longue. Ça sera donc un bon indicateur d’efficience tribologique. »
Il faudra donc encore quelques années avant de voir les mécanismes spatiaux équipés de ce nouveau lubrifiant révolutionnaire. L’aventure continue pour les chercheurs du LaMCoS, du CNES, du LIST, de l’Institut FEMTO-ST et de l’Université de Toronto, toujours en lien étroit. « Le tissu collaboratif est capital dans la conquête spatiale et pour la partie tribologique, le LaMCoS peut apporter sa pierre à l’édifice », conclut Aurélien Saulot.
[1] Centre National des Études Spatiales
[2] Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (CNRS/INSA Lyon/UdL)

Recherche
« I CARE » fera le ménage dans l’espace
Les débris orbitaux : une question qui inquiète de plus en plus les experts du spatial. Satellites inopérants, boulons, moteurs errants… Les déchets gravitant en orbite se déplacent si vite qu’ils peuvent causer des dommages sans précédent lorsqu’ils rentrent en collision avec d’autres satellites.
Clara Moriceau (INSA Rouen Normandie, Génie Mathématique 2019), Manuel Amouroux (INSA Lyon, Génie Informatique 2019) et Anthony De La Llave (INSA Rouen Normandie, Génie Mathématique 2016) sont trois ingénieurs récemment diplômés. Ils poursuivent actuellement leurs études en mastère spécialisé à l’ISAE-Supaero de Toulouse et ont remporté l’une des trois places du concours « Parabole » organisé par le Centre National d’Études Spatiales (CNES) grâce à leur système de capture, « I CARE ». Explications.
Des orbites encombrées
135 millions d’objets de 1mm ou plus1 : c’est le nombre vertigineux de débris qui errent dans l’espace. Situés majoritairement en orbite basse (entre 700 et 1000 km d’altitude) et en orbite géostationnaire (à 36 000 km d’altitude), les débris spatiaux mettent en péril les engins actifs. En raison de la vitesse à laquelle ils se déplacent, mêmes les plus petits sont capables de faire exploser un satellite en mission, générant à leur tour de nouveaux débris. Une réaction en chaîne dangereuse pour les engins actifs en orbite, pour les stations abritant des astronautes et à fortiori, pour certaines zones de la terre qui voient retomber les débris qui n’auraient pas été désintégrés lors de leur retour dans l’atmosphère. « La  problématique de l’encombrement spatial ne date pas d’hier. Elle existe depuis que l’homme envoie des satellites dans l’espace. Cependant, elle s’est accentuée avec la prolifération de nano satellites, appelés CubeSats. Ces engins miniatures, simples et peu coûteux à fabriquer, permettent de tester des instruments, réaliser des expériences scientifiques, développer des initiatives commerciales ou des projets éducatifs. Mais une fois inopérants, ils continuent d’envahir l’espace, menaçant la sécurité et la viabilité d’autres missions spatiales. L’enjeu des outils de capture est d’anticiper les déplacements de ces débris errants à une vitesse allant jusqu’à 28 000 km à l’heure puis de les attraper », explique Manuel Amouroux.
problématique de l’encombrement spatial ne date pas d’hier. Elle existe depuis que l’homme envoie des satellites dans l’espace. Cependant, elle s’est accentuée avec la prolifération de nano satellites, appelés CubeSats. Ces engins miniatures, simples et peu coûteux à fabriquer, permettent de tester des instruments, réaliser des expériences scientifiques, développer des initiatives commerciales ou des projets éducatifs. Mais une fois inopérants, ils continuent d’envahir l’espace, menaçant la sécurité et la viabilité d’autres missions spatiales. L’enjeu des outils de capture est d’anticiper les déplacements de ces débris errants à une vitesse allant jusqu’à 28 000 km à l’heure puis de les attraper », explique Manuel Amouroux.
Identifier et capturer
 Pour faire le grand ménage dans l’espace, des solutions sont développées par les experts : filets de capture, harpons magnétiques, satellites autodestructibles, etc. Cependant, ces systèmes visent généralement les débris de grande taille. Dans le cadre du concours organisé par le CNES, Manuel, Clara, Anthony et leur équipe ont concentré leurs efforts sur la capture des CubeSats gravitant en orbite basse. « Notre projet se matérialise par un bras robotisé muni de deux systèmes de captures interchangeables : une pince ou un électro-aimant. « I CARE », dont le nom signifie Identification & Capture for Active debris Removal Experiment, devra être complémentaire aux autres solutions déjà existantes comme la capture par filet par exemple, tout en s’intégrant aux plateformes standards déjà existantes. Notre prototype nettoyeur nous met face à deux défis : celui de designer un système capable de capturer des petits débris et celui de développer un algorithme d’intelligence artificielle qui sera entraîné à identifier le mouvement et anticiper les déplacements de l’objet », poursuit Clara Moriceau.
Pour faire le grand ménage dans l’espace, des solutions sont développées par les experts : filets de capture, harpons magnétiques, satellites autodestructibles, etc. Cependant, ces systèmes visent généralement les débris de grande taille. Dans le cadre du concours organisé par le CNES, Manuel, Clara, Anthony et leur équipe ont concentré leurs efforts sur la capture des CubeSats gravitant en orbite basse. « Notre projet se matérialise par un bras robotisé muni de deux systèmes de captures interchangeables : une pince ou un électro-aimant. « I CARE », dont le nom signifie Identification & Capture for Active debris Removal Experiment, devra être complémentaire aux autres solutions déjà existantes comme la capture par filet par exemple, tout en s’intégrant aux plateformes standards déjà existantes. Notre prototype nettoyeur nous met face à deux défis : celui de designer un système capable de capturer des petits débris et celui de développer un algorithme d’intelligence artificielle qui sera entraîné à identifier le mouvement et anticiper les déplacements de l’objet », poursuit Clara Moriceau.
Apprivoiser l’apesanteur
Dans le cadre du concours organisé par le CNES, les étudiants ont été sélectionnés pour tester leur prototype à bord du véhicule de la filiale Novespace, l’avion Zéro G. « Nous avons présenté un rapport technique de notre prototype qui a séduit le jury du CNES. La prochaine étape visera à améliorer la fiabilité de l’engin en vue du vol à bord de l’avion Zéro G. C’est un véhicule qui permet de 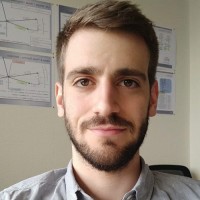 reproduire l’absence de pesanteur en décrivant des trajectoires paraboliques. En chute libre, l’apesanteur est sensiblement la même que dans l’espace (0.02g), comme le vivent les astronautes à bord de l’ISS, la Station Spatiale Internationale. Tester notre prototype dans ces conditions nous permettra d’entraîner l’algorithme à identifier le mouvement et la vitesse d’un CubeSat et vérifier la robustesse de nos pinces. Rendez-vous en octobre 2020 sur le tarmac de Bordeaux-Mérignac pour la suite ! », conclut Anthony De La Llave.
reproduire l’absence de pesanteur en décrivant des trajectoires paraboliques. En chute libre, l’apesanteur est sensiblement la même que dans l’espace (0.02g), comme le vivent les astronautes à bord de l’ISS, la Station Spatiale Internationale. Tester notre prototype dans ces conditions nous permettra d’entraîner l’algorithme à identifier le mouvement et la vitesse d’un CubeSat et vérifier la robustesse de nos pinces. Rendez-vous en octobre 2020 sur le tarmac de Bordeaux-Mérignac pour la suite ! », conclut Anthony De La Llave.
1Source (2017) : CNES

Recherche
Mars dans le viseur, il est diplômé… de Génie Mécanique !
André Debus est ingénieur INSA Lyon diplômé en 1983 du département Génie Mécanique Construction (GMC). C’est grâce à une candidature spontanée qu’il rentrera au Centre national d’études spatiales pour travailler sur l’exploration… de la planète Mars. Entretien avec un passionné de l’espace.
De quoi allez-vous parler lors de la conférence qui se tiendra le 15 décembre prochain à l’INSA Lyon ?
D’ExoMars. Exo pour exobiologie, qui désigne tout simplement un programme de recherche de traces de vie sur la planète Mars, scrutée en ce sens depuis 40 ans. Après un premier lancement en 2016, la deuxième mission du programme, qui sera engagée en 2020, aura pour objectif de déposer sur le sol de la planète rouge une plateforme russe et un robot mobile (rover) européen pour forer le sol martien, recueillir et analyser des échantillons à la recherche de composants organiques d’origine biologique. La vie sur Terre est apparue dans les mêmes conditions qu’a fort probablement connu Mars durant son premier milliard d’années d’existence…
Durant cette soirée, d’autres thématiques seront abordées, comme celle de l’éthique. Pourquoi ?
Il existe en effet une dimension éthique liée à la protection de la planète. En 1967, l’ONU a rédigé un traité international de loi spatiale, qu’on appelle aussi « traité de l’espace », qui a été ratifié par presque tous les États afin de régir leurs activités en matière d’exploration ou d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. L’article 9 de ce traité les oblige à veiller à ne pas contaminer l’espace et vice-versa. C’est d’ailleurs pour cela que si un risque de contamination existe, les sondes interplanétaires utilisées pour les explorations doivent être biologiquement décontaminées, ce qui a été une activité, entre autres, que j’ai menée pendant une vingtaine d’années.
Pourquoi cela vous tenait-il à cœur de tenir une conférence à l’INSA Lyon, votre école de formation ?
D’abord parce que Khalid* m’en parlait depuis longtemps ! Ensuite, parce que le spatial est très peu connu. Les gens n’ont, je pense, qu’une vision restreinte des activités spatiales (la fusée Ariane surtout ou quelques missions spectaculaires comme Rosetta-Philae), alors je pense que c’est bien de présenter un peu plus en détail ce qui est fait. L’exploration du système solaire et les sciences de l’univers ne sont qu’une petite partie des activités spatiales. Il y a tant de choses à découvrir et encore à comprendre, il y a donc beaucoup de choses à faire.
Quel regard portez-vous sur votre diplôme obtenu à l’INSA Lyon ?
C’est un diplôme relativement polyvalent. A l’INSA, en GMC, on touchait à la thermodynamique, l’électronique, l’informatique… Quand je suis arrivé au CNES, je travaillais sur les matériaux mais les autres thèmes ne m’étaient pas inconnus et j’ai pu grâce à cela développer des compétences, en particulier en côtoyant ou travaillant avec des experts. Quand on rentre dans une société, on a toujours le choix d’acquérir des connaissances générales, comme je l’ai fait, ou de devenir expert. L’INSA donne d’excellentes bases qui donnent l’opportunité de se diversifier.
J’aimerais dire aux élèves-ingénieurs qu’avec un diplôme INSA, quel qu’il soit, ils peuvent travailler dans le domaine du spatial, que ce soit dans l’industrie, les agences ou les laboratoires scientifiques.
Informations pratiques
Conférence-débat : ExoMars, à la recherche de vie sur Mars !
Où : Amphi Chappe, Bâtiment Claude Chappe, 6 Avenue des Arts - INSA Lyon
Quand : Le 15 Décembre 2017 de 18h30 à 19h30
Son CV en quelques lignes
Diplôme INSA Lyon en poche, André Debus obtient en 1987 une thèse en physique des matériaux avec le laboratoire GEMPPM (Groupe d'Études de Métallurgie Physique et de Physique des Matériaux, INSA Lyon-Université Claude Bernard Lyon 1). Il entre dans une société lyonnaise comme ingénieur des matériaux. En parallèle, il avait envoyé une candidature spontanée au CNES, Centre National d’Etudes Spatiales, dont il recevra une réponse… Un an plus tard !
Reçu en entretien, il sera embauché dans la foulée comme ingénieur des matériaux sur un projet d’exploration de la planète Mars avec la Russie. La sonde spatiale Mars 96 échoue mais André Debus poursuit son travail cette fois sur la mission spatiale Rosetta-Philae, en tant que responsable qualité chargé du suivi du développement des instruments scientifiques, puis comme responsable technique chargé du développement du système de batteries de l’atterrisseur Philae. Pendant toutes ces années, il a également développé les activités de protection planétaire, qu’il a poursuivi jusqu’en 2009 en support à l’avant-projet ExoMars.
En 2009, André Debus décroche un Master en astrophysique spécialité technique spatiale et instrumentation, en VAE (validation des acquis de l’expérience). Il part ensuite pendant 6 ans en détachement au centre technique de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) à Noordwijk, aux Pays-Bas, en tant qu’ingénieur instruments dans l’équipe projet ExoMars. A son retour au CNES en 2015, il devient chef de projet des contributions françaises au programme ExoMars.
*Le département TC à l’initiative
C’est sur une idée de Khalid Idrissi, enseignant au département TC (Télécommunications, Services et Usages) à l’INSA Lyon et chercheur au LIRIS, (Laboratoire d’Informatique en Images et Systèmes d’Information), qu’André Debus est de passage à l’INSA.
« André Debus est un copain de promotion, j’étais en Génie Electrique et lui Génie Mécanique Conception. Cela faisait longtemps que je voulais qu’il intervienne à l’INSA et nous profitons de la conférence qu’il donne la veille au Planétarium de Vaulx-en-Velin pour organiser sa venue ici. Il m’a semblé important que nos étudiants, en TC et plus généralement à l’INSA, sachent que leurs compétences peuvent servir également dans le spatial. Nous avons par exemple en TC une option sur la communication satellitaire. D’un autre côté, je souhaitais une conférence alliant technique et éthique, et donc, faire intervenir quelqu’un pour qui la démarche scientifique et technique ne peut pas être dissociée de tout ce qui touche au respect de l’autre. Nous voulons former des ingénieurs responsables, humanistes, qui demain devront prendre des décisions en connaissance de cause, en mesurant l’impact qu’elles auront sur leur environnement, notre environnement » souligne Khalid Idrissi.
Créé en 1961, le CNES est l’établissement public chargé de proposer au Gouvernement la politique spatiale française et de la mettre en œuvre au sein de l’Europe. Il conçoit et met en orbite des satellites et invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise l’émergence de nouveaux services, utiles au quotidien. Le CNES est à l’origine de grands projets spatiaux, lanceurs et satellites, qu’il fait réaliser par l’industrie. Il s’entoure également de partenaires scientifiques et est engagé dans de nombreuses coopérations internationales. La France, représentée par le CNES, est le principal contributeur de l’ESA (Agence spatiale européenne), chargée par ses 20 Etats membres de conduire la politique spatiale de l’Europe. Le CNES compte près de 2 500 collaborateurs, femmes et hommes répartis dans 4 centres : à Paris, le siège social et la Direction des lanceurs (DLA) ; à Kourou, le Centre spatial guyanais (CSG) et à Toulouse, le Centre spatial de Toulouse (CST) qui est le centre technique et opérationnel du CNES où les ingénieurs étudient, conçoivent, développent, réalisent, mettent à poste, contrôlent et exploitent les systèmes orbitaux, satellites et instruments. Les activités du CNES se répartissent en cinq domaines d’intervention : Ariane (les lanceurs), les sciences, l’observation de la Terre, les télécommunications, la défense.
www.cnes.fr / Facebook.com/CNESFrance / twitter.com/CNES_France

Formation
Lancement Ariane 5 : deux INSA assistent au décollage de la fusée
Jad Fayad, élève-ingénieur en 5e année au département Génie Mécanique Développement de l’INSA Lyon, et Ameer Abdul Khalek, en 5e année au département Génie Mécanique Conception, ont vécu une expérience exceptionnelle en Guyane, au centre spatial de Kourou.
Ils avaient gagné le 1er prix national de la compétition ActInSpace organisé par le CNES (centre national d’études spatiales), l’ESA (agence spatiale européenne) et Airbus.
Leur cadeau : partir une semaine en Guyane et assister au lancement de la fusée Ariane 5.
« Nous avons passé une semaine en Guyane entre le 17-23 décembre. On a commencé l'aventure par 2 jours du camping dans la jungle : 4 heures de remontée en pirogue du fleuve de Kourou, une nuit en carbet, du kayak… Ensuite, nous sommes retournés à Kourou et nous avons visité tous les bâtiments du centre spatial guyanais, notamment les bâtiments de construction des fusées et les salles de lancement et le chantier d’Ariane 6 prévu pour 2020 » raconte Jad, des images plein la tête.
Point d’orgue du voyage : le jour du lancement. Invités dans la salle VIP Jupiter, Ameer et Jad se retrouvent aux côtés de toutes les personnes importantes généralement présentes à ce grand événement.
« Il y avait les clients des satellites, des généraux de l'armée, des responsables de l’ESA et du CNES et des hommes politiques » poursuit Jad

Salle Jupiter
« Nous avons suivi en direct les dernières préparations. Nous avons croisé les doigts pour que tous les voyants restent verts, notamment celui des conditions météorologiques. Et puis, une minute avant le lancement, la voix du directeur des opérations (DDO) retentit dans les haut-parleurs. Nous sommes tous sortis sur la terrasse pour regarder le décollage. Commence ainsi le décompte final : ’’… 3 2 1 top, allumage d’EPC, allumage des OAPs décollage’’. La terre a commencé à trembler, nous avons vu une boule intense orangée apparaitre, c’était comme s’il y avait un autre soleil dans le ciel. Ce n’est que quelques secondes après que le vrai bruit de la fusée s’est fait entendre et tout s’est mis à vibrer. C'était 3 minutes incroyables… » raconte Ameer.
Ce voyage restera à jamais gravé dans leurs mémoires.
« Ce qui était émouvant dans cette expérience, c'était de voir les deux extrêmes de l'Humanité : une vie primitive et basique dans la jungle, et la haute technologie du Centre Spatial Guyanais » conclut Jad.
Plus d’infos :
- Jad et Ameer aux côtés de Didier Faivre directeur du CSG, et Chantal Berthelot, députée de Guyane, en salle Jupiter accompagnés par Didier Lapierre responsable valorisation et transfert de technologie du CNES, et chef du projet ActInSpace
- Vidéo officielle du lancement (source CNES) :

