
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Clément CAMBIER
Développement de revêtements et de la fonctionnalisation de surface des plaques bipolaires en titane
Doctorant : Clément CAMBIER
Laboratoire INSA : MatEiS
Ecole doctorale : ED 34 : Matériaux de Lyon
Ce travail a pour objectif l’étude du film passif des plaques bipolaires et le développement d’un revêtement original remplissant les spécifications techniques d’une pile à combustible de type PEMFC. Le choix s’est porté sur le titane car son film passif (TiO2) est stable chimiquement et ne présente pas de risque de transpassivation comme l’oxyde de chrome des aciers inoxydables. Cependant, la faible conductivité électrique du film passif entraine une diminution des performances de la PEMFC. Pour commencer, le recuit d’un revêtement de TiO2 dopé tantale élaboré par dépôt PVD a permis d’activer les dopants et de garantir le caractère conducteur du matériau. Les propriétés semiconductrices dépendent de la teneur en Ta. En-dessous de 9 %at. de Ta, les dépôts cristallisent et deviennent conducteurs grâce l’apport d’électrons libres. Toutefois, ces dépôts ne permettent pas d’amorcer une diminution de la résistance de contact interfaciale (RCI). Cette décorrélation entre la résistivité du matériau et sa RCI est attribuée à une diode de Schottky à l’interface entre la couche de diffusion des gaz (GDL) métallique et le revêtement semiconducteur, amplifiée par les défauts de surface du TiO2 et la solubilité du Ta trop faible. La deuxième voie proposée consiste à modifier le type de liaisons du revêtement. En ajoutant de l’azote dans le TiO2, il est possible de contourner la problématique de la diode de Schottky en ayant un contact métal/métal. L’impact de l’oxygène dans les dépôts d’oxynitrure de titane a ainsi pu être menée. Un compromis a été trouvé entre les liaisons iono-covalentes qui apportent une meilleure stabilité chimique et les liaisons métalliques qui augmentent la conductivité du dépôt. Ces travaux montrent l’importance de l’extrême surface du revêtement et de son effet sur la RCI. Le contrôle de la barrière de Schottky rendrait possible l’utilisation de matériaux jusqu’à présent écartés pour cette application.
Información adicional
-
INSA Lyon - Amphi AE2 - Département Génie Electrique - Bâtiment Gustave Ferrié (Villeurbanne)
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Recherche
« À base d’algues, nos emballages jetables sont compostables et comestibles »
Le plastique n’est plus du tout fantastique : omniprésent, on le sait désormais nocif pour l’environnement, la santé humaine et les écosystèmes. Seulement, le plastique est pratique. Ou tout du moins, l’emballage jetable l’est pour bon nombre de situations de la vie courante. Pierre-Yves Paslier, diplômé du département matériaux, a fondé l’entreprise « Notpla ». Avec elle, il met en évidence un fait : dans la nature, l’emballage existe et ne dure jamais plus longtemps que son contenu, comme la peau d’un fruit. L’entreprise de l’ingénieur-produit a trouvé la recette pour fabriquer des emballages jetables et même comestibles à partir d’algues. L’innovation a récemment été récompensée par le Prince William, à travers le Earthshot Prize 2022, dans la catégorie « Construire un monde sans déchets ».
Avec « Notpla », vous introduisez une innovation de taille dans le monde du packaging : remplacer le plastique des emballages jetables par un matériau biosourcé, l’algue. Pourriez-vous résumer ?
Nos produits sont des emballages dits « jetables » dédiés à la consommation instantanée ou hors de chez soi comme les repas à emporter ou les snacks pendant les évènements sportifs. Nous avons souhaité nous concentrer sur l’industrie du déchet jetable car c’est souvent celui qui est le plus à même de se retrouver directement dans la nature. À la différence du packaging plastique ou carton généralement utilisés dans ces cas-là, nos solutions sont naturellement biodégradables puisqu’elles sont fabriquées à base d’algues. L’idée était de ne pas produire un déchet que la nature ne pourrait pas gérer. Concrètement, il suffit de mettre l’emballage au compost ou même, de le manger pour que celui-ci disparaisse !

Différents types d’emballages jetables à base d’algues proposé par Notpla. ©Notpla
Pour arriver à cette solution, vous avez exploré l’industrie des algues, à force d’essais et de recherche. À partir de quelles algues travaillez-vous ?
La plupart de celles utilisées dans nos produits sont des algues brunes et rouges. Selon les usages, nous avons appris à utiliser des espèces différentes, mais c’est un monde très vaste. En Europe, l’industrie des algues n’en est qu’à ses balbutiements contrairement à l’Asie du Sud-Est par exemple, où elle est très développée. En réalité, beaucoup de produits du quotidien élaborés à l’échelle industrielle en contiennent déjà : dans les glaces, des produits pharmaceutiques, en cuisine… Nous avons adapté certaines de leurs propriétés pour en faire du packaging et remplacer le plastique. Du géant de vente d’articles sportifs aux entreprises de livraison de repas à domicile, beaucoup d’entreprises sont intéressées.
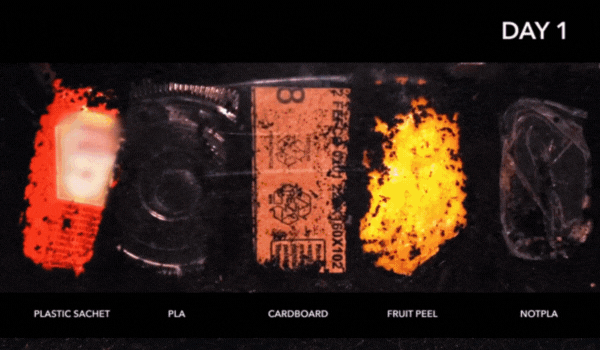
La décomposition du déchet à base d’algues est très rapide. © Notpla
On dit souvent que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Êtes-vous en accord avec ce principe ?
Bien sûr, la solution la plus simple pour réduire les effets néfastes du plastique est de réduire sa consommation d'emballages, et c’est d’ailleurs le premier réflexe à avoir. Seulement parfois, l’emballage est nécessaire, pour sa fonctionnalité. Le meilleur déchet plastique est celui que l’on ne produit pas car si ce matériau est très performant, il est à haut risque pour les océans, les écosystèmes et même notre santé. Le recyclage du plastique ne fonctionne pas en l’état actuel des choses : dans le monde, seulement 9 % des déchets plastiques sont réellement recyclés. La manière dont on emballe est très déconnectée de la réalité et c’est un fait que j’ai éprouvé les premières années de ma vie professionnelle : j’étais ingénieur-produit dans un grand groupe de produits cosmétiques et d’hygiène. En quelques secondes, de grandes quantités de plastiques sont produites, et mettront des milliers d’années avant de disparaître.
Pierre-Yves Paslier et son associé avaient fait le buzz sur les
réseaux sociaux grâce à leur technique à base d’algues
Zoomons d’ailleurs sur votre parcours professionnel. Comment êtes-vous passé de l’INSA à « Notpla » ?
En sortant de l’INSA Lyon, j’ai été embauché à la suite de mon stage de fin d’études dans un grand groupe. Ayant suivi l’option « design » pendant mes études d’ingénieur, je trouvais intéressant de travailler dans le domaine du packaging : les enjeux de matériaux et d’industrialisation liaient vraiment l’ingénierie et le design. Je travaillais sur les lancements de packaging plastique produits à des centaines de millions d’unités : des produits jetables qu’il était impossible de faire entrer dans des circuits vertueux comme le réemploi par exemple. La situation me pesait. J’ai décidé d’approfondir mes compétences en design avec un master en Innovation Design Engineering dispensé entre l’Imperial College London et the Royal College of Art. À cette occasion, j’ai rencontré mon cofondateur, Rodrigo Garcia Gonzalez avec qui nous nous sommes mis en tête d’explorer des matériaux naturels pour produire un emballage biodégradable. Dans notre cuisine, nous avions tourné une vidéo « tutoriel » qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à une technique inventé par Unilever à base d’algues. Cela nous a motivés à trouver une solution plus aboutie et à transformer ces expérimentations en un projet solide et scientifique. Les financements et les fonds d’investissements nous ont permis d’embaucher ingénieurs, designers et chimistes. Aujourd’hui, nous avons remplacé plus de trois millions de plastique à usage unique et nous sommes 70 salariés chez Notpla.
Vous avez suivi une option « design » lors de vos études d’ingénieur. Quels liens faites-vous entre les deux domaines d’expertise ?
Le rôle de l’ingénieur est de résoudre des problèmes et cette capacité peut se traduire de plein de manières différentes. Je crois qu’il est important de pouvoir dialoguer précisément avec les techniciens, mais aussi d’être capable d’expliquer le raisonnement logique derrière la technique. C’est peut-être ici que se rejoignent les deux métiers : le designer s’attarde sur l’usage et le besoin des utilisateurs, il n’est pas nécessairement face à un problème technique, mais prend en compte la problématique sociale à laquelle le produit doit répondre. Avoir les deux casquettes permet finalement d’être à la confluence de la réalité technique et la réalité de la société.
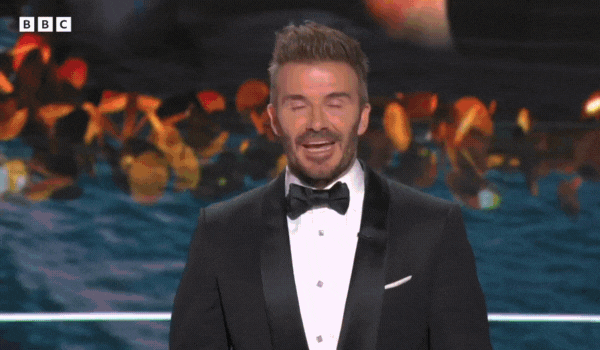

Sciences & Société
Soutenance de thèse : Adrien TOPALIAN
Relation between molecular architecture and properties of aspartate-based polyurea networks
Doctorant : Adrien TOPALIAN
Laboratoire INSA : IMP
Ecole doctorale : ED34 Matériaux de Lyon
Ce projet vise à comprendre la structure des revêtements de polyurée à base d'esters d'aspartate et à faire le lien avec les variations de propriétés mécaniques observées dans le temps. Les réseaux synthétisés à partir d'une amine réactive spécifique ont tendance à s’assouplir avec le temps, et cette diminution de la rigidité est encore plus rapide lorsque des tensioactifs sont ajoutés à la formulation.
Des systèmes modèles représentatifs des réseaux sont synthétisés et analysés par RMN. La formation d'hydantoïne par réaction des groupements urée avec les groupements ester est mis en avant. La présence d'agents acide au sein du réseau accélére ce phénomène. Ensuite, les paramètres physiques permettant l'accélération de la formation d'hydantoïne sont étudiés, tels que l'humidité, l'épaisseur du film, la mobilité du réseau et le recuit.
Un aspect du travail porte sur l'influence de la formation d'hydantoïne sur les propriétés mécaniques. L’Am1 contient un additif qui peut être un plastifiant. La présence de cet additif entraîne un phénomène d'exsudation au sein des réseaux après recuit. Une autre amine réactive, Am2, sans additif, est utilisée. Les réseaux synthétisés en présence de cette dernière présentent une évolution des propriétés différentes suite à la formation d’hydantoïne.
A partir de ces résultats, il est montré que l'évolution des propriétés mécaniques dépend principalement de deux facteurs. D'une part, l'éthanol piégé dans le réseau a tendance à le plastifier, ce qui entraîne une diminution de la Tg. D’autre part, la présence du plastifiant au sein de l’amine réactive entraîne une variation des propriétés mécaniques. En revanche, l'interaction entre le plastifiant et le réseau diffère lorsque ce dernier contient des groupements hydantoïne ou urée.
Dans la dernière partie, de nouveaux réseaux constitués de fonctions biuret ont été étudiés. Suite à la formation d'hydantoïne au sein de ces réseaux, une réorganisation des liaisons hydrogène est observée. Cette réorganisation augmente le module de Young.
Información adicional
-
Amphithéâtre de la Bibliothèque Université Lyon 1 - (BU Lyon1) (Villeurbanne)
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Carmen MUÑOZ-FERREIRO
Processing and characterization of ceramic composites with two dimensional layered nanomaterials
Doctorante : Carmen MUÑOZ-FERREIRO
Laboratoire INSA : MATEIS
Ecole doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon
This thesis work is focused on the development of novel multifunctional zirconia composites using two different 2D nanomaterials as fillers, few-layered graphene (FLG) and boron nitride nanosheets (BNNS). BNNS were exfoliated using three different technologies. Eco-responsible powder homogenization routines were evaluated for the dispersion of the nanostructures throughout the ceramic powder and the materials were consolidated using a spark plasma sintering (SPS) furnace.
A systematic study of the powder processing and the sintering conditions on the composites with FLG revealed the optimal processing conditions to maximize the FLG crystallinity, which decreases the electrical percolation threshold below 1 vol%. The electrical discharge machinability of the composite with 20 vol% was also analyzed. The addition of the exfoliated BNNS resulted in homogeneous dense composites with submicrometer grain size. The incorporation of partly hydroxylated BNNS revealed the absence of chemical bonding at the zirconia/BN interphase. The scalability of the materials was confirmed in all the different materials.
The evaluation of stable crack propagation evidenced rising R-curves only in the materials with larger nanosheets. Reinforcement by bridging of the nanosheets was corroborated although no influence of the reinforcement was detected when measuring the fracture toughness. Finally, since tetragonal stabilized zirconia is sensitive to the presence of water molecules, slow crack growth and hydrothermal aging were analyzed on the composites with either type of nanosheets.
Información adicional
-
Salón de Actos, Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) (Séville (Espagne))
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Liutong HOU
« Design of polymer materials for innovative foams »
Doctorant : Liutong HOU
Laboratoire INSA : IMP
Ecole doctorale : ED534 : Matériaux de Lyon
En combinant le polypropylène greffé et les liquides ioniques (ILs), la nouvelle génération d'ionomères (appelés LIonomères) a été conçue et adaptée dans ce travail. Les LIonomères possédant les meilleures propriétés sont ensuite utilisés pour préparer des matériaux légers en utilisant le dioxyde de carbone supercritique (scCO2) comme agent physique. Une série de LIonomères avec différentes structures sont préparés via le réglage des teneurs en anhydride maléique (MA) et la nature des ILs, la dispersion du ILs, et la longueur des "branches liquides" s'assemblant à partir des paires de cations/anions des ILs réactifs. La versatilité de la nature de l'IL sur les propriétés des LIonomères est mise en évidence et comparée à l'Ionomère de Zn conventionnel. Les spectroscopies RMN et FTIR sont utilisées et révèlent l'existence d'interactions ioniques- polaires/ioniques et/ou la création de liaisons chimiques en fonction de la nature chimique des ILs. Les propriétés rhéologiques mettent en évidence la présence de telles interactions entre les LIonomères à base des ILs, similaires aux interactions au sein des Zn-Ionomères traditionnels. Ces interactions et distributions multiples peuvent également influencer la dynamique moléculaire, en particulier dans la phase amorphe rigide. Grâce à l'existence d'interactions entre l'MA et les ILs et à la génération d'une forme β-cristalline ainsi que de diverses morphologies riches en ions, les LIonomères permettent d'obtenir un compromis exceptionnel entre rigidité et extensibilité. En considérant le CO2 comme agent physique, la moussabilité du PPgMA pur a été considérablement améliorée grâce aux réseaux ioniques par la coopération des ILs ou Zn2+Ac. La morphologie de la mousse et le comportement à la compression varient en fonction des combinaisons cation/anion des liquides ioniques ainsi que du type d'additif. Ces résultats offrent de nouvelles perspectives pour la conception de la génération 2.0 d'ionomères qui peuvent être utilisés dans des applications de moussage avec l'aide du CO2.
Información adicional
-
Amphithéâtre Laura Bassi (Villeurbanne)
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Anne COLOIGNER
Control of the Final Morphology of Epoxy-Thermoplastic Blends and their Mechanical Properties
Doctorante : Anne COLOIGNER
Laboratoire INSA : MATEIS
Ecole doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon
Thermosetting epoxy resins are used to lighten materials in the aerospace and automotive industry. Nevertheless, high crosslink density makes the resins brittle. Thermosets can be toughened by the dissolution of a thermoplastic into resin monomers which phase separates during the curing cycle. By controlling the final morphology of the resin and the associated length scale, the mechanical properties can be improved for composite applications. Previous works allowed to identify two key parameters for controlling the morphology of epoxy-thermoplastic blends. The interaction parameters between the constituents control the onset of phase separation during the crosslinking reaction and the corresponding conversion stage. The glass transition temperature of the blend at phase separation controls the growth rate of the morphology. By considering an appropriate range for these two parameters, it appeared possible to prepare toughened epoxy resins with tailored morphologies. Polyetherimides of different compositions with a wide range of glass transition temperatures (Tg) and solubility parameters have been synthesized. These systems allowed to consider various affinities with the thermosetting precursors and different Tg’s in order to synthesize epoxy-thermoplastic resins with adequate final morphologies. In addition to these tailored polyetherimides, a commercial polyetherimide (Ultem 1000) is studied. Finally, various morphologies such as sea-island thermoplastic particles and co-continuous structures have been observed. The fracture toughness of these systems has been also studied by measuring the released energy during a crack propagation. The objective was to improve our understanding regarding the control of the morphology by preparing new epoxy-thermoplastic blends with enhanced mechanical properties. By varying the compatibility between the constituents and the Tg of various polyetherimides, we have controlled the onset of phase separation in these systems, leading to various morphologies of different thermoplastic sizes. Finally, the mechanical properties of the thermoplastic-modified epoxy resins are optimized when co-continuous morphologies of hundreds of nanometers are obtained.
Información adicional
-
Amphithéâtre du CNRS Rhône Auvergne (Villeurbanne)
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Gata Joseph AYEMI
Methodology for the development of Smart epoxy/LDH-EDDS coatings for corrosion protection of XC38 carbon steels
Doctorant : Gata Joseph AYEMI
Laboratoire INSA : MATEIS
Ecole doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon
Les hydroxydes doubles stratifiés (LDH) sont des candidats intéressants comme réservoirs d'inhibiteurs de corrosion pour la protection des métaux. En effet, ces espèces présentent une forte capacité à libérer l'inhibiteur contenu entre leurs lamelles d'hydroxyde, et sur la base du principe d'échange d'anions, elles permettent simultanément la capture d'espèces agressives telles que l'ion chlorure présent dans la solution. En raison de leurs propriétés susmentionnées, ils représentent des charges intéressantes qui peuvent être incorporées dans la matrice des revêtements époxy pour améliorer les propriétés de barrière. La conception d'un système intelligent d'inhibition de la corrosion, utilisant ce matériau, pourrait augmenter de manière significative la durabilité et l'efficacité du système revêtu en fournissant une protection active contre la corrosion.
L'objectif de cette thèse est d'étudier l'efficacité du système LDH Zn-Al comme réservoir intelligent d'acide éthylènediamine-N,N'-disuccinique (EDDS). Le LDH [Zn2Al(OH)6]+[EDDS]4-0.25 2H2O (LDH-EDDS ) est ensuite incorporé dans une matrice de revêtement époxy pour une protection active contre la corrosion de l'acier au carbone XC38 en milieu chlorure de sodium. Le choix de l'EDDS non toxique et biodégradable comme inhibiteur vise à remplacer l'acide éthylènediamine-tétraacétique (EDTA), qui est nocif et difficilement biodégradable. La première partie des résultats, présente une méthodologie pour caractériser l'efficacité de la LDH-EDDS essentiellement basée sur des mesures électrochimiques. La deuxième partie des résultats est consacrée à la caractérisation de revêtements époxy contenant différentes quantités de LDH-EDDS afin de déterminer la teneur optimale nécessaire pour obtenir de meilleures propriétés de protection contre la corrosion. L'étude est menée en utilisant des techniques électrochimiques, telles que les courbes courant-potentiel, la spectroscopie d'impédance électrochimique globale et locale (EIS). Les données d'impédance du système revêtu obtenues par SIE sont interprétées en détail à l'aide d'une méthode graphique améliorée et de profils de distribution, de résistivité, de loi de puissance le long de l'épaisseur des revêtements. Ces résultats permettent une meilleure interprétation et compréhension des mécanismes se produisant aux interfaces revêtement/électrolyte et/ou substrat/revêtement. Des analyses complémentaires telles que des observations MEB, OCP-OES, etc sont menées pour proposer une interprétation des résultats.
Mots-clés : Inhibition de la corrosion, Acier au carbone, Revêtement époxy, LDH, EIS.
Información adicional
-
Amphithéatre Chappe - Bâtiment Hedy Lamarr - Villeurbanne
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Sciences & Société
Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Aurélia Charlot
Valorisation de polymères d'origine naturelle et synthétiques : vers la conception de matériaux et de dérivés fonctionnels par des voies de modifications chimiques soutenables et/ou par le contrôle des interactions
Maître de conférences : Aurélia Charlot
Laboratoire INSA : IMP
Rapporteurs :
- Pr. Catherine Amiel, Université Paris-Est (ICMPE)
- Pr. Yves Grohens, Univeristé Bretagne Sud (IRDL)
- Pr. Didier Lecerf, Université Rouen-Normandie (PBS)
Jury :
- Pr. Catherine Amiel, Université Paris-Est (ICMPE)
- Pr. Yves Grohens, Univeristé Bretagne Sud (IRDL)
- Pr. Didier Lecerf, Université Rouen-Normandie (PBS)
- Pr. Jannick Duchet-Rumeau, INSA Lyon (IMP)
- Pr. Etienne Fleury, INSA Lyon (IMP)
- Dr. Véronique Bounor-Legaré, Univ Lyon, (IMP)
Información adicional
-
Amphithéâtre du CNRS Rhône Auvergne Avenue Albert Einstein, Villeurbanne.
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Jonathan QUIBEL
Mécanismes de corrosion fatigue : du fil d’acier perlitique à la nappe composite d’un pneumatique poids lourd.
Doctorant : Jonathan QUIBEL
Laboratoire INSA : MATEIS
Ecole doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon
Dans les pneumatiques poids lourds, la nappe carcasse est un matériau composite dont le rôle principal est de soutenir les contraintes mécaniques issues de la pression de gonflage et de la masse du véhicule. Ce composite est formé d’une gomme (mélange caoutchoutique) et de renforts métalliques composés de fils d’acier perlitique tréfilés assemblés sous forme de câbles. Lors du roulage, la nappe carcasse est sollicitée en flexion cyclique sous tension. De plus, différentes espèces chimiques diffusent dans la gomme jusqu’au renfort métallique. Il peut en résulter un endommagement de corrosion fatigue (ECF) du composite. La démarche liée à la réduction de la consommation de carburant et donc des émissions de gaz à effet de serre peut passer par une diminution de la masse du pneumatique et donc du métal utilisé. Cependant, il est nécessaire de comprendre l’ECF pour garantir les mêmes performances du pneumatique. Pour cela, cette étude est réalisée à deux échelles : le fil de 180 µm de diamètre constitutif du câble et la nappe composite.
A l’échelle du fil, les essais instrumentés de flexion rotative en environnement aqueux contrôlé montrent que l’endommagement est la conséquence d’un amorçage de fissure de fatigue par dissolution et/ou d’une fragilisation par l’hydrogène du métal. Ils montrent également que la durée de vie des fils est conditionnée par la réactivité de surface des fils par rapport aux ions en solution.
Pour la nappe composite, des essais de flexion cyclique sous tension sont réalisés parallèlement à des simulations par éléments finis des câbles gommés (champs des contraintes mécaniques au sein des fils des câbles). En combinant les résultats expérimentaux et numériques, un mécanisme d’endommagement du composite sollicité en fatigue sous environnement est proposé. Le mécanisme montre l’effet synergique entre l’environnement agressif, la sollicitation de fatigue et la géométrie d’assemblage du renfort métallique.
Información adicional
-
Salle de conférence de la bibliothèque universitaire, Université Lyon 1 (Villeurbanne)
Palabras clave
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Sciences & Société
Soutenance de thèse : Justine TAURINES
Composition-dependent precipitation in Mg/Si graded 6xxx aluminium alloys: from powder metallurgy to hardening kinetics simulation
Doctorante : Justine TAURINES
Laboratoire INSA : MATEIS
Ecole doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon
Recycling Al alloys often leads to uncontrolled ranges of alloying elements compositions. Alloy design based on recycling must therefore account for these composition variations on the alloy properties. High-throughput approaches, such as graded material studies are well adapted to tackle this problem. 6XXX series is a good case study since the contributions of Mg and Si on the metastability cascades are not perfectly understood.
In this PhD, graded materials, with a variation in both Mg and Si contents, are manufactured by powder metallurgy. Mg-rich powder is first poured on Si-rich powder. Then these two powder beds are consolidated by Spark Plasma Sintering and then subjected to a solutionizing treatment during which Mg and Si gradients form and widen. Microstructure and hardness are first characterised along the gradient. Then, an ageing treatment at 170°C is performed to get a whole range of precipitation sequences. The effect of composition on precipitation kinetics (precipitation pathways, precipitation state, hardness) are characterised using TEM, DSC and SAXS. A mean field framework based on classical nucleation and growth theories coupled with a hardening model has been developed and successfully compared to the experiments.
Información adicional
-
Salle de conférence de la bibliothèque universitaire, Université Lyon 1 (Villeurbanne)

