
Art & Culture
Exposition Vie affective et sexuelle : on (s') (t') en parle
Une exposition qui reprend les grands thèmes de l’éducation à la vie affective et sexuelle (amitiés, genre, orientation sexuelle, pratiques, consentement …)
Une exposition qui reprend les grands thèmes de l’éducation à la vie affective et sexuelle (amitiés, genre, orientation sexuelle, pratiques, consentement …), conçue et prêtée par la mission égalité-diversité, la Chaire LGBTQI+ et le SSU de l'Université Claude Bernard.
Venez découvrir les illustrations de Marion Dubois qui rythment les diverses thématiques et informations proposées.
Información adicional
- clemence.abry-durand@insa-lyon.fr
-
Galerie des Humanités - RDC du bâtiment Humanités
Palabras clave
Últimos eventos
Ateliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences
Desde 16 Hasta 18 Mayo
Formation
« Face à la transition écologique, nos sensations et émotions sont utiles. Elles expriment nos aspirations profondes »
Chiffres vertigineux, données du GIEC et de l’IPBES inquiétants, et éco-anxiété : dans une ère où l'utilitarisme déconnecte l'Humain de son environnement et où la vision occidentale privilégie la rationalité au détriment de la sensibilité, émerge un nouveau paradigme. Et si nos sens permettaient de mieux « préserver » et donner envie de « prendre soin de » ?
Dans le cadre de la conférence Archipel, Thomas Le Guennic, professeur agrégé de sciences économiques et sociales au Centre des Humanités de l’INSA Lyon et Magali Ollagnier-Beldame, chargée de recherche en sciences cognitives, laboratoire ICAR UMR CNRS 5191, proposeront un atelier d’initiation à l’écologie sensible ; un champ scientifique en émergence. Ils expliquent pourquoi il est intéressant de s’attarder sur l’équation suivante : homo sapiens = homo sensibilis.
Pédagogie, recherche ou même politique publique, l’écologie sensible est une approche qui semble applicable à toute activité humaine. Comment la définiriez-vous ?
TLG : Je dirais que c’est une approche qui permet de compléter toute connaissance théorique des relations entre les humains et les « autres qu’humains » vivant sur la Terre, à partir de la sensorialité et de la corporéité. Nous connaissons beaucoup de choses sur la nature grâce à la démarche scientifique, mais nous n’avons plus l’habitude, en tant que membres de sociétés occidentales, modernes et urbanisées, d’une approche sensible et émotionnelle de celle-ci. Par exemple, il y a plusieurs façons de percevoir un arbre : il peut représenter un organisme qui capte du Co2 ; il peut représenter un stock de planches ; ou il peut aussi être un être à part entière, qui a le droit de vivre pour lui-même. Il est très inhabituel pour nous, européens occidentaux, de ne pas considérer le vivant comme une ressource définie par son coefficient d’utilité plutôt que comme un être vivant égal à nous-même. Cette approche sensible de la nature est traditionnellement et magistralement portée par les arts, aujourd’hui encore au sein de nos sociétés. Ce qui prouve que nous n’avons pas totalement oublié et que la situation est plus riche et complexe. Ce dont nous avons certainement le plus besoin aujourd’hui est de mettre en relation ces perspectives. Par exemple que la contemplation esthétique de la nature puisse informer la connaissance scientifique, et inversement. Actuellement, de nombreux artistes trouvent ainsi une profonde inspiration dans les recherches en biologie. Elles sont pour eux un point de départ à une proposition artistique et à un regard très riche sur le vivant.
MOB : J’ajouterais que l’écologie sensible est un champ scientifique en émergence, une future interdiscipline peut-être ! Elle se place notamment à la croisée des sciences cognitives, des sciences humaines et sociales et des sciences du vivant. Plusieurs travaux1 en philosophie, géosciences, biologie, anthropologie et en éco-psychologie mettent en évidence notre perte de contact avec l’expérience de la nature et du vivant. Ce déficit présente des conséquences : en vivant dans un monde que nous percevons « désanimé », nous développons un peu de la nature, nous craignons l’altérité ou nous sommes même éco-anxieux ; autant de raisons que bon nombre d’entre nous expérimentent au quotidien et qui poussent à explorer le monde vivant à travers nos sens.
Face aux conséquences du changement climatique, le « rapport au sensible » gagne timidement du terrain dans le débat public, interrogeant particulièrement nos représentations du « vivant ». Avez-vous des exemples de changements dans la perception de la relation entre l'homme et la nature ?
MOB : On peut aujourd’hui percevoir que ces représentations commencent à évoluer : la philosophie de l’environnement est une branche scientifique très dynamique ; ou encore dans le domaine du droit, certains juristes travaillent sérieusement à donner des droits aux fleuves, aux forêts ou aux océans. Il y a moins de deux ans, seuls quelques pays d’Amérique latine et d’Inde avaient reconnu une personnalité juridique à certains animaux. Depuis août 2023, c’est aussi le cas en France puisque les îles Loyauté, en Nouvelle-Calédonie, ont donné une personnalité juridique aux tortues et aux requins. Devenus sujets de droit, leurs intérêts pourront désormais être défendus au tribunal.
TLG : Il me semble que l’écologie sensible est une voix parmi d’autres. Beaucoup d’enseignants-chercheurs s’interrogent, à travers leurs activités, aux imbrications de celles-ci avec la société et l’environnement. En octobre dernier, l’INSA Lyon recevait une délégation du peuple Kogi, un peuple racine, qui tire notamment son savoir d’un sens de l’observation et d’une sensibilité exacerbée. Leurs autorités spirituelles – les mamas et les sagas, formés dès la naissance à connaître, ressentir et communiquer avec le vivant, peuvent aboutir à des connaissances qui correspondent à celles que les scientifiques ont obtenues avec la démarche scientifique. Seulement, pour les Kogis, il n’y a pas de différences entre eux et les autres éléments de la nature. Cela peut sembler étrange de prime abord, car nous avons été éduqués différemment à penser que les humains ne font pas partie de la nature et que cette dernière est « au-dehors ». Lors de leur venue, les Kogis ont offert au public de l’INSA2 de s’interroger sur notre façon de penser nos activités humaines, en imbrication avec la « mère Terre ». Bien sûr, cela a certainement résonné plus ou moins chez chacune et chacun.
Vous animerez un atelier d’initiation à l’écologie sensible dans le cadre de la conférence Archipel. En quoi consistera-t-il ?
TLG et MOB : L’atelier propose aux personnes de rencontrer un être vivant, autre qu’humain. En se laissant guider par une trame progressive, il s’agira de porter l’attention, sans préjugés, d’expérimenter et cultiver une façon de se relier à la nature. Il me semble que faire cette expérience est à la portée de tout le monde, car nous l’avons déjà fait, notamment étant enfant. C’est juste que dans nos modes de vie très affairés, nous ne prenons plus le temps. Dans un monde urbain, la nature est souvent réduite à un décor dont nous serions le héros et nous prenons très peu de temps pour porter de la considération à un être de la nature, qu’il soit un oiseau, un insecte ou même le vent ou la pluie, à nous laisser toucher. La plupart du temps, nous intellectualisons, mais nous les ressentons peu, ce qui participe à la déconnexion de nos sociétés au vivant.
En tant qu’enseignants, de quelle manière utilisez-vous l’approche sensible dans vos cours ?
TLG : Il existe, dans la pédagogie de la transition, plusieurs approches qui s’intéressent à la manière d’enseigner les enjeux socio-écologiques, en particulier leur dimension systémique. C’est un champ de recherche très actif. Certaines s’attardent sur l’aspect « sensible », tant de l’apprenant que du formateur. Je pense notamment à l’approche « tête-corps-cœur » du Campus de la transition, qui vise à inclure dans la séance de cours, habituellement très « mentale », le vécu émotionnel, esthétique ou encore le passage à l’action. C’est une approche que je propose déjà à mes élèves, en convoquant leur ressenti et leur expérience, notamment dans des cours à la carte3. C’est une approche qui semble toucher ces élèves, notamment face au sentiment de solastalgie et d’éco-anxiété qui peuvent provoquer une sorte de paralysie d’action ou de l’abattement face à l’ampleur du problème. Il ne suffit pas de leur enseigner que la « maison brûle » : certaines émotions, même désagréables, comme la peur ou la colère, sont très utiles à comprendre. Elles nous renseignent sur nos valeurs et nos aspirations profondes. Il faut savoir les accueillir pour ensuite passer à l’action ; il ne faut pas oublier que l’être humain avance à partir de la joie !
MOB : La dimension sensible permet d’être davantage présent à soi, aux autres et au monde de manière plus large. Elle nécessite de ralentir dans un rythme souvent effréné, ce qui représente d’ailleurs une des difficultés pour sa mise en place. Enfin, elle suppose d’accepter de se laisser surprendre par le contact avec sa propre expérience, ce qui n’est pas toujours facile !
[1] Dont ceux de Abram, Albrecht, Pyle, Ingold, Fisher.
[2] Les représentants du peuple kogi seront présents à l’INSA Lyon le 31 mai.
[3] Le cours à la carte « Cosmos : connaissance de soi et relation au monde » est organisé sur des pratiques d’intelligence émotionnelle, de relation à l’autre et à la nature. Le cours à la carte « Yoga » explore davantage la connaissance de soi psycho-corporelle.

Art & Culture
Prof. Turing / Pièce de théâtre
Un nouveau professeur arrive dans l'amphi Capelle pour une leçon d'histoire et de mathématiques pas comme les autres. Il s’appelle Alan Turing : “ Savez-vous qui a vaincu Adolf Hitler ? Non, ce ne sont pas les Alliés. Ce sont les mathématiques ! “
Un nouveau professeur arrive dans l'amphi Capelle pour une leçon d'histoire et de mathématiques pas comme les autres. Il s’appelle Alan Turing. Tout en tentant de rendre ses recherches compréhensibles au public, notamment sur la naissance de l’informatique et de l’Intelligence Artificielle, ce nouveau professeur va également démontrer qu’il est plus facile de casser un code secret qu’un préjugé.
Cette courte pièce mène à la rencontre d’un scientifique du passé et d’un génie oublié.
Texte Frank Gazal et Vladimir Steyaert - Mise en scène Vladimir Steyaert avec Yann Métivier
En partenariat avec : Théâtre Nouvelle Génération (TNG), Centre des Humanités, Service culturel, Théâtre-études
Réservation en ligne => https://my.weezevent.com/prof-turing-1
Información adicional
- culture@insa-lyon.fr
- https://my.weezevent.com/prof-turing-1
-
Amphi Capelle (Avenue Jean Capelle, 69100 Villeurbanne)
Palabras clave
Últimos eventos
Ateliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences
Desde 16 Hasta 18 Mayo
Formation
Former les élèves-ingénieurs à s’emparer des futurs souhaitables
L’ingénieur1 doit-il se contenter d’être le rouage d’un système qui étend les logiques d’exploitation et de marchandisation du monde ? Aujourd’hui, la représentation majeure de l’ingénieur ne peut plus être défini par le seul prisme d’une efficacité technique, posant l’Homme comme « maître et possesseur de la nature ». Désormais, comme pour beaucoup d’activités professionnelles, l’horizon de la fonction d’ingénieur se doit d’être repensé dans les limites planétaires.
Dans le cadre du chantier de l’évolution de la formation INSA, le groupe de travail « quels futurs possibles et souhaitables ? », s’est attelé à mettre en mots une vision répondant à la question suivante : comment amener les élèves-ingénieurs à retrouver la possibilité d’un futur souhaitable, quand le progrès scientifique et technique se heurte déjà aux limites physiques et humaines de notre planète ? À la convergence de la quête de sens des étudiants et celle d’un établissement dont la raison d’être est de former des individus conscients de leurs choix, il est nécessaire de construire une nouvelle dialectique et de nouveaux récits. Entretien avec quatre enseignants du groupe de travail.
L’ingénieur : un rouage dans un système
À travers son activité professionnelle, l’ingénieur alimente la construction et le développement de systèmes techniques qui s’imposent aux sociétés et aux écosystèmes. L’héritage de Descartes, par lequel l’Humain s’est posé en maître de son environnement, continue d’opposer l’Homme et la nature. L’urgence climatique et la quête de sens des individus tendent à remettre en question ce principe philosophique. « Dans notre système de société, basé sur l’exploitation et la marchandisation, il y a une difficulté croissante à contrôler le phénomène technique. Quand l’optimisation, la performance ou la production sont réduits à leur seule dimension technique, celui-ci peut souvent sentir lui échapper les conséquences de ses actions », introduit Romain Colon de Carvajal, enseignant en génie mécanique. Pourtant la technique, par les créations qu’elle rend possible, est un moyen privilégié de penser l’action de l’Homme sur le monde. « En réalité, ça n’est pas qu’un débat technique et scientifique. Admettre que l’innovation puisse répondre aux grands défis et aux crises contemporaines force à poser des limites qui ne sont pas seulement techniques et physiques. L’innovation, qui ne peut plus être envisagée liée à une société de consommation débridée, pose des questions très politiques. Quel type de société souhaite-t-on réaliser ? Quelles valeurs veut-on véhiculer à travers la technique ? »
Des futurs possibles et souhaitables
« Qui sommes-nous ? Que peut-il advenir ? Que pouvons-nous faire ? Que devons-nous faire ? ». Ces quatre questions empruntées à la démarche Prospective de Gaston Berger, ont constitué l’ossature de la réflexion des membres du groupe de travail. Elles soulignent également l’aspect démocratique et politique du débat. Si le fondateur de l’école entendait former « des philosophes en action » en 1957, quelle école imaginerait-il aujourd’hui, pour faire agir l’ingénieur dans un espace sûr et juste pour l’humanité ? « Gaston Berger parlait de relations sociales, d’identité et de sens. En ouvrant la formation technique aux Humanités2, il tentait d’introduire une capacité politique chez l’ingénieur afin de penser les conséquences de ses actions. Aujourd’hui, il est nécessaire d’intégrer à cette réflexion, les problématiques se rapportant à l’anthropocène : les limites de la Terre sont des phénomènes physiques qui amènent à nous questionner sur le sens de l’Humanité », poursuit Marie-Pierre Escudié, enseignante en sciences humaines et sociales. Alors à quels futurs possibles et souhaitables l’ingénieur doit-il se vouer ? La question, presque oratoire, soutient une obligation de démocratie. « Il ne s’agit pas de penser le futur à la place des élèves-ingénieurs, mais bien de les mettre en capacité de le construire par eux-mêmes. Pour cela, il nous faut instaurer un double mouvement, individuel et collectif. Notre rôle est de leur permettre de trouver un espace de responsabilité où ils se sentent en capacité d’agir. »
Une éthique renouvelée de l’innovation pour l’ingénieur
Si l’un des rôles premiers de l’ingénieur consiste à éclairer les choix de société par leurs connaissances techniques et en sciences humaines et sociales, l’enjeu pédagogique d’une telle formation est de donner les clés pour innover en conscience. « Il faut cultiver l’optimisme, car il permet de dépasser l’angoisse des défis qui se dressent devant nous et sert de catalyseur pour apporter des solutions innovantes. L’ingénieur en tant que philosophe en action doit être capable d’éviter la production de fausses bonnes idées, qui tendent à invisibiliser les problèmes ou conduisent à des effets rebonds », prévient Joëlle Forest, maîtresse de conférences en épistémologie et histoire des techniques à l’INSA Lyon. « Qu’il adopte une posture de médiateur ou de diplomate-polyglotte, l’ingénieur pour réarticuler l’innovation à un dessin moral pour la société devra s’interroger sur les valeurs que véhiculent ses innovations : vont-elles vers plus ou moins de liberté, d’égalité, d’autonomie, de sécurité ou de convivialité ? »
Prendre le chemin de l’éthique et de l’action collective
Pour amener les futurs ingénieurs à développer leur espace de responsabilité, les membres du groupe de travail ont ainsi synthétisé plusieurs objectifs d’apprentissages fondamentaux. « Notre réflexion et le livrable qui en a découlé sont majoritairement une synthèse des pratiques existantes au sein des départements et au centre des Humanités. Nous avons surtout travaillé à donner une meilleure visibilité des pratiques qui n’étaient pas nécessairement communiquées ni partagées au sein de la communauté et qui ont pourtant beaucoup à apporter à l’évolution de la formation d’ingénieur INSA », ajoute Thomas Le Guennic, professeur agrégé de sciences économiques et sociales à l’INSA Lyon. « Sur le principe, il s’agit d’aider les élèves à démêler les idéologies, à décoder les relations d’interdépendances et comprendre la nécessité d’adapter les moyens aux finalités et les besoins aux ressources. Aussi, au titre de citoyen, futur salarié ou chef d’entreprise, avant de pouvoir s’engager dans l’action collective et cultiver un futur, il est nécessaire que chaque élève puisse connaître les valeurs qui l’animent individuellement, avant d’accepter les chemins de traverse et les échecs comme faisant partie du changement. »
Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année. Elle est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :
▪️ Anthropocène et climat
▪️ Énergie
▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact
▪️ Enjeux du vivant
▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?
▪️ Calcul numérique
▪️ Sciences des données et intelligence artificielle
▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique
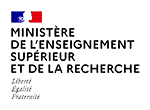
« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »
[1] Le masculin est utilisé à titre épicène et sans aucune discrimination de genre.
[2] La formation en humanités a pour objectif de doter ses élèves d’un solide bagage de compétences transversales, donner des clés de compréhension et des leviers d’action dans un monde complexe, en affirmant une vision socialement et écologiquement responsable.

Formation
« Le doute n’est pas un obstacle à la démarche scientifique mais l’une de ses composantes »
Avez-vous lu votre horoscope aujourd’hui ? Si oui, il y a fort à parier qu’il a tapé dans le mille en faisant écho à votre quotidien ou référence à des situations en train d’être vécues. Même si « vous n'y croyez pas », vous avez certainement parcouru le descriptif de l’horoscope jusqu’au bout, en y relevant des éléments qui, « objectivement », correspondent à votre personnalité. Parfois même, il a semblé prédire des choses vraies, qui se produisent effectivement. Votre constatation personnelle suffit-elle à constituer une preuve de la validité scientifique de l’astrologie ? L’astrologie ne partage-t-elle pas son ciel avec l’astronomie, souvent considérée comme la plus ancienne des sciences ?
 C’est avec cet exemple que Carine Goutaland, enseignante de lettres et directrice du centre des Humanités, introduit l’un de ses domaines de prédilection : la zététique. « L’art de douter1 » se propose de développer l’esprit critique pour faire la différence entre « ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance ». Une démarche nécessaire pour tous, ingénieurs, chercheurs et citoyens, mais qui nécessite curiosité et humilité devant la faillibilité de la raison humaine.
C’est avec cet exemple que Carine Goutaland, enseignante de lettres et directrice du centre des Humanités, introduit l’un de ses domaines de prédilection : la zététique. « L’art de douter1 » se propose de développer l’esprit critique pour faire la différence entre « ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance ». Une démarche nécessaire pour tous, ingénieurs, chercheurs et citoyens, mais qui nécessite curiosité et humilité devant la faillibilité de la raison humaine.
Plusieurs approches existent pour développer l’esprit critique et refuser la pensée dogmatique. Celle qui vous passionne s’appelle la zététique, que l’on définit souvent comme « un art du doute ». De quoi parle-t-on exactement ?
Parfois appelée aussi « autodéfense intellectuelle », c’est une démarche qui utilise le doute méthodique comme moyen de développer son esprit critique : lorsqu'on est mis en présence d'un phénomène ou d'une information extraordinaire, on commence par suspendre son jugement puis on les confronte à l'état actuel des connaissances scientifiques, on vérifie la fiabilité des sources, etc. Créée dans sa forme moderne par le biophysicien Henri Broch dans les années 1980, la zététique s’est surtout intéressée au paranormal (télépathie, spiritisme…) qui est un champ d’étude privilégié car il implique souvent une lourde charge affective pour les individus, et est donc particulièrement propice aux biais cognitifs. Aujourd’hui, la zététique est beaucoup associée au questionnement sur l'influence des médias et des réseaux sociaux, notamment sur la question des infox, néanmoins elle est utile dans d'autres domaines (médecines dites "alternatives", parapsychologie…). Mais attention, il ne s’agit pas de douter de tout, ni de douter tout le temps (c'est d'ailleurs le propre des théories du complot), mais de douter avec méthode. Il s’agit de déconstruire les mécanismes de la pensée, d'identifier les biais de perception ou d'interprétation, de déconstruire les discours manipulateurs, de prendre conscience du rôle du hasard…
On comprend l’utilité citoyenne de la démarche, mais quels bénéfices pour les ingénieurs et les scientifiques ?
La démarche critique doit être mise en œuvre dans la réalisation d’expériences, dans la réflexion sur l’élaboration et l’amélioration de protocoles scientifiques. Par exemple, pour qu’une expérimentation soit valide, le protocole scientifique doit prendre en compte les incertitudes liées à la mesure et à son interprétation pour en tirer des conclusions qui ne soient pas biaisées. En fait, la zététique oblige à ne pas voir uniquement ce que l’on voudrait voir.
C’est donc une démarche qui questionne directement la responsabilité sociale de l’ingénieur et du scientifique ?
Exactement. Le scientifique ou l’ingénieur sont des humains comme les autres, avec leurs croyances et leurs opinions. Son devoir est de ne pas se laisser guider par celles-ci dans ses travaux scientifiques. La zététique interpelle aussi le rôle de médiateur du scientifique qui doit être capable d’exprimer clairement ce que peut la science et ce qu’elle ne peut pas. La crise du Covid l’a illustré : le discours scientifique n’est pas une opinion parmi d’autres. À l’ère des « fast news », l'idée d'obtenir une réponse rapide à ses questions est séduisante, mais la construction d'un consensus scientifique passe par de nombreuses étapes et exige du temps. Nous avons tous - scientifiques, citoyens, médias -, une responsabilité dans la régulation de l'information : c'est un enjeu d’émancipation et de démocratie, comme l'a très bien montré le sociologue Gérald Bronner2.
Concrètement, comment s’initie-t-on à la zététique ? Peut-on prendre des cours ?
« L'esprit critique » correspond à un ensemble d’outils que l'on peut acquérir et développer par l'éducation. C’est quelque chose qui se travaille, avec du temps et de la méthode. Si la formation scientifique, dans le domaine des sciences dites dures ou dans celui des sciences humaines et sociales, permet d'acquérir des connaissances et des savoirs-faire qui aident à se prémunir contre les biais cognitifs, il serait illusoire de penser qu'un haut niveau de connaissances scientifiques est toujours synonyme d'esprit critique3!
Aiguiser son esprit critique est une formation tout au long de la vie et il n’est jamais inutile d’en parler, de douter pour favoriser une compréhension systémique du monde qui nous entoure.
Il y a plusieurs années, le centre des Humanités proposait un cours optionnel de zététique aux élèves-ingénieurs. Dans notre société de plus en plus « infobèse », ce cours ne mériterait-il pas de renaître ?
Il est vrai que la zététique peut être une boussole pour avancer dans la jungle de la surinformation. Les réseaux sociaux ont décuplé notre tendance à préférer nos biais de confirmation, cette tendance à sélectionner les données qui nous confortent dans nos croyances.
J'ai en effet coordonné avec Stanislas Antczak, enseignant de physique, un cours optionnel de zététique entre 2007 et 2014. On pourrait envisager de réintroduire ce type d'enseignement dans le cadre du chantier d'évolution de la formation, par exemple dans l'offre de cours à la carte de SHS proposée par le centre des humanités. Mais quoi qu'il en soit, on aborde aussi les outils de la zététique dans d'autres enseignements transversaux existants comme les modules « sciences-humanité » et les « parcours pluridisciplinaires d’initiation à l’ingénierie », les P2i4.
La méthode zététique est donc adossée à la méthode scientifique. Peut-on paradoxalement douter de la vérité scientifique ? « Faut-il croire la science », comme interroge Étienne Klein ?
La science n’est pas parfaite ! D’ailleurs, elle n’a jamais eu la prétention de l’être. Il existe des erreurs scientifiques, c'est même le moteur de la connaissance scientifique qui progresse par remises en cause et ajustements successifs. Et la science n'a pas réponse à tout. Celui ou celle qui cherche une vérité scientifique doit prendre le temps de questionner ses croyances, que l’on croit souvent très légitimes tant elles sont ancrées très profondément en nous. Comme le dit Etienne Klein à l'occasion de la parution de son essai « Le Goût du vrai », il faut « aimer la vérité, oui, mais pas déclarer vraies les idées que nous aimons5 ». C’est une démarche qui demande beaucoup d’humilité et un certain courage, surtout pour accepter la contradiction ou l’absence de vérité. Le doute n’est pas un obstacle à la démarche scientifique mais l’une de ses composantes.
----------
[1] « L'art du doute ou comment s'affranchir du prêt-à-penser », Henri Broch.
[2] La Démocratie des crédules, 2013.
[3] Gérald Bronner, "Pourquoi l'éducation n'empêche pas les croyances".
[4] Les P2i sont proposés aux étudiants de 2e année et permettent de s'initier aux projets d’ingénierie selon différentes thématiques.
[5] Étienne Klein: "Aimer la vérité, oui, mais pas déclarer vraies les idées que nous aimons".

Formation
macSUP: le processus de création comme expérience
Il résulte d’une sorte d’alchimie difficile à expliquer avant de l’avoir vécu : le processus de création est un mécanisme cérébral et émotionnel loin d’être facile à résumer. Certains spécialistes s’y sont risqués, comme le psychologue Graham Wallas qui a tenté, au 19e siècle, d’en dégager quatre grandes étapes. Cependant, il semblerait que la meilleure solution pour comprendre l’essence même du processus de création soit d’en faire soi-même l’expérience.
C’est le sujet qui occupe un groupe d’étudiants et doctorants de l’INSA Lyon dans le cadre du module pédagogique « macSUP ». En collaboration avec des artistes, plusieurs établissements universitaires lyonnais et le Musée d’Art Contemporain de Lyon, ils exploreront des territoires inconnus, jonglant avec des concepts dont leurs esprits scientifiques ne sont peut-être pas coutumiers. Entre hasard et liberté, les étudiants prendront conscience d’une chose : parfois, ce n’est pas la destination qui compte mais le voyage. Explications avec Fabrice Valois, enseignant-chercheur au département télécommunications et référent du module pour les Humanités.
Avec l’art comme excuse, cinq étudiants des départements génie mécanique, informatique et télécommunications consacreront plusieurs jeudis après-midi des six prochains mois à cheminer. Au sein d’un groupe composé d’étudiants lyonnais en sciences dures et sciences humaines, c’est accompagné par une artiste contemporaine que chacun devra apporter sa pierre à l’édifice à quelque chose qui leur semble encore nébuleux. « D’un point de vue pédagogique, les étudiants sont habitués à l’expérimentation à travers les cours de travaux pratiques classiques qui les conduisent vers un but technique précis. Ces expériences qui sont finalement très formalisées, voire scénarisées, ne laissent pas toujours de place pour construire son propre cheminement. Avec macSUP, l’art et la thématique proposée par l’artiste sont des prétextes pour éprouver le processus de création et vivre les difficultés qui lui sont liées. Ici, ça n’est pas le résultat qui compte mais le chemin qu’ils emprunteront », explique Fabrice Valois, enseignant-chercheur et référent du programme au sein de l’INSA Lyon.

Groupe de travail accompagné par Linda Sanchez (macSUP#3)
Pour la 5e saison du programme, l’artiste contemporaine Marianne Mispelaëre a proposé aux étudiants d’explorer la thématique du langage. « Pour amorcer la rencontre avec le groupe, elle a posé une question didactique. Comment une langue, innocente au départ, peut-elle être détournée et exploitée à des fins politiques ? Pour guider les étudiants dans la recherche, elle fixe le point de départ avec les travaux de Victor Klemperer, philosophe allemand, qui a décrypté pendant la Seconde Guerre Mondiale la « novlangue » utilisée par le nazisme. Pour l’instant, nous n’avons aucune idée de ce que pourra être la réplique artistique des élèves mais c’est ici que tout commence », ajoute Fabrice Valois.
Durant les six prochains mois, les participants tenteront de formaliser une réponse tangible à la question. Ils passeront certainement par différentes phases : de l’excitation nourrie par les idées qui affluent, au temps de flottement de l’esprit qui malmène les estimes de soi jusqu’à la joie éprouvée à la livraison finale de l’idée prenant forme. « Les ressentis à chacune des étapes de la création d’une recherche artistique sont très différentes de ce que l’on peut rencontrer sur un objectif technique d’un cours de TP. Pourtant, ce sont des émotions qu’ils peuvent ressentir plus tard, dans leur vie d’ingénieur. Mais pour ça, vous ne pouvez pas faire de cours là-dessus ; nous avons choisi d’offrir la possibilité de le faire vivre. »
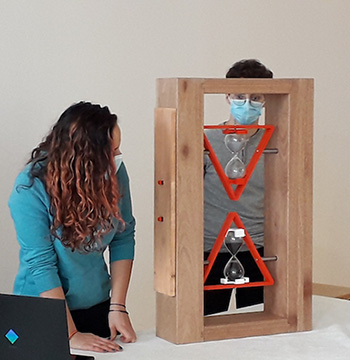
Séance de travail avec Chloé Serre (macSUP#4)
L’œuvre finale, si elle n’est pas une fin en soi, donnera lieu à un exercice de médiation. Au cours du premier week-end d’avril 2022, les étudiants expliqueront leur démarche artistique auprès du public du MAC de Lyon, une méthode efficace pour les préparer à leur futur rôle de professionnel. « L’ingénieur humaniste ne fait pas de la technique pour faire de la technique, mais pour contribuer à une meilleure société. L’un de ses atouts majeurs, c’est de pouvoir expliquer la technique, la rendre intelligible au plus grand nombre, expliquer les progrès proposés pour mieux les rendre accessible par tous. L’exercice de médiation est un élément important dans une démarche d’ingénieur, comme il le sera lors du week-end de restitution. Ici, de la même façon, l’explication donnée devra rendre lisible au public, un sujet difficile d’accès », ajoute l’enseignant.
« Libérez-vous ! Autorisez-vous ! », assènent les intervenants artistes aux étudiants de macSUP. Cette injonction, c’est aussi ce qui a poussé Fabrice Valois à vouloir explorer la question. « Créer, c’est prendre des risques et accepter de se laisser désinhiber. En tant que chercheur, je me suis longtemps questionné sur ce qui nous limitait dans nos innovations. En accompagnant ce module, j’ai découvert que la principale entrave à la liberté de création était souvent imposée par notre propre esprit. Lorsque vous innovez scientifiquement, nos propres limites peuvent vous rattraper plus souvent qu’on ne le pense, nous empêchant d’explorer d’autres champs que l’on aurait laissés de côté. C’est à ça que sert macSUP aussi, je crois : permettre aux participants d’oser se laisser aller au hasard et à la liberté. »

Sur le chemin des Poudingues avec Jan Kopp (macSUP#2)
 Initié en 2017 par le Musée d'Art Contemporain de Lyon (MAC) avec l’Université Lyon 1, l'ENS Lyon et l’École Centrale de Lyon, macSUP est un programme universitaire et artistique, invitant à vivre de l’intérieur l’art contemporain et ses protocoles créatifs. MacSUP propose aux étudiants de découvrir l’art contemporain à travers une pédagogie innovante. Étudiants, enseignants-chercheurs, artistes, professionnels de l’art expérimentent ensemble la coopération, sous de multiples aspects.
Initié en 2017 par le Musée d'Art Contemporain de Lyon (MAC) avec l’Université Lyon 1, l'ENS Lyon et l’École Centrale de Lyon, macSUP est un programme universitaire et artistique, invitant à vivre de l’intérieur l’art contemporain et ses protocoles créatifs. MacSUP propose aux étudiants de découvrir l’art contemporain à travers une pédagogie innovante. Étudiants, enseignants-chercheurs, artistes, professionnels de l’art expérimentent ensemble la coopération, sous de multiples aspects. Dans le cadre de la formation en humanités à l’INSA Lyon, ce module donne droit à l’équivalent de 2 crédits ECTS.

Institutionnel
Conférence inaugurale de la Chaire Alumni / INSA Lyon
« Ingénieur INSA, philosophe en action. Penser et agir de manière responsable »
À l’heure où la crise environnementale requiert un changement sans précédent de nos modèles de développement et de nos modes de vie, la chaire Alumni / INSA Lyon convie la communauté insalienne à un temps de réflexion sur la responsabilité de l’ingénieur.e dans la transition écologique.
Quels sont les défis auxquels les ingénieur.e.s de demain devront faire face ?
Quel sera leur rôle dans une société et un système Terre profondément marqués par une technique dominatrice de la nature et par le mythe, aujourd’hui ébranlé, d’une croissance illimitée ?
Quels savoir-être et quelles compétences leur permettront de devenir des acteurs responsables de la transition ?
Par la participation exceptionnelle du philosophe Dominique Bourg et un temps d’échange rythmé par une table ronde, nous nous demanderons vers quels types de société « transiter » et comment l’ingénieur.e pourrait participer activement à la transition écologique.
Información adicional
- https://communication.insa-lyon.fr/20210921_chaire-alumni/
-
En présentiel à la Rotonde - 20 avenue des arts - Villeurbanne et en distanciel
Palabras clave
Últimos eventos
Ateliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences
Desde 16 Hasta 18 Mayo
INSA Lyon
INSA engineer, philosopher in action
Le rôle de l’ingénieur et son devenir sont au coeur d’une réflexion engagée à l’INSA Lyon avec tout son écosystème. Co-directeur scientifique de la chaire « Ingénieur.e INSA, philosophe en action. Penser et agir de manière responsable », Michel Faucheux, ancien directeur du centre des humanités de l’INSA Lyon, homme de lettres et d'esprit, apporte son éclairage sur le contexte d’émergence de ce travail de recherche, utile pour les ingénieurs et le monde de demain.
La création de la chaire « Ingénieur.e INSA, philosophe en action. Penser et agir de manière responsable » s’inscrit dans le droit fil de l’héritage du philosophe Gaston Berger, l’un des fondateurs de l’INSA Lyon. Si le projet pédagogique de former un ingénieur1 en prise directe avec la société et ses enjeux technologiques, sociaux, économiques, reste d’actualité, il n’en demeure pas moins que les temps ont changé et que nous ne sommes plus dans le contexte des Trente Glorieuses.
La chaire vise, en effet, à actualiser et repenser le modèle de l’ingénieur INSA tout en demeurant fidèle à un héritage conférant à notre école une identité historique, philosophique, pédagogique forte qui est son originalité dans le champ des écoles d’ingénieurs françaises. Dans une conférence du 8 mars 1955, Gaston Berger qualifiait le chef d’entreprise de « philosophe en action », « ayant pris conscience non seulement de la complexité des problèmes, mais aussi des devoirs qui s’imposent à lui et lui confèrent une fonction morale ». Plus que jamais, pour relever les défis inédits qui s’imposent à nous, l’ingénieur, engagé dans des « entreprises » techniques et, souvent, chef d’entreprise lui-même, doit assumer le rôle d’un « philosophe en action », guidé par un amour de la connaissance - technologique - et de la sagesse mêlées qui oriente son action et le rend capable de reconstruire un monde plus humain.
Car la tâche qui s’impose à nous est d’ampleur, bien différente de celle de l’ingénieur formé dans les années 60, élément moteur d’une croissance économique et d’un bien-être profitables à une France ébranlée et appauvrie par les années de guerre.
Nous sommes entrés, en effet, depuis deux décennies, dans un monde nouveau produit par une révolution technologique accélérée et radicale, que certains qualifient de « disruption ». Ce monde artificialisé, numérisé, interconnecté, virtualisé, globalisé, multiculturel bouleverse la relation de l’être humain à lui-même tout comme à la société, à la nature et aux autres êtres vivants. Les oppositions anciennes qui nous ancraient dans une relation stable au monde se trouvent pulvérisées : le vrai et le faux, le réel et le virtuel/l’artificiel, l’Homme et la machine, moi et les autres, l’ici et l’ailleurs, le dedans et le dehors… Tandis que nos possibilités d’action se trouvent augmentées et décuplées.
Si « le monde d’avant » était stable, solide, fondé sur un socle de pratiques, de certitudes et de représentations assurées, ce monde nouveau où l’on peut surfer de connaissances en connaissances et où circulent à toute vitesse les informations, est un monde « liquide », fluctuant, tempétueux, qui se caractérise par le bouillonnement, le désordre, la crise et l’imprévu.
Voilà bien ce que nous vivons actuellement : une pandémie qui a immobilisé une grande partie de la planète et s’articule à une crise écologique majeure qui, provoquée par la destruction accélérée des espèces et le réchauffement climatique, met en péril l’humanité. Le phénomène de crise n’est plus, aujourd’hui, épisodique : il est devenu structurel, l’élément constituant de notre monde, revêtant plusieurs dimensions liées entre elles : écologique, sociale, sociétale, économique et politique.
Dans ce contexte nouveau, tel est le but de la chaire : aider à former un ingénieur,
« philosophe en action », qui sache non seulement affronter les crises et les tempêtes mais qui, créatif et ingénieux, traversant les savoirs pour penser la technique alors même que la cartographie des connaissances se renouvelle, nous mène aussi à bon port : vers un ordre du monde divers, viable et durable qu’il aura contribué à construire. Ce n’est pas là simple utopie car il y a urgence à s’acheminer vers un système économico-social qui reconnaisse la finitude des ressources terrestres et mette la technologie, débarrassée des rêves de toute puissance et de profit illimité, au service de l’humanité, qui édifie une nouvelle alliance entre l’être humain et la nature mais aussi une solidarité entre êtres humains, cultures et sociétés. Qui intègre enfin le souci esthétique dans le quotidien.
Jamais il n’y eut pareil défi à relever dans l’histoire de l’humanité car, pour la première fois, il est question de la survie de notre espèce et de la viabilité des constructions humaines. A l’issue de cette longue période de confinement, « le temps est venu », comme beaucoup disent désormais, de rebâtir un avenir. Il y eut des bâtisseurs de monuments de toutes sortes et de grands projets politiques et sociaux… Il y a désormais nécessité de bâtisseurs d’avenir. Et nous pensons que « l’ingénieur INSA, philosophe en action », pour être fidèle à son histoire, doit être l’un de ces bâtisseurs d’avenir, fait de technologie et de sagesse mêlées, construit sur la résistance à l’injustice, l’inégalité et l’inacceptable.
Mais l’avenir ne s’édifie pas sans l’expérience de celles et ceux qui sont déjà engagés dans l’action. Voilà pourquoi la chaire, ouverte à la communauté INSA dont elle est l’émanation, grâce à une démarche de co-construction, va s’appuyer sur l’expérience concrète des Alumni, pour analyser comment il est possible de déployer un mode d’action responsable dans l’entreprise et la société et développer une éthique et une « sagesse » quotidienne de l’action profitables à tous. Elle reposera sur la force du témoignage, la restitution et l’analyse des débats que suscitent, par exemple, décision, action et réalisation.
Il n’y a de grands projets que ceux portés par une mémoire et une vision partagées. Mais il y a aussi des moments où la tempête qui emporte l’Histoire peut se métamorphoser en souffle vers l’avenir. Pris entre une révolution technologique majeure et une crise écologique radicale, nous vivons un moment qui impose de ne pas détourner le regard de « notre maison qui brûle » mais de faire œuvre de résistance et de combattre les logiques destructrices qui menacent la construction d’une organisation durable du monde.
Il ne faut pas avoir peur des projets ambitieux. La création du modèle alternatif de l’INSA fut elle-même un projet ambitieux. Voilà pourquoi, en définitive, je me demande si le projet de cette chaire se limite seulement - ce qui est déjà beaucoup ! - à accompagner la formation d’un « ingénieur philosophe en action », porteur de valeurs humanistes et responsables. Peut-être est-il bien plus encore, en effet : aider, en ce début de XXIe siècle, à la réinvention de l’humanisme dont l’ingénieur INSA devrait être l’un des porteurs.
Au XVIe siècle, aidés par l’invention technique de l’imprimerie, poètes, philosophes, savants revenant aux textes de l’Antiquité grecque et latine, inventèrent un « Humanisme » qui présida à la période qualifiée plus tard de « Renaissance ». L’ingénieur INSA, devenu « philosophe en action », mariant les savoirs, pensant la technique pour mieux œuvrer avec « sagesse » et définir, dans un univers artificialisé, un idéal de conduite humaine, pourrait contribuer à la réinvention d’un humanisme devenu notre horizon et notre nécessité. Faut-il même ajouter qu’il y a des lieux propices à une telle réinvention et qu’au XVIe siècle, Lyon fut l’un des grands foyers de l’Humanisme ?
Gaston Berger, dans la conférence déjà citée, notait que le chef d’entreprise « philosophe en action », « ne façonne pas simplement des objets », mais « construit le destin des hommes ». Précisément, je crois que l’ingénieur INSA d’aujourd’hui et de demain, « philosophe en action », doit avoir pour fonction non pas seulement d’offrir un destin aux « hommes » mais d’œuvrer pour qu’ils continuent à en avoir un.
La tâche est difficile et exaltante mais si la chaire « Ingénieur.e INSA, philosophe en action. Penser et agir de manière responsable », à sa juste place, peut y aider, alors, elle aura trouvé sa pleine utilité.
Il est composé de membres issus du Centre Gaston Berger, du Centre des Humanités et de l’association Alumni INSA Lyon.
▪️ Francesca Rebasti, chargée de recherche, coordinatrice et co-directrice scientifique de la chaire. Docteure en philosophie, elle est spécialiste de l’histoire des doctrines morales et politiques.
▪️ Michel Faucheux, co-directeur scientifique de la chaire. Docteur d'État es Lettres, historien des idées, enseignant-chercheur, écrivain, il a co-dirigé une thèse de doctorat sur le rôle accordé par Gaston Berger aux sciences humaines dans la formation de l’ingénieur.
▪️ Marie-Pierre Escudié, co-directrice scientifique de la chaire, est enseignante-chercheuse au centre des humanités et au centre Gaston Berger de l’INSA Lyon, et travaille sur la thématique de la responsabilité sociale de l’ingénieur.
▪️ Patrice Heyde, vice-président de l’association Alumni INSA Lyon, co-animateur de la chaire.
▪️ Sonia Béchet, directrice adjointe du centre Gaston Berger de l’INSA Lyon, est docteur en psychologie cognitive.
▪️ Carole Plossu, directrice du centre Gaston Berger depuis sa création en septembre 2015.
▪️ Nicolas Freud, directeur du centre des humanités, chargé du pilotage du projet d’évolution de la formation de l’INSA Lyon.
▪️ Carine Goutaland, directrice adjointe du centre des humanités, en charge des sciences humaines et sociales.
[1] L’emploi du genre masculin dans ce document est utilisé à titre épicène et ceci dans un souci d’alléger la lecture du texte sans discrimination de genre.

Formation
Quand un mémoire d’études provoque la sortie d’un livre
Vincent Falconieri, étudiant en 5e année du département informatique de l’INSA Lyon, est l’auteur de « Saisir l'essentiel des Mind-Maps : Efficacité et enseignement », un ouvrage publié à la suite de son Projet Personnel en Humanités (PPH). Retour sur l’histoire de ce livre.
Le PPH, une spécificité de la formation à l’INSA Lyon
Depuis 23 ans, le PPH propose aux élèves-ingénieurs de s’interroger sur un sujet qui les concerne personnellement. Concrètement, il s’agit d’un travail de réflexion personnelle en Sciences Humaines et Sociales, mené à n’importe quel moment de la formation du second cycle. Le fond, tout comme la forme, dépendent des élèves et de leurs envies. Les PPH se veulent être des productions inédites et créatives, permettant à chacun de s’exprimer sur un sujet de son choix. En effet, l’INSA ne forme pas uniquement des experts scientifiques et techniques, mais également des ingénieurs capables de réfléchir sur des questions de société. À l’INSA, réflexions sociologiques et scientifiques sont liées et le dialogue est favorisé tout au long de la formation.
Du mind-map au PPH…
En 2016, au début de sa troisième année, Vincent réfléchit à une problématique qu’il souhaite traiter dans le cadre de son PPH : « quand je suis arrivé en première année à l’INSA Lyon, je n’avais pas de méthodes de travail. Lorsque je voyais mes classeurs énormes, j’étais découragé à l’idée de devoir les apprendre. Je ne savais pas par quoi commencer et je perdais énormément de temps à faire des fiches… J’ai assisté à une conférence de méthodologie d’apprentissage de la psychologue et sociologue Hélène Weber, qui nous a présenté succinctement les mind-maps ».
Les mind-maps sont un ensemble de schémas, dessins, flèches et textes qui modélisent des données. L’objectif est d’avoir des données cartographiées ou les liens sont mis en avant. « J’ai tout de suite accroché avec cette technique. En une seule feuille, je pouvais synthétiser l’ensemble de mes cours pour réviser mon partiel ! Je les laissais en permanence sur mon mur pour pouvoir les consulter autant de fois que possible et les assimiler au mieux. J’ai donc eu envie de rédiger mon PPH sur ce sujet qui me tiens particulièrement à cœur », explique Vincent.

Il se tourne donc vers Laure Raffaëlly-Veslin, fervente utilisatrice de mind-maps et professeure de Physique au département Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur (FIMI). Elle devient sa tutrice de PPH et l’épaule pendant toute la durée de ses travaux. Il réalise sa soutenance de PPH en janvier 2017 et obtient la note maximale.

…et du PPH à la publication d’un livre
Le PPH doit permettre à l’élève de confronter sa vision du sujet traité à d’autres personnes. Il choisit donc de rencontrer Hélène Weber. « Nous avons pu comparer nos méthodes de travail et nos échanges m’ont énormément apporté. J’ai porté une réflexion sur ma façon de travailler. Suite à nos échanges, elle m’a par ailleurs proposée de rédiger un article sur son blog en décembre 2018 pour expliquer ma démarche », souligne Vincent.
En parallèle, il diffuse un questionnaire à ses camarades insaliens pour comprendre les méthodes de travail de chacun. Son questionnaire met en évidence que les étudiants passent énormément de temps à réviser sans forcément avoir de résultats. Ce postulat a donné à Vincent l’envie de transmettre son savoir.
« Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux mind-maps, aucun ouvrage n’expliquait comment créer concrètement un mind-map. Je me suis donc inventé ma propre méthode que j’ai eu envie de partager. Pour cela, j’ai donné des formations en lien avec la cellule d’accompagnement pédagogique de l’INSA et j’ai animé des ateliers. En janvier 2018, j’ai publié mon propre livre en version numérique sur Kindle et je propose depuis septembre 2018 une version papier. Ce livre, accessible à tous, permet à chacun de réaliser des mind-maps suivant ses besoins : animation de brainstorming, gestion de crises, résumés de livres, structurer une réunion, préparer des présentations… Les usages sont tellement variés ! »
Et pourquoi pas un logiciel de conception ?
Suite à la publication de son livre, Vincent a eu des retours très positifs des lecteurs, certains allant même jusqu'à lui envoyer leurs mind-maps en photo ! « Maintenant que j’ai conscience que mon livre a rempli pleinement son objectif, je pense pousser encore sa commercialisation, et pourquoi pas, avec un éditeur historique. Étant étudiant en informatique, j’aimerais m’associer avec des amis pour proposer un logiciel qui créerait des mind-maps numériquement », évoque Vincent.
En attendant, Vincent a cartographié l’ensemble de sa formation sur des mind-maps, dont la plus grande mesure 4m60 par 80cm : « au lieu d’avoir des dizaines de classeurs, j’ai un tote bag bien rempli qui résume mes cinq années à l’INSA Lyon ! »


Formation
Études ou passion : pourquoi choisir ?
« Je pensais avoir à choisir entre la musique et mes études d’ingénieur en entrant en études supérieures, mais j’ai vécu à l’INSA plus d’expériences musicales que je n’aurais pu l’imaginer durant toute ma scolarité », annonce Hugo Rinville, l’un des cent vingt-cinq « zikets » de l’INSA Lyon.
Les « zikets » sont les étudiants-musiciens de l’INSA Lyon, une spécificité insalienne d’excellence, qui permet aux élèves-ingénieurs non seulement de poursuivre leur pratique musicale en études supérieures, mais surtout de performer dans leurs deux domaines de prédilection, la science et la musique. C’est l’une des filières artistiques les plus prisées, et, preuve s’il en fallait une, le stand de présentation de la formation a été pris d’assaut lors de la dernière Journée Portes Ouvertes de l’établissement. Il s’agit d’une formation complète et exigeante dont les cours d’instruments et de théorie sont dirigés par des professeurs de haut niveau, exerçant en conservatoire, à l’Orchestre National de Lyon ou à l’Opéra de Lyon.
Pour accéder à ce programme pédagogique, qui peut déboucher sur un Diplôme d’établissement Arts-Études depuis 2016, les étudiants doivent attester d’au moins cinq années de bagage musical entre pratique instrumentale et solfège (en conservatoire, école de musique, association ou cours particuliers). Chaque année, Arnaud Sandel, responsable de la formation, reçoit plus d’une centaine de candidatures composées d’un CV musical, d’une lettre de motivation mais aussi de certificats, diplômes et vidéos : « le niveau et la motivation sont les deux critères auxquels nous portons le plus d’attention. Nous accueillons tous types d’instruments », précise Arnaud Sandel.

Née en 1984 sous l’impulsion de Raymond Hamelin1, la filière permet aux étudiants de vivre leur passion. Hugo Rinville est un étudiant de deuxième année inscrit en section Arts-Études. « Je fais du piano depuis que je suis petit et j’ai suivi des cours de classique jusqu’à la terminale, je m’attendais à devoir mettre la musique de côté en études supérieures et pourtant en moins de deux ans, j’ai vécu à l’INSA plus d’expériences musicales que je n’aurais pu l’imaginer durant toute ma scolarité ». Comme ses camarades de musique-études, il profite quotidiennement des huit salles équipées d’instruments et de matériel musical. « Depuis que je suis ici, pas une semaine ne s’est écoulée sans que je ne sois allé jouer dans les studios mis à disposition et accessibles à n’importe quel moment de la journée », explique Hugo.

À travers cette filière, les étudiants développent compétences et aptitudes qui seront utiles dans leur vie d’ingénieur : gestion de projet, créativité, confiance et solidarité. « J’apprends tous les jours en participant à des projets, avec les étudiants des autres filières Arts-Études notamment. La section est une vraie source de cohésion et j’ai tissé des liens forts avec des étudiants qui participent encore aujourd’hui à façonner ma vision de la musique et du savoir-vivre en collectif », ajoute l’élève-ingénieur.
Au sortir de la formation d’ingénieur-musicien, les diplômés continuent d’entretenir leur passion pour la musique jusque dans leur vie professionnelle. « Beaucoup de nos diplômés exercent en tant qu’ingénieurs, et bien souvent, ils essaient de garder ce lien avec les arts. Un ingénieur-musicien INSA a développé une technique et une sensibilité musicale accrues. Certains s’orientent vers de la recherche, en acoustique notamment, où avoir été initié à la musique est un avantage. Et d’autres passent professionnels ! Cela fait maintenant dix ans que je vois évoluer les élèves-ingénieurs de musique-études, et mon bilan est très positif. Je suis très heureux de célébrer en ce moment l’anniversaire de la filière : nous nous produisons trois fois en concert avec un programme exceptionnel de bossa/samba brésilienne « BRAZ’INSA », puis nous réunissons les plus jeunes et les plus anciens de la filière pour fêter les trente-cinq bougies en fanfare ! », conclut Arnaud Sandel.
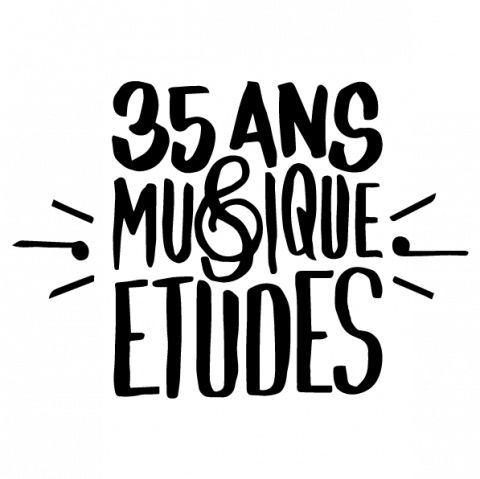 Pour fêter ses 35 années d’existence, la filière musique-études propose trois concerts, ouverts à tous, placés sous le signe de la fête. L’orchestre, composé de 80 étudiants et anciens élèves, vous présentera un audacieux mélange de Bossa-nova, Samba, Trad et Pop, spécialement créé pour l’occasion. Deux dates prévues pour profiter de la création « BRAZ’INSA » :
Pour fêter ses 35 années d’existence, la filière musique-études propose trois concerts, ouverts à tous, placés sous le signe de la fête. L’orchestre, composé de 80 étudiants et anciens élèves, vous présentera un audacieux mélange de Bossa-nova, Samba, Trad et Pop, spécialement créé pour l’occasion. Deux dates prévues pour profiter de la création « BRAZ’INSA » :Samedi 23 mars 2019
20h30 - CENTRE CULTUREL ARAGON, Oyonnax
Mercredi 27 mars 2019
20h30 - ROTONDE, INSA, Campus de la Doua, Villeurbanne
Informations et programmes
Inscriptions
Un week-end de retrouvailles des étudiants, diplômés, familles, professeurs et amis de la section est également co-organisé par Musique-Études, l’Association Musicale de l’INSA Lyon et les étudiants en formation les 12, 13 et 14 avril 2019. Un moment festif qui donnera lieu (notamment !) à un concert classique, jazz et folklo multigénérationnel et à un concert des professionnels du Lilananda Jazz Quintet et du Quatuor Pernambuco.
Informations et inscriptions
 Également dans le cadre des 35 ans de Musique-Études et de la Structure d’Accueil « Mécanique pour les Arts, les Cultures et l’Architecture » du département Génie Mécanique de l’INSA Lyon, les étudiants profiteront de l’intervention du Chef d’Orchestre russe Alexander Anissimov qui dirigera une répétition filmée de l’Orchestre Symphonique INSA Universités (OSIU) et organisera une master-class autour de la direction d’orchestre.
Également dans le cadre des 35 ans de Musique-Études et de la Structure d’Accueil « Mécanique pour les Arts, les Cultures et l’Architecture » du département Génie Mécanique de l’INSA Lyon, les étudiants profiteront de l’intervention du Chef d’Orchestre russe Alexander Anissimov qui dirigera une répétition filmée de l’Orchestre Symphonique INSA Universités (OSIU) et organisera une master-class autour de la direction d’orchestre.La venue du Directeur principal de l'Orchestre d’État de Biélorussie sera l’occasion pour un étudiant de 5e année de Génie Mécanique, d’étudier la gestique dans le cadre de son Projet Recherche Ingénierie (PRI) et réaliser un modèle automatisé articulé pouvant servir d’aide à l’apprentissage du geste.
Plus d’informations : Anne Tanguy, professeur INSA Lyon
[1] Directeur de l’INSA Lyon de 1974 à 1991


