
Entreprises
Convention des Entreprises pour le Climat : l'INSA Lyon rend sa feuille de route
Créée il y a trois ans, la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) a déjà rassemblé plusieurs centaines de chefs d’entreprises avec un objectif : interroger leur modèle économique au regard des enjeux socio-écologiques. Déclinée au niveau régional, elle a également intégré en son sein des établissements de l’enseignement supérieur. En 2023, l’INSA Lyon a suivi le parcours « CEC - bassin lyonnais » et a travaillé à l’élaboration d’une feuille de route qui vient d’être rendue publique. Récit de cette aventure et explications avec Alexis Métenier, Directeur du Développement à l’INSA Lyon.
C’est un véritable satisfecit. Après dix mois d’un parcours exigeant et parfois déroutant mais surtout très constructif, la belle aventure humaine de la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) - bassin lyonnais vient de déboucher en ce mois de février sur la publication de nombreuses feuilles de route qui engagent chacune et chacun de ses membres dont l’INSA Lyon.
En tant qu’acteur académique, participer à la CEC ne coulait pas de source, et pourtant, penser avec les entreprises à la source de leurs transformations a été une expérience forte pour Nicolas Freud, Directeur de la Transformation Socio-Écologique et Alexis Méténier, Directeur du Développement, à INSA Lyon, qui ont suivi le parcours d’une durée de dix mois. « Cette expérience a été extrêmement riche pour nous deux. Nous avons travaillé avec des entreprises au cœur de leurs problématiques comme elles ont aussi découvert nos problématiques à nous qui sommes en amont, formateurs d’ingénieurs, et qui souhaitons les aider à conduire leur propre transformation », témoigne Alexis Méténier.
Une claque
Dix mois marqués par six sessions thématiques de travail jusqu’à la remise d’une feuille de route et avec un objectif principal clairement défini : s’engager dans des projets impactants, collaboratifs, contribuant à « rendre irrésistible la bascule de l’économie extractive vers l’économie régénérative », comme l’indique la raison d’être de la CEC.
Régénératif, cela signifie ne pas se contenter d’une simple réduction des impacts négatifs ou de leur neutralisation mais c’est aller au-delà et s’engager vers la génération d’impacts positifs nets pour les écosystèmes et la société. Une philosophie qui n’a pas laissé les participants de cette CEC – bassin lyonnais de marbre.
« Les entreprises qui ont suivi le parcours CEC ont pris une claque dès la première session », décrit Alexis Méténier. Et de préciser avec une profonde motivation : « Cette prise de conscience les amène progressivement à être convaincus de l’importance de prendre appui sur nos ingénieurs mais aussi sur les nouvelles générations. Cela renforce nos convictions que nous devons nous aussi en tant qu’établissement nous positionner clairement comme un acteur responsable qui veut agir pour un monde écologiquement plus sûr et socialement plus juste ».
Passer à l’action
À l’issue de ce parcours « bassin lyonnais » qui s’est également accompagné d’un parcours « Alpes », 135 feuilles de route ont été remises. Parmi celles-ci, 117 organisations ont accepté de la rendre publique pour témoigner de leur chemin. L’INSA Lyon a désormais elle aussi sa feuille de route. Tout est écrit et gravé dans le marbre, il est temps de passer à l’action.
« Les feuilles de route ont pour objectif de dresser un certain nombre d’actions qui sont catégorisées par grands leviers de transformation. Exemple : comment former les collaborateurs, graduellement, pour les amener d’une part à prendre conscience du changement mais aussi d’autre part pour les orienter dans l’organisation pour qu’ils deviennent un acteur du changement », indique Alexis Méténier.
La feuille de route nourrit aussi de nouveaux projets pour l’établissement en matière de transition écologique. Cette année, l’établissement verra ainsi la création de l’Assemblée INSA, « Assemblée pour la Transition Écologique et Sociale », inspirée pour partie de la CEC, avec un processus qui se déroulera tout au long de l’année 2024, intégrant toute la communauté de l’INSA, étudiants et personnels. Cette dernière aura notamment pour mandat d'élaborer des propositions permettant de nourrir le futur schéma directeur Développement Durable et Responsabilité Sociale et Environnementale (DD&RSE) de l'établissement et de réactualiser sa stratégie, d'ici à début 2025.
Les 5 leviers de transformation de la feuille de route de l’INSA Lyon
- Engager la communauté INSA dans la transformation socio-écologique vers un monde écologiquement sûr et socialement juste
- Inscrire notre Recherche dans une démarche régénérative avec nos partenaires
- Former des ingénieurs acteurs de la transformation vers un monde écologiquement sûr et socialement juste
- Développer une offre de formation pour les entreprises
- Être un partenaire à visée régénérative du territoire
Une nouvelle aventure pour 2024
Au total, depuis février 2023, 150 entreprises ont été embarquées dans l’aventure à l’échelle de la région Rhône-Alpes : 80 sur les Alpes et 70 sur le Bassin Lyonnais. Fort du succès de ces deux Conventions des Entreprises pour le Climat, un nouveau parcours sur 2024 est d’ores et déjà lancé pour continuer à embarquer d’autres entreprises dans l’aventure.

Sciences & Société
Meet & Fabrik 2023 : Table ronde "Réduire l'impact environnemental de la recherche"
Comment réduire l'impact des activités de recherche sur l'environnement ? Venez répondre à cette question le 7 juin autour d'une table ronde organisée par la Fabrique de l'Innovation dans le cadre de l'événement Meet&Fabrik !
Comme tous les secteurs, la recherche est elle aussi soumise à des enjeux de réduction de son empreinte carbone. Comment accompagner cette transition ? A travers les témoignages d'acteurs de la recherche publique, mais également privée, découvrez plusieurs leviers d'action : réduction des dépenses énergétiques via un plan de sobriété, sensibilisation des équipes de recherche pour faire évoluer leurs pratiques vers des comportements plus écoresponsables, analyse du cycle de vie... Inscriptions gratuites
Información adicional
- fabrique.innovation@universite-lyon.fr
- https://meetfabrik.universite-lyon.fr/reduire-l-impact-environnemental-de-la-recherche-296826.kjsp?RH=meet_prog&LANGUE=0
-
Fabrique de l'Innovation, 28-30 Avenue Gaston Berger, 69100 Villeurbanne
Palabras clave
Últimos eventos
Exposition « Pas touche ! »
Desde 18 Jun Hasta 03 JulCourse Croisière Inter INSA - 2025
Desde 21 Hasta 22 Jun
Formation
"Il faut développer une approche critique du numérique dans la formation des élèves-ingénieurs"
Il apparaît aujourd’hui évident que le numérique bouleverse l’ensemble des domaines de la société ; une omnipotence qui transforme en profondeur nos existences et dont les enseignants investis dans l’évolution de la formation se sont saisis, avec deux objectifs : transformer la pédagogie pour consolider une culture minimale sur l’outil et développer une approche critique du numérique dans la formation des élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon.
Au sein du groupe de travail dédié aux « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique », la réflexion est partie du constat suivant : qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, de production logicielle ou d’appareils digitaux, les outils du numériques sont principalement créés par des ingénieurs. Il est donc urgent, au-delà de former les futurs professionnels à la maîtrise proprement technique, de leur faire entrevoir les réalités sociétales et philosophiques qui s’y rattachent. Lionel Morel, enseignant-chercheur au département informatique et laboratoire CITI, et David Wittmann, enseignant au centre des Humanités sont tous deux animateurs du groupe de travail « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique ». Dans cet entretien, ils résument les travaux menés pour intégrer ces enjeux à la formation INSA.
Lorsque l’on parle d’enjeux environnementaux du numérique, le premier « impact » criant se rapporte souvent à la réalité matérielle des objets. Cependant, les propositions et les objectifs pédagogiques établis par le groupe de travail veulent aller plus loin.
Lionel Morel : Environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liés au numérique. Le mythe du numérique « propre » ayant largement investi l’inconscient collectif, il est nécessaire de les former à développer des outils pour évaluer, contrôler et réduire l’impact du matériel numérique. Cependant, il est tout aussi indispensable de les initier à déconstruire ce mythe. Les effets d’une utilisation massive du numérique ne sont pas seulement matériels. Un objet technologique a des effets indirects et modifie une activité humaine en induisant des effets sur la société ; souvent, cet aspect n’est pas intégré par la personne qui conçoit ces objets numériques. À travers nos réflexions avec le groupe de travail, nous avons souhaité dépasser le cœur technologique et technique, et élargir le champ de l’acculturation de nos étudiants jusqu’à la politique, l’éthique et le juridique. L’ambition est de leur offrir une vision globale des enjeux engagés par le numérique. Nous voulons faire prendre conscience que la technologie n’arrive pas ex-nihilo ; elle est en interaction avec les sociétés humaines.
Vous avez ainsi débuté l’élaboration d’une méthodologie permettant d’aborder les enjeux environnementaux et sociétaux du numérique dans les enseignements, « à partir du réel ». En quoi consiste-t-elle ?
Lionel Morel : Une phase exploratoire assez conséquente a été nécessaire pour aboutir à une première ébauche de méthode pédagogique, avec une vision « en oignon ». L’idée principale est de mettre en évidence les impacts et les imaginaires sous-jacents, à partir d’un objet technique du réel. Prenons l’exemple de la vidéo-surveillance : les enjeux techniques sont ceux de la fabrication d’une caméra, de l’utilisation efficace et optimisée des données produites. Mais le déploiement de cette même technologie ne s’arrête pas aux enjeux techniques : il peut interroger le modèle économique des entreprises développeuses ou les potentiels lobbys impliqués. Ensuite, il comporte des dimensions éthiques et juridiques auxquelles il faut répondre : par exemple, la question des droits d’accès aux informations personnelles ou le droit à l’image. La couche supérieure de la réflexion peut porter sur les ressources nécessaires, le renouvellement du matériel défectueux, ses coûts écologiques… Enfin, la dernière couche s’intéresserait aux imaginaires liés à l’objet technique en lui-même. Pour le cas de la surveillance des populations, la littérature ou les médias internationaux en regorgent… Une fois ce travail réalisé, idéalement, il faudrait faire le travail dans le sens inverse, en faisant de la dernière couche, la plus importante : vers quel imaginaire voudrait-on aller ? C’est déconstruire pour mieux reconstruire.
Le groupe de travail a identifié quatre imaginaires très caractéristiques des manières usuelles et populaire de se rapporter au numérique. Quels sont-ils ?
David Wittmann : Effectivement, on pourrait croire que le fonds de commerce de la littérature dystopique ne dépasserait pas les pages des romans ni les écrans de cinéma, pourtant, les imaginaires du numérique sont très ancrés dans l'inconscience collective. Le premier se rapporte à l’immatérialité : c’est un mythe qui laisse penser que le numérique est propre et qu’il n’a pas d’impact environnemental. Le second se rapporte à l’immédiateté et consiste à considérer que le numérique permet de faire et d’avoir tout, dans l’instant. C’est d’ailleurs une notion qui camoufle totalement les médiations bien humaines qui nous permettent d’accéder aux applications comme les travailleurs de l’ombre, les modérateurs de contenus ou même les préparateurs de commande. Le troisième imaginaire est celui de la neutralité : penser que les algorithmes sont immunisés des biais humains et des jugements moraux. Pourtant, derrière les algorithmes, il y a des programmeurs et des organisations qui portent, en conscience ou non, des idées et des valeurs morales. Le dernier mythe que nous souhaiterions aborder est celui de l’absolue nécessité de la technologie numérique : souvent présenté comme solution à tous les maux, le numérique fait l’objet d’un grand récit solutionniste qui traverse notre société et évite d’interroger la réalité des besoins ou de contester l’efficacité du numérique face à des solutions plus traditionnelles.
Ces quatre grands mythes seront une base pour développer l’esprit critique des étudiants. Ce faisant, les futurs ingénieurs seront plus à même de construire des outils numériques socialement et écologiquement responsables, et seront aussi armés, en tant que citoyens, pour adopter une attitude réflexive et critique, et pour prendre part aux différents débats qui animent nos sociétés.
L’approche développée par le groupe de travail « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique » propose également d’enseigner les concepts à la base de la pensée algorithmique. Pour quelles raisons ?
David Wittmann : Il y a, à la base de la pensée algorithmique, l’idée qu’un problème, quel qu’il soit, peut être résolu par une machine qui sait lire et exécuter des commandes. Cependant, pour formaliser le problème, il faut en créer un modèle abstrait pour espérer que la machine le résolve. L’abstraction permet l’efficacité pratique, mais elle porte aussi en elle le germe d’une réduction de la complexité, en particulier du social. Il existe un caractère universel dans le numérique, qui prétend qu’une machine pourrait tout faire. Un raccourci se joue ici : on imagine que tout problème peut être résolu par un ordinateur ou une application numérique et par extension, par la technologie. Mais les informaticiens savent très bien qu’il y a des limites, des problèmes qui ne peuvent être résolus de manière exacte, par une machine. Faire comprendre cela à nos étudiants amène à les faire se questionner sur la différence entre innovation numérique et progrès social. Pour chaque objet numérique, il faut que l’ingénieur qui fait l’innovation se pose la question de savoir quelle est la société qui se construit à travers cet objet et si nous voulons d’une telle société. Quelle forme de vie, quelle humanité construisons-nous à travers les techniques que nous mettons en œuvre ?
Le groupe de travail dédié aux « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique » est composé de huit membres actifs : Frédérique Biennier (IF), Adina Lazar (BS), Lionel Morel (IF), Céline Nguyen (CDH), Christine Solnon (IF), Jean-François Tregouet (FIMI), Erin Tremouilhac (CDH) et David Wittmann (CDH).
Une (r)évolution de la formation d’ingénieur à l’INSA Lyon
Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année et est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :
▪️ Anthropocène et climat
▪️ Énergie
▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact
▪️ Enjeux du vivant
▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?
▪️ Calcul numérique
▪️ Sciences des données et intelligence artificielle
▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique
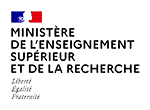
« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »

Formation
Comment enseigner les enjeux socio-écologiques dans une école d’ingénieur ? L’INSA Lyon répond.
Tout part d’un constat. Historiquement, en tant qu’acteurs majeurs du développement économique et de la technicisation du monde, les ingénieurs ont aussi contribué à leur manière à la crise socio-écologique en train de se dérouler.
Depuis 2019, l’INSA Lyon s’est lancé dans le chantier de l’évolution de sa formation pour tenter d’enrayer la machine. Dans un futur souhaitable, les futurs ingénieurs de l’INSA Lyon devront apprendre à « résister aux sirènes technosolutionnistes et faire preuve de lucidité ».
Faisant partie des premiers établissements de l’enseignement supérieur français à vouloir former l’ensemble de ses étudiants aux enjeux de « développement durable et de responsabilité sociétale », l’INSA Lyon est parti d’une page quasi-blanche. Après un peu plus de deux années de travaux préliminaires, l’heure est désormais au déploiement des nouveaux enseignements auprès des étudiants. Dès février 2023, la première illustration à grande échelle verra le jour avec le module « ETRE » pour « Enjeux de la Transition Écologique » en 1re année du département FIMI1. Une première porte qui s’ouvre vers un futur souhaitable. Explications.
« L’ambition du modèle INSA de former des ingénieurs citoyens, responsables, soucieux des conséquences de leurs actions, prend une nouvelle dimension si l’on prend au sérieux l’objectif que nos ingénieurs contribuent vraiment à la transition vers un monde soutenable ». C’est ainsi que le cahier n°2 de l’évolution de la formation de l’INSA Lyon introduit le sujet. « Notre ambition était de pouvoir proposer à nos étudiants une formation interdisciplinaire et systémique aux enjeux socio-environnementaux. C’est ce que l’on s’apprête à mettre en place aujourd’hui, à l’échelle de l’établissement », présente Nicolas Freud, enseignant-chercheur et chef du projet évolution de la formation.
Seulement, à l’INSA Lyon, aucun enseignant n’est à proprement parler « spécialiste des questions socio-écologiques » et beaucoup ont exprimé leur sentiment de manquer d’expertise et de légitimité vis-à-vis de ces sujets complexes et par nature transversaux. Pour construire les contenus, former les enseignants et déployer les enseignements dans l’ensemble des départements, les équipes pédagogiques se sont alors appuyées sur l’un de leurs atouts majeurs : la richesse et la complémentarité des compétences enseignantes. « Des groupes de travail thématiques ont été constitués avec des enseignants de différentes disciplines, des sciences pour l’ingénieur, mais aussi des sciences humaines et sociales, issus des différents départements et centres. Les apports croisés des participants ont permis de monter en compétences et de produire des ressources pédagogiques sur lesquelles les nouveaux enseignements pourront s’appuyer. Une synthèse de ces travaux est publiée dans le cahier n°2 de l’évolution de la formation », explique Nicolas Freud.
Au sein du département FIMI, une équipe pédagogique pluridisciplinaire peaufine la préparation du module « ETRE », dont la responsabilité est portée par Solène Tadier, Mathieu Gautier et Arnaud Sandel2. Sous cet acronyme évocateur se cachent les premières heures de cours consacrés aux « Enjeux de la TRansition Écologique ». Déployés dès février 2023 auprès des presque 900 élèves-ingénieurs de 1re année, les enseignements mobiliseront une cinquantaine de professeurs pendant 28 heures tout au long du second semestre. « L’idée est de poser les premières briques d’un enseignement qui se déploiera durant toute la scolarité. Nos élèves-ingénieurs doivent être équipés pour la suite dans les départements où ils approfondiront leurs connaissances au regard de leur spécialité d’ingénierie », indique Solène Tadier.
Pour cette première approche, deux façons d’enseigner les enjeux socio-écologiques. D’abord par des enseignements « dédiés », c’est-à-dire des cours sur les bases de connaissances scientifiques provenant notamment des travaux du GIEC3 et de l’IBPES4. « Cette partie sera réalisée en première année avec des binômes d’enseignants en sciences dures et en Humanités. Cette association nous a paru indispensable pour saisir les enjeux dans leur globalité : les aspects environnementaux et sociologiques seront ainsi enseignés conjointement », ajoute Mathieu Gautier. La seconde façon de faire appréhender les enjeux de la transition socio-écologique, c’est de les faire « infuser » dans des cours « non-dédiés », à travers les disciplines classiques : bien comprendre une fonction exponentielle en cours de mathématiques est, par exemple, indispensable pour comprendre le dépassement des limites planétaires. « En chimie, par exemple, l’enseignant peut profiter du chapitre qui parle de la transformation d’une ressource naturelle en une ressource utile pour aborder les enjeux d’extraction, d’analyse de cycle de vie et de finitude de la ressource. L’idée est d’essaimer et de faire comprendre que la problématique est systémique. »
Enseigner des questions socialement vives comme celles des enjeux socio-écologiques n’est pas chose aisée. Plus encore, enseigner des notions qui impactent émotionnellement et individuellement implique une nouvelle forme de transmission : une posture parfois très différente des habitudes académiques classiques. « Il faut prévoir des temps d’étude mais aussi des temps de débat pour que les étudiants s’approprient et métabolisent les connaissances face à ces constats. Le rôle de l’enseignant est délicat : il doit favoriser et canaliser des échanges dans un cadre sécurisant », ajoute Nicolas Freud. « Je suis confiant sur la capacité de nos étudiants à comprendre et intégrer ces connaissances qui ne sont pas toujours faciles à digérer. J’espère que ces nouveaux enseignements donneront des clés à nos futurs diplômés pour qu’ils puissent contribuer aux transformations nécessaires face aux enjeux. C’est d’ailleurs pour cela que les contenus donnent une place importante aux leviers d’action. Nous sommes dans une situation qui peut être vécue comme très anxiogène. Le meilleur antidote, face à cette éco-anxiété, c’est l’action et le travail collectif. »
Une (r)évolution de la formation d’ingénieur à l’INSA Lyon
Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année et est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :
▪️ Anthropocène et climat
▪️ Énergie
▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact
▪️ Enjeux du vivant
▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?
▪️ Calcul numérique
▪️ Sciences des données et intelligence artificielle
▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique
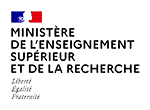
« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »
Plus d’informations : Consulter le livre 2 de l’évolution de la formation
-------
[1] Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur
[2] La responsabilité de ce module est portée par Solène Tadier, enseignante-chercheure au département FIMI et au laboratoire MATEIS ; Mathieu Gautier, enseignant aux départements FIMI et génie énergétique et environnement (GEn) et chercheur au laboratoire DEEP ; et Arnaud Sandel, enseignant aux départements FIMI et génie mécanique (GM).
[3] Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
[4] Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques

