
INSA Lyon
Point de bascule // la sélection du mois de février 2025
De Rosalind Franklin au Covid-19 en passant par l’IA : la science intègre
L’histoire des sciences est jalonnée de découvertes brillantes, d’aventures fascinantes, de trajectoires personnelles hors du commun, mais également de scandales. L’une des atteintes les plus marquantes à l’éthique scientifique est celle de l’histoire de Rosalind Franklin et du cliché 51, mettant en évidence la structure à double hélice de l’ADN. Quelques années plus tard, Jocelyn Bell Burnell, astrophysicienne britannique, se voyait déposée du Prix Nobel pour la découverte des pulsars. Autour de ces deux femmes exceptionnelles, des scientifiques ont eu un comportement peu intègre. Cet entretien avec Bruno Allard, référent à l’intégrité scientifique de l’INSA Lyon, brosse le portrait du principe de l’éthique, socle de confiance pour que la science reste un outil pertinent au service du progrès et de l’innovation pour le bien commun.
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/de-rosalind-franklin-au-covid-19-en-passant-par-l-ia-la-science-intègre
Et si on (re)mettait du Care au cœur de la technique ?
Comment accorder technique et valeurs du soin dans un monde « qui se veut de plus en plus soignant, mais qui se révèle être de moins en moins soigneux » ? Appliquées à la technique, les valeurs des éthiques du Care, fondées sur l’empathie et le soin mutuel, peuvent-elles contribuer à un monde plus soutenable ? Pour Jean-Philippe Pierron, cela ne fait aucun doute. Lors du 4ᵉ séminaire Let’s look up : Ingénierie et Recherche par le prisme du concept « One Health », le 28 novembre 2024, il a évoqué les moyens intellectuels et pratiques à mettre en œuvre pour rendre cela possible.
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/et-si-on-re-mettait-du-care-au-cœur-de-la-technique
Mob-Energy : un coup d’avance sur la recharge électrique
Folie d’étudiants ingénieurs, coup de poker ou bien véritable pari sur l’avenir ? Probablement un peu des trois à la fois. Quasiment dix ans après leur sortie des bancs de l’INSA Lyon, Salim El Houat, Ilyass Haddout et Maxime Roy, ont bel et bien transformé leur projet en réalité. Mob-Energy, société spécialisée dans le reconditionnement des batteries et la recharge de véhicules électriques, compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs, et s’est installée depuis janvier 2024 dans une toute nouvelle usine sur un site industriel à Vénissieux. L’article revient sur cette success-story ambitieuse et visionnaire, avec l’un de ses fondateurs.
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/mob-energy-un-coup-d-avance-sur-la-recharge-électrique
Prothèses de membres : quand l’objet technique s’invite dans l’intimité des corps
Il existe aujourd’hui une grande diversité de prothèses, qui varient en matière de matériaux, de formes et d’usages. Mais comment ces dispositifs s’intègrent-ils réellement dans le quotidien, la mobilité et l’intimité de ceux et celles qui les portent ? L’appropriation de la prothèse, c’est-à-dire l’intégration aux sensations, aux mouvements et aux habitudes de vie, ne va pas toujours de soi.
Lucie Dalibert, chercheuse au laboratoire S2HEP, explore cette relation complexe entre les corps et les technologies, dans le cadre du projet de recherche « Amélioration du parcours d’appropriation des dispositifs prothétiques » (APADiP).
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/prothèse-de-membres-quand-l-objet-technique-s-invite-dans-l-intimité-des-corps

INSA Lyon
Point de bascule // la sélection du mois de janvier 2025
Microplastiques : pourquoi sont-ils partout, même dans les bouches d'égout ?
Les bouches d’égout seraient-elles gardiennes défaillantes d’une pollution purement anthropique, qui a désormais franchi les barrières de nos corps humains ? Invisibles à l’œil nu mais omniprésents, les microplastiques s’infiltrent partout, jusque dans les entrailles de nos villes. Si l’on sait le plastique très présent dans les milieux marins, jusqu’à constituer des continents, on connaît moins son voyage insidieux depuis les bouches d’égout jusqu’aux écosystèmes aquatiques, sous la forme de microparticules. Pourquoi cette pollution est-elle plus présente en milieux urbains ? Quelles en sont les principales sources ? Quels sont les facteurs qui influencent leur transport dans les eaux pluviales ? Comment arrivent-ils jusqu’au milieu naturel ?
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/sous-les-grilles-d-égout-les-microplastiques
Ingénieurs-concepteurs : ce que la low-tech a à vous apporter
L’ingénierie n’est-elle qu’affaire de technique ? Romain Colon de Carvajal, fait partie de ces scientifiques pour qui l’ingénierie est bien sûr une affaire de technique, mais aussi d’éthique et de philosophie. Enseignant en génie mécanique à l’INSA Lyon, il est aussi spécialiste des low-techs. Selon lui, il est temps de préparer demain, et pour cela, il faut que les ingénieurs sortent du rang et partent à la reconquête de leur liberté.
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/ingénieurs-concepteurs-ce-que-la-low-tech-a-à-vous-apporter
Recyclage des silicones : une initiative pour donner une nouvelle vie aux manchons pour prothèses
Prisés pour leur stabilité chimique et leur haute résistance, les matériaux silicones sont omniprésents dans notre quotidien. Toutefois, une fois usagés, peu de chance pour que ceux-ci soient recyclés car l’incinération et l’enfouissement sont privilégiés. Pour François Ganachaud, chercheur au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP) (2), le véritable enjeu de leur recyclage réside autant dans le procédé que dans la chaîne logistique en amont de celui-ci.
Avec une société spécialisée dans les silicones pour manchons orthopédiques, COP Chimie, l’IMP tente de donner une autre vie aux silicones issus des déchets de fabrication, à travers une filière de recyclage des rebuts.
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/recyclage-des-silicones-une-initiative-pour-donner-une-nouvelle-vie-aux-manchons-pour-prothèses
Quand l’enseignement de la transition socio-écologique transforme la pratique enseignante
Dérouler un catalogue des derniers événements climatiques extrêmes sur la planète, aussi dramatiques soient-ils, ne suffit pas. Pour enseigner les enjeux environnementaux et sociétaux qui bouleversent nos sociétés et donner les meilleures clés aux ingénieurs de demain qui auront à les affronter dans le cadre de la transition écologique, les pratiques d’enseignement en la matière doivent nécessairement se remettre en cause.
Comment accompagner l’intégration des enjeux socio-écologiques dans la formation en école d’ingénieurs ? C’est justement la question qu’a explorée Hugo Paris dans le cadre de sa thèse de doctorat à l’INSA de Lyon. Interview.
👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/quand-l-enseignement-de-la-transition-socio-%C3%A9cologique-transforme-la-pratique-enseignante

Recherche
Transformer les plastiques recyclés en appareillages orthopédiques pour les populations vulnérables
D’après l’OMS, seulement 5 à 15 % des personnes ayant besoin d’un appareil orthopédique y ont accès dans les pays à faibles revenus ou en contexte de guerre. Pour pallier ce constat, Handicap International a intégré l’impression 3D sur ses territoires d’intervention depuis 2017. Aujourd’hui, l’organisation non gouvernementale se voit confrontée à des problématiques logistiques coûteuses, liées à l’importation de la matière première depuis l’Europe. Et s’il était désormais possible de fabriquer des appareillages orthopédiques à base de plastiques recyclés, trouvés localement ?

Orthèse fabriquée par impression 3D au Togo.
(Handicap International, Author provided).
Au sein de l’INSA Lyon, Valentine Delbruel, ingénieure INSA et doctorante, travaille sur l’optimisation de la composition d’un plastique recyclé, qui pourrait convenir à la fabrication additive d’orthèses : une façon de lutter contre la pollution plastique tout en rendant plus accessibles les solutions orthopédiques. Réalisés en collaboration avec Handicap International et trois laboratoires de l’INSA Lyon (MatéIS, IMP et LaMCoS), les travaux de la doctorante serviront aux équipes terrain d’Handicap International.
L’impression 3D : une innovation pratique mais une logistique difficile
Traditionnellement réalisés par thermoformage, les appareillages orthopédiques relèvent d’un procédé de fabrication long et coûteux. Dans les zones où l’accès aux centres de soin est déjà difficile, les aller-retours nécessaires aux ajustements et le temps de rééducation sont des freins supplémentaires, rallongeant la procédure de soin de plusieurs semaines pour une prothèse. Depuis 2017, Handicap International utilise l’impression 3D pour pallier ce problème. Les fabrications sont facilitées, plus rapides et personnalisables à chaque patient. « L’impression 3D a changé la façon de prendre les mensurations des patients car elles peuvent être prises à distance grâce à un scanner 3D », explique Valentine Delbruel. « Seulement, ce type de fabrication nécessite des filaments composés de plastique qui sont actuellement fabriqués en Europe. Cela pose des problèmes logistiques, notamment aux niveaux des frontières. En constatant cette problématique rencontrée par ses équipes, Handicap International s’est interrogé : est-il possible de continuer à faire de l’impression 3D, avec des matières plastiques locales, si possible recyclées ? »

Le procédé de fabrication des orthèses par thermoformage classique est long et coûteux.
(©Valentine Delbruel)
Utiliser du plastique recyclé pour soigner et dépolluer grâce à l’impression 3D : un projet vertueux, mais ambivalent, comme l’a constatée Valentine lors d’un voyage d’observation au Togo. « Dans de nombreux pays d’Afrique, le service de collecte des déchets est un service payant. Souvent un luxe pour les familles à faibles revenus, ce manque de service public engendre une pollution plastique importante dans les milieux naturels. Faire du déchet plastique une ressource pour les foyers tout en répondant à un besoin d’accès à la santé serait doublement bénéfique. »
Des enjeux de durabilité et de solidité du matériau recyclé
Sur le papier l’idée tombe sous le sens, mais les enjeux scientifiques et techniques soulevés par la potentielle réutilisation de plastiques recyclés ne sont pas si simples à solutionner. « Les deux principales problématiques sont celles de l’imprimabilité de la matière recyclée et de sa durabilité ». D’une part, les propriétés rhéologiques1 des matériaux sont étudiées. « Il faut une viscosité suffisamment faible pour que la matière s’écoule lors de l’impression, et dans le même temps, s’assurer que celle-ci maintienne sa forme une fois déposée ». D’autre part, il faut que la matière finale soit assez résistante pour durer dans le temps. « Et ça n’est pas une chose facile lorsque l’on mélange différents polymères », indique la doctorante qui réalise depuis trois années, différentes expérimentations afin de trouver la meilleure recette. « Il a fallu caractériser les déchets dans les pays d’intervention, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que chez nous. Par exemple, j’ai d’abord testé les emballages alimentaires, avant de m’apercevoir lors de ma mission au Togo qu’il y en avait très peu ! Il faut principalement composer avec des bouteilles en Polyéthylène Téréphtalate (PET) et des produits du quotidien en Polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). »

Les déchets plastiques pourraient être une ressources pour les foyers.
(©Valentine Delbruel)
Mettre les compétences des laboratoires à l’épreuve du terrain
Si Valentine Delbruel sait pouvoir compter sur les expertises scientifiques de trois laboratoires (le laboratoire MatéIS sur la structure et la propriété des matériaux, le laboratoire IMP expert dans l’élaboration et la caractérisation des matériaux polymères et le laboratoire LamCoS, spécialisé dans la mécanique des contacts et des structures), il n’en reste pas moins une tâche importante pour la doctorante en sciences appliquées : s’assurer de rester au plus proche du terrain pour produire une solution utile à destination des équipes d’Handicap International et des patients. « On a testé la résistance de nos matériaux recyclés dans les conditions climatiques africaines (température, humidité et exposition UV) grâce à une chambre climatique de vieillissement accéléré présente à l’INSA Strasbourg2. Dans le même temps, nous avons conçu un banc d’essai3 qui reproduit le mouvement de la marche et nous permettra d’étudier la résistance en fatigue des orthèses en sollicitations cycliques. Nous pouvons faire nos essais sur des orthèses imprimées en échelle 1 avec les mêmes imprimantes 3D utilisées par l’ONG, ce qui nous permet d’être le plus représentatif des conditions réelles. »

Tests en laboratoire par impression 3D
(©Valentine Delbruel)
Pour l’heure, l’ingénieure est formelle : « Il est encore difficile d’utiliser les matières issues d’usine de recyclage à cause de la présence d’impuretés. Si l’imprimabilité des matières recyclées en France est possible, la qualité des gisements d’Afrique n’est pas encore suffisante. C’est pourquoi pour ma dernière année de thèse, je m’intéresse plutôt au recyclage des chutes de plaques orthopédiques générées lors du thermoformage de prothèses ou orthèses. Il s’agit de matériaux de grande qualité qui sont actuellement jetés. En les recyclant, nous limitons l’utilisation de matières vierges et donc de ressources naturelles. Il sera alors intéressant d’étudier jusqu’à combien de cycles de recyclage la matière conserve ses propriétés mécaniques, afin d’avoir la solution la plus circulaire possible », conclut Valentine Delbruel.
La doctorante soutiendra ses travaux à la fin septembre 2024, date à laquelle elle espère pouvoir apporter le plus d’éléments possibles à l’ONG pour offrir une solution aux équipes de terrain et aux patients des zones à faibles revenus ou de guerre.
Plus d’informations : https://www.groupe-insa.fr/nos-actualites/chaire-innovation-humanity-entretiens-croises
[1] La rhéologie est un domaine de la mécanique qui étudie la résistance des matériaux aux contraintes et aux déformations.
[2] Collaboration réalisée avec Vincent Steiner de l’INSA Strasbourg
[3] Les travaux de thèse de Valentine Delbruel ont été accompagnés par deux projets de fin d’études d’élèves-ingénieurs du département Matériaux et Génie Mécanique : l’un sur la résistance en conditions climatiques d’Afrique (Hugo Lajoie) ; l’autre sur la fabrication d’un banc d’essai reproduisant le mouvement de la marche (Abderrahmane Abbassi).

Recherche
Implants en silicone : pour une reconstruction mammaire plus sûre
À l’occasion d’Octobre rose, il est important de rappeler que le cancer du sein touche un peu plus d'une femme sur dix en France1. Selon une étude de la Haute Autorité de santé, sur les 20 000 femmes subissant une mastectomie chaque année en France, 30%2 choisissent d’entamer une reconstruction mammaire. Parmi les multiples techniques existantes, on trouve les implants en gel silicone cohésif.
François Ganachaud, directeur de recherche CNRS au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères3 et Raphaël Brunel, ingénieur transfert technologique au sein d’INSAVALOR, ont participé à la résolution d’une affaire sanitaire liée à ces dispositifs médicaux. Leurs travaux de contrôle ont permis d’en comprendre plus sur les risques accrus de rupture de certaines prothèses. C’est pourquoi, après cette expérience, ils souhaitent participer à offrir un parcours de reconstruction mammaire post-mastectomie plus facile avec des matériaux plus sûrs.
Une fabrication artisanale
C’est un objet plutôt curieux de prime abord. Une poche arrondie, remplie d’une matière ni liquide, ni compacte. On pourrait aisément croire qu’un implant, qui utilise du silicone à la fois pour son enveloppe et son gel de remplissage, est fabriqué à la chaîne par un bras robotisé tant il semble avoir été confectionné au millimètre. Pourtant, François Ganachaud l'assure : « parmi toutes les entreprises que j’ai eues l’occasion de visiter, la fabrication d'implants reste un vrai travail d’artisan. Tout est fait à la main, du moulage au trempage en passant par le contrôle de l’étanchéité des couches barrières. Même lorsqu’il s’agit d’implants texturés, ils sont imprégnés de gros sel parfaitement calibré en taille pour façonner la surface », explique le chercheur de l’IMP. D'abord cuite pour assurer la réticulation qui permet d’obtenir la dureté désirée, la matière composant l'enveloppe est ensuite démoulée avant d’être remplie d’un gel cohésif. « Ces dispositifs médicaux doivent être mécaniquement et chimiquement irréprochables. Une fois placée dans le corps, la prothèse doit avoir une tenue précise selon les profils et la souplesse désirés par la patiente et le praticien. Mais ils doivent surtout être complètement sûrs médicalement », ajoute François Ganachaud.
![]()
Très stables dans des milieux chimiques et biologiques, les silicones médicaux utilisés sont les acteurs parfaits pour assurer une immunité corporelle, sur le papier. « Une fois implantés, le corps fabrique une barrière fibreuse naturelle autour de la prothèse. Si la capsule est bien faite et que l'implant est conforme, la patiente peut le porter pendant plusieurs années. Même si on ne peut jamais vraiment savoir à l’avance comment le corps réagira face à la présence d'un produit exogène, ces matériaux sont particulièrement bien acceptés. La fabrication des matériaux est par ailleurs très normée, surtout depuis que l’histoire a montré des cas de fraudes dramatiques », ajoute le chercheur.
Une expertise du matériau mise à l’épreuve
François Ganachaud et Raphaël Brunel sont des experts de la chimie des polymères. Ils ont suivi de très près l’une des plus grosses affaires sanitaires de l’histoire des implants. « L’affaire faisait état de prothèses qui présentaient des ruptures prématurées anormales sur un bon nombre de patientes. Nous étions chargés d’étudier des échantillons de prothèses explantées pour discriminer, par des analyses physico-chimiques, quels échantillons étaient défectueux et lesquels ne l’étaient pas », explique Raphaël Brunel. Pendant plusieurs mois, ils testent et découvrent un grand nombre de dispositifs non-conformes. « Nous avons mis en évidence la présence de petits cycles, des molécules assimilables à des solvants, qui peuvent se disperser dans le corps après la rupture de l’implant. Nous n’avons pas eu l’occasion d’aller plus loin dans l’analyse chimique, mais cette expérience a été un travail très important, pour nous, éthiquement parlant, car nous savions que ces prothèses avaient causé du mal à beaucoup de femmes », ajoute Raphaël Brunel.
Des alternatives envisagées
En travaillant sur ce cas, François et Raphaël s’interrogent. Peuvent-ils aider ces femmes à retrouver une vie plus sûre dans ce parcours du combattant qu’est la reconstruction mammaire ? Comment innover en la matière ? Ils réfléchissent à des alternatives de matériau comme des mousses solides qui n’exsuderaient pas. Si la balance « bénéfice-risque » d’une telle innovation médicale est au cœur du sujet, les freins sont plus nombreux que seuls ceux liés aux problématiques posées par l’innovation technique. « Pour innover dans le domaine, il faut évidemment s’attarder sur la question de sûreté médicale que l’usage d’un nouveau dispositif soulèverait. Mais au-delà, la conception d’un type de prothèse très différent ne peut pas s’imaginer sans prendre en compte l’une des caractéristiques les plus importantes pour les patientes et les chirurgiens : l’esthétique et la tenue de l’implant. Du fabricant de la matière première à la patiente, les acteurs de la chaîne sont très nombreux ». Parmi les tentatives d’innovation connues sur le marché : la conception ‘à façon’ par impression 3D de l'implant qui permettrait, par exemple, aux femmes ayant subi une mastectomie d’un seul sein de retrouver une certaine symétrie naturelle et plus de liberté esthétique dans la reconstruction. Car c’est tout l’enjeu de tels travaux de R&D : aider ces femmes touchées par une mastectomie à retrouver une liberté et un plaisir d’être, grâce à la reconstruction mammaire plus sûre.
[1] Panorama des cancers en France - édition 2022.
[2] Reconstruction mammaire après mastectomie : une enquête pour connaître les besoins des femmes
[3] INSA Lyon, LYON 1, UJM, CNRS

Recherche
Du ciment pour réparer les os abimés
La greffe osseuse s’est largement développée ces dernières années pour soigner de nombreuses pathologies : fractures, tumeurs osseuses, ostéoporose... Le laboratoire MatéIS1 travaille au développement d’un biomatériau innovant destiné à être injecté directement au cœur des tissus osseux endommagés : un ciment médical, en voie de devenir une solution de greffe moins invasive, durable et révolutionnaire.
L’idée de consolider les os ne date pas d’hier. Une prothèse en bois, datée d’environ un millénaire avant notre ère, a ainsi été découverte au pied droit d'un squelette égyptien. Son ingéniosité et sa remarquable esthétique n’avaient rien à envier aux prothèses qu’on installait aux amputés jusqu’encore récemment : jambes de bois et autres crochets de fer vissés en lieu et place de mains disparues. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour sortir de la logique essentiellement esthétique des prothèses, pour assister aux premiers pas de la greffe osseuse, c’est-à-dire la transplantation de tissu osseux, pour réparer une partie de notre squelette qu’un traumatisme, une maladie ou des difficultés articulaires auraient altéré.

Un millénaire avant notre ère, les Égyptiens savaient déjà amputer et remplacer
un membre par une prothèse de bois et de cuir (University of Basel/Matjaž Kačičnik)
Une alternative synthétique à la greffe d’os
Si l’os est un organe constamment soumis à un processus de renouvellement de son tissu, l'ostéogenèse, cette capacité d’autoréparation, que nous voyons par exemple à l’œuvre lorsque nous appliquons un plâtre sur une jambe cassée, ne suffit parfois pas. Lorsqu’un traumatisme ou qu’une lésion est trop sévère et que le squelette ne parvient pas à se régénérer seul, des techniques de greffe ont été développées pour assister la régénérescence du tissu osseux. La plus répandue, l’autogreffe, consiste à prélever une section de squelette sur le patient et de la greffer sur la partie à réparer – cette technique présente l’avantage de ne pas provoquer de réaction immunitaire ou de rejet du greffon ; en revanche, elle nécessite plusieurs interventions chirurgicales sur le même patient et augmente - de fait - le risque de morbidité. Parfois, une allogreffe peut également être mise en place : il s’agit d’appliquer le même traitement, mais à partir d’un greffon issu d’un donneur (à la suite d’une pose de prothèse de hanche par exemple), qui peut parfois provoquer un rejet de la part du receveur.
Ajoutons que plus de deux millions de greffes osseuses sont exécutées chaque année dans le monde, que ce soit en chirurgie orthopédique, dans le cadre d’opérations associées à des maladies osseuses, ou encore pour des actes d’orthodonties ou de chirurgie maxillo-faciale2. Dès lors, on comprend que la quantité de tissu osseux nécessaire à ces greffes, et les limites que peuvent présenter l’autogreffe et l’allogreffe, ont amené la communauté scientifique à développer des biomatériaux qui reproduisent les caractéristiques de l’os, à partir de matière première non-osseuse.
Sortir le ciment du BTP
« Un os est composé de 2/3 de céramique -apatite phosphocalcique- et d’1/3 d’eau et de composés organiques » rappelle Solène Tadier, la coordinatrice du projet SUN7 pour le laboratoire MatéIS. C’est justement cette partie céramique que les chercheurs tentent de synthétiser et reproduire, grâce à toute une gamme de céramiques à usage biomédical, dont le « ciment » fait partie. « Si on parle de ciment, c’est parce que, comme pour le génie civil, il s’agit de matériaux qui doivent être liquides ou visqueux pendant la durée de l'injection par le chirurgien, pour ensuite se transformer en matériaux solides au contact du tissu osseux à réparer », poursuit-elle.
Le projet SUN7 s’intéresse justement à caractériser et à mieux comprendre ce processus de solidification. « Nous étudions les réactions chimiques ainsi que les évolutions des propriétés mécaniques de la microstructure du matériau. Autrement dit, nous analysons finement l’évolution des propriétés du ciment, à toutes les étapes de sa transition d’une phase liquide à une phase solide ». Le protocole de recherche est très exigeant et représente un considérable défi scientifique : il s’agit d’analyser l’ensemble de ces caractéristiques en temps réel, à chaque échelle spatiale de la matière et en quelques minutes car certains ciments biomédicaux n’ont besoin que de 30 minutes pour prendre.
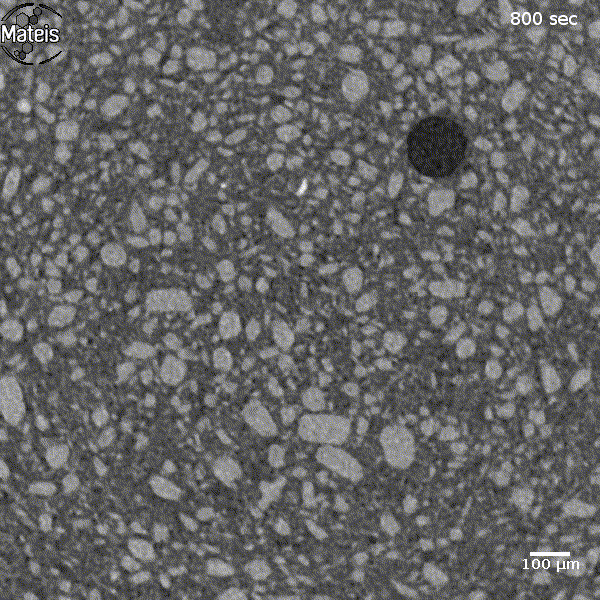
Évolution de la microstructure du plâtre, par tomographie aux Rayons X.
Les particules de la poudre réactive initiale (éléments les plus clairs) se dissolvent et laissent place à un réseau très fin d'aiguilles de plâtre3.
L’importance du projet SUN7 réside donc dans la compréhension et le contrôle de la transition liquide-solide du ciment, car la fenêtre est relativement limitée. En effet, Solène Tadier le précise, « il ne faut pas qu’il prenne « trop vite », pour que le chirurgien puisse avoir le temps de réaliser son geste. Il ne faut pas non plus que le ciment reste trop longtemps à l’état liquide ou visqueux, afin que le patient ne reste pas interminablement immobilisé ».
Accélérer la régénération osseuse
Les ciments biomédicaux ont aussi le formidable pouvoir d'assurer deux fonctions médicales essentielles : la substitution et la guérison.
La fonction première de ce biomatériau sera, en effet, de prendre la place de l’os quand celui-ci est absent ou présente un défaut mécanique ; il pourra également servir d’accroche à un os quand le dommage se situe au niveau de l'articulation. La seconde fonction, consiste à délivrer des molécules de soin directement sur le site osseux endommagé. « Dans ce cas, grâce à sa capacité de résorption, le ciment aidera à la croissance d’un os néoformé naturel. », précise Solène Tadier. L’os est un matériau vivant, dont l’architecture organique complexe est encore impossible à reproduire à l’identique avec des procédés synthétiques. « En se résorbant, ces ciments phosphocalciques vont libérer des briques élémentaires, comme du calcium ou du phosphore, afin d’accélérer la reformation osseuse et remplacer temporairement un os le temps que celui-ci se régénère ».
Sachant que notre squelette a besoin de 20 ans, en moyenne, pour se régénérer totalement, les biomatériaux s’avèrent de formidables et prometteurs outils dans la prise en charge des pathologies osseuses, en particulier grâce à leur propriété de catalyseur de l’ostéogenèse.
La bio impression 3D comme horizon
Plus généralement, les connaissances développées par l’équipe de Solène Tadier sont utiles dans d’autres cadres techniques, en particulier celui de l’impression 3D. Car, contrairement à d’autres céramiques qui nécessitent des traitements thermiques pour se consolider, ce ciment – une fois imprimé – va durcir et se solidifier tout seul. C’est intéressant d’un point de vue écologique, car cette technique de prise consomme peu d’énergie ; mais c’est aussi « intéressant d’un point de vue médical », indique la chercheuse. « Le fait de ne pas appliquer de traitement thermique à nos matériaux nous permet aussi d’y adjoindre des molécules biologiques d’intérêt », par exemple des cellules souches ou des facteurs de croissance adaptés à la pathologie osseuse. Ces bio impressions 3D vont permettre de fabriquer des prothèses résistantes, sur-mesure et qui se rapprochent le plus possible des caractéristiques naturelles des tissus osseux.
En améliorant les ciments biomédicaux, l’équipe du projet SUN7 agit directement sur la qualité de prise en charge des patients et augmente nos capacités de régénération osseuse. De quoi se faire de vieux os sans peine.
----------
[1] MATEriaux : Sciences et ingénierie (INSA Lyon, CNRS, Université Lyon 1
[2] : Substituts osseux. Fabienne Jordana, Catherine Le Visage et Pierre Weiss - Med Sci (Paris) 2017 ; 33 : 60–65.
[3] In-situ X-ray tomographic monitoring of gypsum plaster setting. J. Adrien, S. Meille, S. Tadier, E. Maire, L. Sasaki, Cement and Concrete Research 82, 107–116, 2016.
Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 1 - 27 octobre 2021

Recherche
Innovation for Humanity : innover pour réparer l’humain
« À l’heure actuelle, des millions de personnes à travers le monde ont besoin d’une prothèse mais n’y ont pas accès en raison du coût matériel, du manque de ressources humaines expertes et de la difficulté à se déplacer dans un centre de santé. » Tel est le constat énoncé par Pierre Gallien, directeur innovation, impact & information d’Handicap International.
La réadaptation physique et fonctionnelle est le premier sujet de recherche qui amorcera les collaborations scientifiques menées dans le cadre d’une alliance unissant le Groupe INSA et la Fédération Handicap International. Dans le cadre de la chaire de recherche et d’enseignement « Innovation for Humanity » lancée le 28 janvier prochain, les chercheurs de l’INSA auront pour objectif de répondre aux problématiques rencontrées par les équipes de l’organisation humanitaire. Abder Banoune et Jérôme Chevalier, tous deux impliqués dans cette chaire, expliquent comment la recherche peut participer à restaurer l’intégrité physique des personnes handicapées, avec une contrainte : celle de faire « avec ce qu’il y a sur place ».
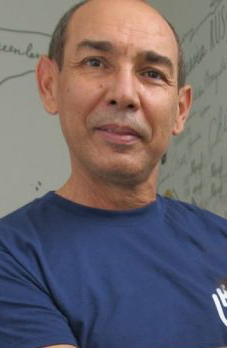 Dans le monde et selon l’Organisation Mondiale de la Santé, seulement 5% à 15% des personnes ayant besoin de technologie d’assistance (fauteuils, prothèses et orthèses, aides à la mobilité aides auditives et visuelles) y ont accès. Accompagner les personnes handicapées vers l’autonomie est le métier originel d’Handicap International, et malgré plus de 40 ans d’action, les défis humanitaires restent nombreux. Abder Banoune, spécialiste de la réadaptation physique au sein de l’ONG, explique. « L’une de nos missions fondamentales est d’accompagner des personnes victimes à récupérer une mobilité optimale. Nous intervenons principalement dans des pays frappés par des conflits, des catastrophes naturelles ou une extrême pauvreté et où l’accès à des prothèses ou des orthèses est rendu difficile. Aujourd’hui, pour rendre une prothèse disponible, nous avons besoin d’équipements lourds et d’équipes très qualifiées, ce qui est souvent incompatible avec les situations des pays dans lesquels nous intervenons. »
Dans le monde et selon l’Organisation Mondiale de la Santé, seulement 5% à 15% des personnes ayant besoin de technologie d’assistance (fauteuils, prothèses et orthèses, aides à la mobilité aides auditives et visuelles) y ont accès. Accompagner les personnes handicapées vers l’autonomie est le métier originel d’Handicap International, et malgré plus de 40 ans d’action, les défis humanitaires restent nombreux. Abder Banoune, spécialiste de la réadaptation physique au sein de l’ONG, explique. « L’une de nos missions fondamentales est d’accompagner des personnes victimes à récupérer une mobilité optimale. Nous intervenons principalement dans des pays frappés par des conflits, des catastrophes naturelles ou une extrême pauvreté et où l’accès à des prothèses ou des orthèses est rendu difficile. Aujourd’hui, pour rendre une prothèse disponible, nous avons besoin d’équipements lourds et d’équipes très qualifiées, ce qui est souvent incompatible avec les situations des pays dans lesquels nous intervenons. »
Les promesses de l’impression 3D
Après des analyses de terrain, les équipes d’Handicap International ont réalisé le potentiel de l’impression 3D. Des projets pilotes ont démontré que cette technologie pouvait notamment répondre à une problématique logistique de taille. « Lorsqu’un patient a besoin d’un appareillage orthopédique, il doit se rendre dans un centre médical situé dans les grandes villes. S’il vit dans une zone rurale ou de montagne, l’accès au centre peut s’avérer compromis. L’impression 3D nous permet de nous rapprocher au plus près des personnes dans le besoin : avec un simple ordinateur et un scanner nous pouvons prendre les mesures physiologiques des patients et envoyer les données à un centre de fabrication dans les grandes villes. Mais pour ouvrir cette technologie à plus de personnes, nous avons ici besoin de la recherche », poursuit Abder.
Identifier des axes de recherche scientifique pour soigner plus de patients
 Au cours des derniers mois, les laboratoires et les équipes les plus pertinentes sur le sujet de l’impression 3D de prothèses et orthèses ont été sollicités. Parmi les laboratoires identifiés, l’IMP1, spécialiste des polymères ; le laboratoire MATEIS2, expert dans le domaine des propriétés mécaniques et de la durabilité des matériaux ; et le LaMCoS3, pour son expertise sur la conception et la fabrication additive. « Avec Christophe Garcia, également porteur de la chaire, nous avons pour mission de traduire la feuille de route transmise par Handicap International en projets de recherche. Après avoir identifié les besoins, nous allons transformer chaque sujet en projets de fin d’études et en thèses de doctorat. Il est essentiel d’impliquer les étudiants, d’une part car ils sont très demandeurs de ces sujets porteurs de sens et d’autre part parce qu’ils ont aussi de belles idées qui méritent d’être développées », dit Jérôme Chevalier, enseignant-chercheur adjoint à la direction de la recherche de l’INSA Lyon et porteur de la chaire.
Au cours des derniers mois, les laboratoires et les équipes les plus pertinentes sur le sujet de l’impression 3D de prothèses et orthèses ont été sollicités. Parmi les laboratoires identifiés, l’IMP1, spécialiste des polymères ; le laboratoire MATEIS2, expert dans le domaine des propriétés mécaniques et de la durabilité des matériaux ; et le LaMCoS3, pour son expertise sur la conception et la fabrication additive. « Avec Christophe Garcia, également porteur de la chaire, nous avons pour mission de traduire la feuille de route transmise par Handicap International en projets de recherche. Après avoir identifié les besoins, nous allons transformer chaque sujet en projets de fin d’études et en thèses de doctorat. Il est essentiel d’impliquer les étudiants, d’une part car ils sont très demandeurs de ces sujets porteurs de sens et d’autre part parce qu’ils ont aussi de belles idées qui méritent d’être développées », dit Jérôme Chevalier, enseignant-chercheur adjoint à la direction de la recherche de l’INSA Lyon et porteur de la chaire.
De l’optimisation de la prothèse imprimée…
Pour les chercheurs, la question est donc posée : comment optimiser l’impression 3D de prothèses et d’orthèses, pour soigner plus de patients dans le besoin ? De l’élaboration à la résistance des matériaux, en passant par la durabilité des composants ou l’optimisation des formes et des architectures, les challenges scientifiques sont nombreux. « D’abord, nous souhaiterions travailler à l’optimisation des prothèses en elles-mêmes. Aujourd’hui, elles sont fabriquées par thermoformage et avec des matériaux qui ne sont pas toujours disponibles dans les pays d’intervention d’Handicap International. La fabrication additive par impression 3D permet d’étudier de nouvelles possibilités de formes et d’évaluer l’utilisation de matières premières accessibles localement », explique Jérôme Chevalier également chercheur au laboratoire MATEIS.

… à une imagerie médicale adaptée.
Dans un second temps, c’est la question de l’imagerie qui sera traitée par les équipes de chercheurs. « Pour fabriquer une prothèse de façon classique, il faut reproduire la partie du corps faisant défaut avec un moule de plâtre. Aujourd’hui, dans les pays d’intervention, ce matériau une fois utilisé, est directement jeté. Le recyclage des déchets induits par la fabrication de prothèses et d’orthèses est un vrai sujet. L’impression 3D limiterait la production de déchets, voire permettrait de réutiliser certains déchets plastiques. Nous pourrions aussi imaginer prendre les mesures physiologiques sur place, directement avec l’appareil photo d’un téléphone portable au lieu d’un scanner. À partir de cela, il n’y aurait plus besoin de plâtre. Pour arriver à cela, nos équipes devront travailler à la traduction de l’empreinte 3D en modèle pour les imprimantes », poursuit l’enseignant-chercheur.

Quatre années pour la recherche au service de causes humanitaires
Alors que le premier volet de la chaire de recherche unissant l’INSA et Handicap International commence à prendre corps, « Innovation for Humanity » ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Signée pour 4 ans minimum, la collaboration donnera lieu à des recherches sur l’utilisation de drones pour déminage, l’analyse d’images et de données et plus généralement l’apport des sciences numériques, avec pour même objectif de faire émerger des enjeux scientifiques aux problématiques rencontrées sur le terrain par les équipes de l’organisation internationale. « Le monde évolue, il doit en aller de même pour nos formations et notre recherche. L’humanitaire doit également profiter de nos recherches », conclut Jérôme Chevalier.
1 Laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (CNRS / UdL / Lyon1 / UJM / INSA Lyon)
2 Matériaux : ingénierie et sciences (INSA Lyon/ CNRS / Lyon 1)
3 Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon / CNRS / UdL)

