
Recherche
« À base d’algues, nos emballages jetables sont compostables et comestibles »
Le plastique n’est plus du tout fantastique : omniprésent, on le sait désormais nocif pour l’environnement, la santé humaine et les écosystèmes. Seulement, le plastique est pratique. Ou tout du moins, l’emballage jetable l’est pour bon nombre de situations de la vie courante. Pierre-Yves Paslier, diplômé du département matériaux, a fondé l’entreprise « Notpla ». Avec elle, il met en évidence un fait : dans la nature, l’emballage existe et ne dure jamais plus longtemps que son contenu, comme la peau d’un fruit. L’entreprise de l’ingénieur-produit a trouvé la recette pour fabriquer des emballages jetables et même comestibles à partir d’algues. L’innovation a récemment été récompensée par le Prince William, à travers le Earthshot Prize 2022, dans la catégorie « Construire un monde sans déchets ».
Avec « Notpla », vous introduisez une innovation de taille dans le monde du packaging : remplacer le plastique des emballages jetables par un matériau biosourcé, l’algue. Pourriez-vous résumer ?
Nos produits sont des emballages dits « jetables » dédiés à la consommation instantanée ou hors de chez soi comme les repas à emporter ou les snacks pendant les évènements sportifs. Nous avons souhaité nous concentrer sur l’industrie du déchet jetable car c’est souvent celui qui est le plus à même de se retrouver directement dans la nature. À la différence du packaging plastique ou carton généralement utilisés dans ces cas-là, nos solutions sont naturellement biodégradables puisqu’elles sont fabriquées à base d’algues. L’idée était de ne pas produire un déchet que la nature ne pourrait pas gérer. Concrètement, il suffit de mettre l’emballage au compost ou même, de le manger pour que celui-ci disparaisse !

Différents types d’emballages jetables à base d’algues proposé par Notpla. ©Notpla
Pour arriver à cette solution, vous avez exploré l’industrie des algues, à force d’essais et de recherche. À partir de quelles algues travaillez-vous ?
La plupart de celles utilisées dans nos produits sont des algues brunes et rouges. Selon les usages, nous avons appris à utiliser des espèces différentes, mais c’est un monde très vaste. En Europe, l’industrie des algues n’en est qu’à ses balbutiements contrairement à l’Asie du Sud-Est par exemple, où elle est très développée. En réalité, beaucoup de produits du quotidien élaborés à l’échelle industrielle en contiennent déjà : dans les glaces, des produits pharmaceutiques, en cuisine… Nous avons adapté certaines de leurs propriétés pour en faire du packaging et remplacer le plastique. Du géant de vente d’articles sportifs aux entreprises de livraison de repas à domicile, beaucoup d’entreprises sont intéressées.
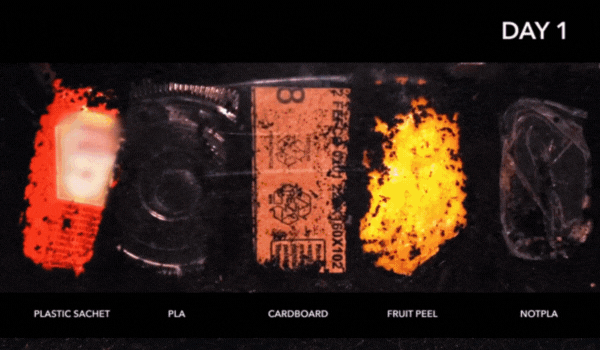
La décomposition du déchet à base d’algues est très rapide. © Notpla
On dit souvent que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Êtes-vous en accord avec ce principe ?
Bien sûr, la solution la plus simple pour réduire les effets néfastes du plastique est de réduire sa consommation d'emballages, et c’est d’ailleurs le premier réflexe à avoir. Seulement parfois, l’emballage est nécessaire, pour sa fonctionnalité. Le meilleur déchet plastique est celui que l’on ne produit pas car si ce matériau est très performant, il est à haut risque pour les océans, les écosystèmes et même notre santé. Le recyclage du plastique ne fonctionne pas en l’état actuel des choses : dans le monde, seulement 9 % des déchets plastiques sont réellement recyclés. La manière dont on emballe est très déconnectée de la réalité et c’est un fait que j’ai éprouvé les premières années de ma vie professionnelle : j’étais ingénieur-produit dans un grand groupe de produits cosmétiques et d’hygiène. En quelques secondes, de grandes quantités de plastiques sont produites, et mettront des milliers d’années avant de disparaître.
Pierre-Yves Paslier et son associé avaient fait le buzz sur les
réseaux sociaux grâce à leur technique à base d’algues
Zoomons d’ailleurs sur votre parcours professionnel. Comment êtes-vous passé de l’INSA à « Notpla » ?
En sortant de l’INSA Lyon, j’ai été embauché à la suite de mon stage de fin d’études dans un grand groupe. Ayant suivi l’option « design » pendant mes études d’ingénieur, je trouvais intéressant de travailler dans le domaine du packaging : les enjeux de matériaux et d’industrialisation liaient vraiment l’ingénierie et le design. Je travaillais sur les lancements de packaging plastique produits à des centaines de millions d’unités : des produits jetables qu’il était impossible de faire entrer dans des circuits vertueux comme le réemploi par exemple. La situation me pesait. J’ai décidé d’approfondir mes compétences en design avec un master en Innovation Design Engineering dispensé entre l’Imperial College London et the Royal College of Art. À cette occasion, j’ai rencontré mon cofondateur, Rodrigo Garcia Gonzalez avec qui nous nous sommes mis en tête d’explorer des matériaux naturels pour produire un emballage biodégradable. Dans notre cuisine, nous avions tourné une vidéo « tutoriel » qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à une technique inventé par Unilever à base d’algues. Cela nous a motivés à trouver une solution plus aboutie et à transformer ces expérimentations en un projet solide et scientifique. Les financements et les fonds d’investissements nous ont permis d’embaucher ingénieurs, designers et chimistes. Aujourd’hui, nous avons remplacé plus de trois millions de plastique à usage unique et nous sommes 70 salariés chez Notpla.
Vous avez suivi une option « design » lors de vos études d’ingénieur. Quels liens faites-vous entre les deux domaines d’expertise ?
Le rôle de l’ingénieur est de résoudre des problèmes et cette capacité peut se traduire de plein de manières différentes. Je crois qu’il est important de pouvoir dialoguer précisément avec les techniciens, mais aussi d’être capable d’expliquer le raisonnement logique derrière la technique. C’est peut-être ici que se rejoignent les deux métiers : le designer s’attarde sur l’usage et le besoin des utilisateurs, il n’est pas nécessairement face à un problème technique, mais prend en compte la problématique sociale à laquelle le produit doit répondre. Avoir les deux casquettes permet finalement d’être à la confluence de la réalité technique et la réalité de la société.
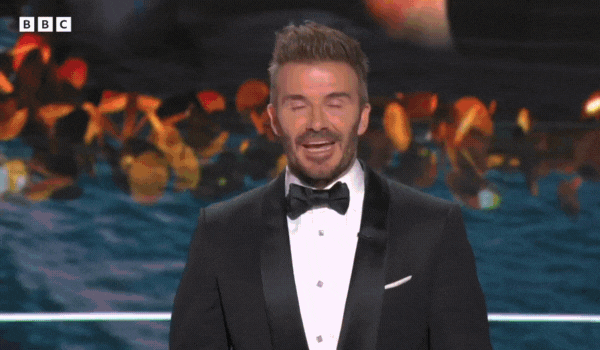

Recherche
« Certains plastiques biosourcés sont considérés comme des perturbateurs du recyclage »
Depuis quelques années, des nouveaux matériaux polymères ont fait leur apparition. Biosourcés, ils offriraient une alternative aux plastiques conventionnels. Mais sont-ils vraiment plus écologiques ? Valérie Massardier, chercheure au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères1 est co-porteure du projet « Bioloop ». Menée en collaboration avec deux autres laboratoires, le GREDEG et Triangle, l’étude s’attache à montrer les freins dans le développement des bioplastiques. Pourquoi nos emballages à usage unique ne sont-ils pas (encore) tous fabriqués en plastique biosourcé ? Valérie Massardier répond.
 Qu’appelle-t-on un plastique biosourcé et quelle est la différence avec les plastiques qui constituent les emballages de notre quotidien ?
Qu’appelle-t-on un plastique biosourcé et quelle est la différence avec les plastiques qui constituent les emballages de notre quotidien ?
Les « bioplastiques » désignent des polymères fabriqués à partir de la biomasse, partiellement ou totalement. D’origine végétale ou animale, les biopolymères peuvent provenir de différentes molécules comme la caséine du petit lait, d’acide lactique extrait de l’amidon de maïs, de chitosane présent dans les carapaces de crevettes… En fait, on distingue deux types de plastiques biosourcés. Il y a ceux qui imitent les matériaux pétrochimiques comme les « PE » ou « PET » qui constituent la majorité de nos emballages. Ces derniers polymères peuvent être obtenus à partir de pétrole ou de biomasse. Et puis il y a les nouveaux, les polymères « drop in » : ceux qui n’ont jamais été produits à partir de pétrole. Ces polymères « de rupture », biosourcés, sont souvent biodégradables. Concrètement sur le marché, il y a encore peu de bioplastiques. On estime qu’ils représentent 1 % à 2 % de la production mondiale.
Pourquoi ces matériaux « de rupture » peuvent-ils être une ressource intéressante pour le futur ?
Face à l’épuisement des stocks de ressources fossiles, ces matériaux promettent une certaine indépendance au pétrole, dont nous ne disposons pas directement en Europe. Cependant, cet affranchissement de la pétrochimie serait partiel, car pour extraire des éléments de la biomasse comme l’amidon de maïs, notre agriculture a besoin de carburant, de produits phytosanitaires généralement issus du pétrole… D'autre part, la plupart des biosourcés se dégradent plus facilement que les plastiques conventionnels. On peut imaginer des objets qui tirent parti de cette propriété comme les films de paillage pour l’agriculture, pour remplacer ceux en polyéthylène qui libèrent des microplastiques relativement stables dans les sols.
Pourquoi ces bioplastiques ne sont-ils pas plus largement développés ?
Dans le cadre du projet Bioloop, deux étudiants stagiaires ont étudié les freins qui empêchaient le développement de l’acide polyactique (PLA), un substitut utilisé pour des emballages alimentaires. Il semblerait que le problème soit davantage d’ordre économique et marketing. Benjamin Sandei, en 5e année en Sciences et Génie des Matériaux s’est d’abord intéressé à la recyclabilité du PLA. Il a pu montrer que c’était un polymère plutôt facile à recycler mécaniquement : malgré un petit jaunissement de la matière, les propriétés mécaniques restent bonnes. Donc sur le plan technologique, le PLA est recyclable, mais dans la tête des consommateurs, un plastique jauni peut correspondre à un matériau dégradé, potentiellement mauvais pour la santé. Les metteurs sur le marché pourraient donc être plus frileux à réutiliser ces matériaux, mal perçus par les consommateurs. D’un autre côté, les polymères biosourcés restent encore trop peu développés, limités à des applications de niche. Ils ne peuvent pas s’intégrer dans les filières traditionnelles de recyclage dont ils sont considérés comme des « perturbateurs ».
Donc les plastiques biosourcés ne sont finalement pas si écologiques qu’ils le laissent penser ?
À l’heure actuelle, un emballage biosourcé en polylactide (PLA) aura une fin de vie moins positive qu’un plastique pétrosourcé lorsqu'il s'agira de conserver le "stock matière" pour alimenter les industries. Récemment, la société Yumi, productrice de jus de fruits mettait sur le marché des bouteilles fabriquées à partir de PLA : elle s’est vu pénalisée par une taxe en raison du matériau utilisé, non compatible avec les infrastructures de recyclages actuelles. En fait, ces matériaux font face à une sorte de paradoxe où les entreprises voudraient bien faire en utilisant du biosourcé, mais d’un autre côté, le modèle n’est pas encore prêt à les accueillir. Les recycleurs attendent que les plastiques soient très utilisés par les metteurs en marché pour que leur recyclage soit rentable. Mais peut-on parier que le développement du PLA permettra de développer des filières de recyclage adaptées à ce dernier ? Léa Barbaut, en Master 2 Management de l'Innovation au sein du projet Bioloop a étudié la question : c’est un cercle vicieux aujourd’hui qu’il convient de transformer en un cercle vertueux.
Il faudrait donc tendre vers une économie circulaire pour que les bioplastiques soient vertueux. Quid de la loi anti-gaspillage qui fixe l’objectif de recycler 100 % des plastiques d’ici 2025 ?
Il est clair que pour avoir des économies d’échelle, il faut que ces matériaux de rupture émergent réellement. La diffusion de ces nouveaux polymères ne sera viable, tant sur le plan technologique qu'économique, que s’ils sont recyclables et recyclés. Tant qu’il n’y aura pas d’intérêt économique à les développer dans une perspective d’économie circulaire, ce sera difficile de basculer vers des filières spécifiques. C’est l’avis des économistes qui doivent nous guider dans l’orientation de nos recherches sur de nouveaux polymères. Dans tous les cas, il me semble important de souligner que le constat est toujours le même : une démarche durable implique de produire et consommer moins de plastiques, qu'ils soient issus de la biomasse ou du pétrole.
 Laboratoire De Nouveaux Polymères BIOsourcés pour une Économie Circulaire
Laboratoire De Nouveaux Polymères BIOsourcés pour une Économie CirculaireLe projet Bioloop (Projet PRIME - MITI du CNRS) est mené au sein de trois laboratoires : Ingénierie des Matériaux Polymères (INSA Lyon/Lyon1/CNRS), le Groupe de Recherche en Droit, Économie et Gestion (GREDEG) et le laboratoire Triangle (ENS Lyon/CNRS/Sciences Po Lyon/Lyon 2/Jean Monnet).
▪️ Plus d’informations : https://miti.cnrs.fr/projet-multi-quipe/bioloop/
------
[1] Ingénierie des Matériaux Polymères – IMP (INSA Lyon/Lyon1/CNRS

