
Vie de campus
« Plus jeune, face à ce banc de méduses, je me suis demandé, crédule : pourrions-nous en faire des bonbons ? »
Souvent perçues comme des créatures inquiétantes, les méduses fascinent autant qu’elles dérangent. Pourtant, pour Clément Turco, élève-ingénieur en 4ᵉ année de biotechnologies et bioinformatique à l’INSA Lyon, ces êtres marins représentent bien plus qu’un danger potentiel. Passionné depuis l’adolescence par ces organismes millénaires, il voit en elles une opportunité d’explorer l’altérité et de questionner notre rapport au vivant. De ses premières expériences scientifiques au lycée à son projet de film-documentaire, il nous invite à porter un nouveau regard sur ces mystérieux animaux, capables de prospérer dans des océans bouleversés par les activités humaines et le changement climatique.
Les méduses : des êtres redoutés qui fascinent
La méduse a mauvaise presse : piqûres parfois mortelles, invasions sur les plages, perturbatrices des infrastructures de haute technologie ou annihilatrices de production aquacole… Largement perçues comme des créatures indésirables ou dangereuses, les méduses peuplent les océans depuis des centaines de millions d’années. Dépourvus de cœur, de cerveau et d’os, ces êtres, appartenant à la famille du plancton, sont constitués d’une ombrelle et des filaments, qui leur permettent de se déplacer verticalement, portés par les courants marins. « Leur symétrie radiale les distingue des êtres vivants bilatéraux, comme les humains. L’organisme d’une méduse est vraiment fascinant : sans système nerveux central, elle peut tout de même compter sur un réseau neuronal qui lui permet de capter la lumière, sentir et se déplacer dans l’eau », explique Clément Turco.
Des créatures qui tirent parti du dérèglement climatique et de la disparition des espèces
Alors que les activités humaines font peser de graves conséquences sur la biodiversité marine et le climat, les méduses font partie des rares animaux marins à prospérer. Depuis plusieurs décennies, on observe une augmentation de leur nombre, aussi bien en France qu’à l’autre bout du monde. Et cette prolifération inquiète : selon un article publié par la Fondation de la Mer, « l’Homme offre aux méduses, un océan propice à leur prolifération ». En cause notamment : la disparition de leurs prédateurs naturels, les poissons, et la pollution des eaux par des engrais qui favorisent les algues et le développement du phyto- et du zooplancton. Dans la chaîne alimentaire et les océans, chaque organisme a sa place dans l’assiette d’un autre. Ainsi perturbée, la logique naturelle voit la population de méduses augmenter, une prolifération qui alerte sur les états de mauvaise santé de nos océans.
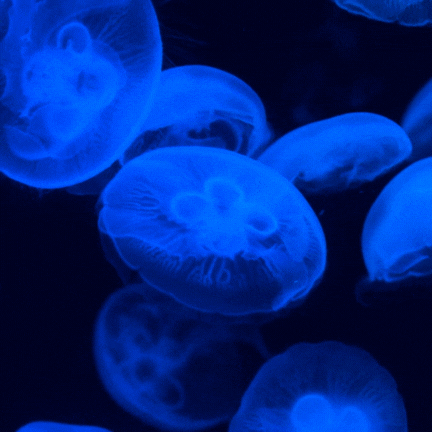
aurelia aurita, ou la méduse commune (Crédits : Unsplash)
Porter un autre regard sur la méduse
C’est à l’occasion d’une journée de voile avec son père que Clément Turco se passionne pour la méduse. Depuis son dériveur, il observe un banc d’Aurelia aurita, la méduse commune, qui remonte deux fois par jour à la surface l’été, pour se reproduire. « Face à ce banc, je me suis demandé, crédule : avec toute cette gélatine, ne pourrait-on pas faire des bonbons ? ». Alors âgé de 15 ans, Clément Turco a cherché à répondre à cette question lors de ses Travaux Personnels Encadrés (TPE), au lycée. « Sans grande surprise, nous n’avons pas réussi à extraire une gélatine assez pure pour en faire des bonbons… Mais cette expérience à sceller ma passion pour ces animaux », explique l’élève-ingénieur. Pendant plusieurs années, il s’en passionne et ira jusqu’à rencontrer Jacqueline Goy, ichtyologue française et spécialiste mondiale des méduses. Et il nourrit ainsi l’ambition de réaliser un documentaire. « Aujourd’hui, plus qu’un film documentaire, les méduses sont devenues un prétexte pour parler d’autre chose : ce qui m’a toujours impressionné chez elles, c’est leur incroyable différence d’environnement, de morphologie et de physiologie avec nous, humains. Parler des méduses, c’est parler d’altérité et même, d’aliénité. À force de les observer, j’ai compris qu’il ne serait jamais possible d’entrer en empathie avec ces êtres, ni de créer un langage commun. Et de toute façon, le langage est un pont imparfait entre deux individus qui se ressemblent. Ici, nous avons une forme de vie qui s’éloigne complètement de l’humanité, et c’est là que c’est intéressant de la questionner, car elle est radicalement différente. »
L’altérité : une réflexion au-delà de la biologie
Passionné de littérature, Clément Turco s’est aussi intéressé à l’approche narrative des documentaires « classiques ». « Un des défauts que l’on peut facilement reprocher aux documentaires, c’est leur tendance à l’anthropomorphisme. On plaque des comportements humains sur des animaux, ce qui en fait des films certes très sympathiques à visionner, mais qui à mon sens ratent l’objectif principal de ce qu’ils devraient véhiculer. À savoir : s’intéresser à d’autres formes de vies que la nôtre pour sortir de l’anthropocentrisme ».
Ainsi, pour créer un autre récit, il s’entoure d’amis spécialistes en cinéma expérimental et jette les premières pierres de son projet de film-documentaire. « Il conviendra de les filmer en utilisant un langage cinématographique nouveau, pour représenter cette altérité. Je souhaite que cette proposition offre au spectateur un questionnement de notre rapport au monde, pour élargir nos conceptions, héritées de notre biologie et de notre culture. À défaut de savoir un jour ce que ressentent d’autres êtres que nous, au moins pourrions-nous ressentir un peu plus grand le monde », conclut l’étudiant qui espère concrétiser son projet cinématographique avant la fin de ses études.
 [Conférence] Méduses et océans : comment représenter au cinéma des êtres et des milieux éloignés de l’humanité ?
[Conférence] Méduses et océans : comment représenter au cinéma des êtres et des milieux éloignés de l’humanité ?Fête de la Science 2024 - 12/10/2024
Intervenant : Clément Turco
Peut-on filmer le monde sous-marin et les organismes qui le composent avec des règles cinématographiques similaires à celles employées pour des sujets humains filmés sur la terre ferme ? De toute évidence, non. Parce que les méduses sont, par leur mode de vie et leurs comportements, par le milieu qui les accueille, une altérité aux sociétés humaines, il convient de les filmer en usant d’un langage cinématographique nouveau à même de proposer une représentation de cette altérité. La confrontation à l’altérité questionne notre rapport au monde, et peut nous permettre d’élargir nos conceptions, héritées de notre biologie et de notre culture. À défaut de savoir un jour ce que ressentent d’autres êtres que nous, au moins pourrons-nous ressentir un peu plus grand le monde… Cette conférence se propose donc de présenter les différences observées ainsi qu’une première présentation des règles cinématographiques élaborées en vue de la réalisation prochaine d’un film-documentaire.
Plus d’informations : https://www.insa-lyon.fr/fr/evenement/conference-meduses-et-oceans-comment-representer-au-cinema-etres-et-milieux-eloignes-l
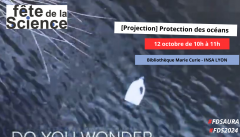
Sciences & Société
[Projection et débat] La protection des océans - Annulée
Intervention ANNULÉE // Projections de 2 films courts : "Plastic tracker " et "Les baleines changent le climat" qui sera suivi d'échanges avec des bénévoles de Seacleaners
Une animation proposée dans le cadre de la fête de la Science 2024.
Intervenants : bénévoles de Seacleaners
- « Plastics tracker » est une modélisation permettant de suivre un bidon en plastique qui passe de la rivière à l’océan, pour le suivre pendant 20 ans, et expliquer ainsi la constitution des Gyres (7ᵉ continent, ou continent de plastiques). Durée 30sec. Il s’ensuit un débat sur la dégradation des plastiques et son incidence sur le réchauffement climatique, les conséquences pour notre organisme ainsi que sur la faune en général.
- « Les baleines changent le climat » explique l’interaction entre baleines et plancton, ainsi que leur rôle dans notre écosystème et le réchauffement climatique. Durée 32 sec.
Información adicional
- scd.animation@insa-lyon.fr
- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/7059
-
INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie salle 202-203 au 2ᵉ étage
Palabras clave
Últimos eventos
UNITECH - Assemblée générale 2025
Desde 31 Ago Hasta 05 Sep
Sciences & Société
[Conférence] Méduses et océans : comment représenter au cinéma des êtres et des milieux éloignés de l’humanité ? - FDS2024
Peut-on filmer le monde sous-marin et les organismes qui le composent avec des règles cinématographiques similaires à celles employées pour des sujets humains filmés sur la terre ferme ?
Une animation proposée dans le cadre de la fête de la Science 2024.
Intervenant : Clément Turco
De toute évidence, non. Parce que les méduses sont, par leur mode de vie et leurs comportements, par le milieu qui les accueille, une altérité aux sociétés humaines, il convient de les filmer en usant d’un langage cinématographique nouveau à même de proposer une représentation de cette altérité. La confrontation à l’altérité questionne notre rapport au monde, et peut nous permettre d’élargir nos conceptions, héritées de notre biologie et de notre culture. À défaut de savoir un jour ce que ressentent d’autres êtres que nous, au moins pourrons-nous ressentir un peu plus grand le monde…
Cette conférence se propose donc de présenter les différences observées ainsi qu’une première présentation des règles cinématographiques élaborées en vue de la réalisation prochaine d’un film-documentaire.
Información adicional
- scd.animation@insa-lyon.fr
- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/7064
-
Hôtel de Ville de Lyon, Salon Louis XIII
Palabras clave
Últimos eventos
UNITECH - Assemblée générale 2025
Desde 31 Ago Hasta 05 Sep
Sciences & Société
[Exposition] Projet Manta- Conception d'un drone sous-marin - FDS 2024
Ce nouveau projet peut être possible grâce au soutien de la Fondation INSA Lyon et de son dispositif « Coups de pouce » qui permet de financer des projets technologiques, sportifs ou artistiques des élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon.
Une animation proposée dans le cadre de la fête de la Science 2024.
Vincent Olmeta, étudiant en 3ᵉ année à l’INSA Lyon au département Génie Mécanique, réalise un projet de sous-marin téléopéré à l’aide d’un câble (ROV) muni d’une caméra afin de filmer des espèces marines vivant à de grandes profondeurs (plus de 100 mètres). L’objectif est de pouvoir observer des créatures que l’on ne peut voir qu’au bout des hameçons comme les calamars par exemple. Le but est d’ainsi pouvoir observer les comportements de la faune sous-marine dans son milieu naturel.
Depuis longtemps, passionné par tout ce qui touche au monde aquatique, il a déjà réalisé le projet Oculus : un caisson en aluminium étanche à grande profondeur pour une lampe et un appareil photo. L’objectif était aussi de filmer les créatures des abysses. Cependant, le fait de ne pas voir en direct ce que l’on filme rend difficile le cadrage à faible profondeur et le rend impossible à grande profondeur. Il a donc voulu continuer le projet en le complexifiant afin de corriger ce problème.
Venez découvrir les différentes étapes de la conception d'un drone sous-marin : de la modélisation, en passant par les prototypes jusqu'à la version finale.
Información adicional
- scd.animation@insa-lyon.fr
- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/7058
-
INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie
Palabras clave
Últimos eventos
UNITECH - Assemblée générale 2025
Desde 31 Ago Hasta 05 Sep
Recherche
Chimie : quand les réponses sont dans le Pastis...
Partir de l’effet Ouzo pour conclure sur l’importance de la carbonatation de l’eau dans les émulsions : c’est toute la réflexion qui a propulsé l’un de nos chercheurs INSA sur le devant de la scène. Retour sur une croisade scientifique qui a déjà fait l’objet de deux publications.
Quel est le lien entre François Ganachaud, chercheur au laboratoire IMP (Ingénierie des Matériaux Polymères à l’INSA Lyon, et le Pastis ? Et bien, c’est l’effet Ouzo ! Ou l’effet Pastis pour les plus chauvins. C’est plus précisément le phénomène selon lequel une émulsion se forme spontanément lorsqu’on verse de l’eau dans un Pastis : l’alcool se dilue dans l’eau, la boisson se trouble et prend sa fameuse coloration laiteuse. Mais ce qui intéresse les scientifiques, c’est la partie cachée de l’iceberg. En effet, dans le pastis, il y a certes beaucoup d’alcool mais aussi une petite quantité d’anéthol, l’huile essentielle extraite de l’anis. Or, si l’alcool peut se mélanger à l’eau et à l’huile, en revanche, l’eau et l’huile, elles ne se mélangent pas, elles sont « non miscibles ».
« Pour se séparer de l’eau, l’huile ne démixe pas comme une vinaigrette par exemple, mais elle se disperse en gouttelettes qui se forment spontanément et restent en suspension dans l’ensemble du mélange eau/alcool. On génère une émulsion, ce qui donne à la boisson son aspect laiteux » explique François Ganachaud.
Les mélanges eau/huile/alcool ainsi étudiés et l’observation de ces micro-émulsions spontanées ouvrent de nouveaux horizons dans de nombreuses applications, dans le domaine de la pharmacie ou des cosmétiques par exemple.
De l’effet Ouzo aux interfaces avec l’eau
C’est lors de l’étude de ce procédé que François Ganachaud a poussé plus loin la réflexion, l’amenant à participer à un débat vieux de quarante ans.
« C’est une bagarre qui ne cesse de durer dans la communauté des physico-chimistes : la charge négative que l’on observe systématiquement aux interfaces entre l’eau et les composés hydrophobes » explique le chercheur.
Par « hydrophobe », comprenez « que l’eau ne mouille pas ». C’est par exemple l’huile, l’air, les lipides ou les polymères.
« C’est pour ça que la plupart des surfaces qui nous entourent (peau, cheveux, tissus, papier…) sont chargées négativement, mais on ne sait pas vraiment à cause de quoi » précise François Ganachaud. « Dans cette histoire, nous nous sommes intéressés à la chimie de l’eau, souvent très simplifiée. En particulier, dans l’eau, il y a des ions bicarbonates qui résultent de la carbonatation de l’eau et qui s’avèrent jouer un rôle plus important que l’on aurait pensé de prime abord. En effet, avec des chercheurs de plusieurs laboratoires*, nous avons découvert que la charge négative évoquée provenait de l’adsorption préférentielle de ces ions bicarbonates sur les surfaces. »
La fin de la bataille et le début de l’histoire ?
En allant à l’encontre de certaines croyances, François Ganachaud avoue qu’il s’attendait, à la publication de cette découverte il y a un an, à quelques droits de réponses bien sentis. Quelques mois plus tard et après une seconde publication sur le sujet, la découverte semble bénéficier d’une forme d’adhésion de la communauté scientifique.
« C’est une vision différente qui ouvre de nouvelles voies. On a par exemple compris comment se formait une émulsion dans un mélange huile/eau soumis à des cycles de gel et de dégel. Lors de la congélation, le dioxyde de carbone présent dans l’air est piégé avant de se transformer en ions bicarbonates, et les gouttelettes d’huile sont stabilisées par ces ions en se collant à leur surface. On imagine que la transformation de CO2 en bicarbonates par congélation de l’eau pourrait intéresser d’autres domaines d’études comme l’océanographie, notamment l’étude de la capture du CO2 par les océans aux pôles terrestres » conclut le chercheur.
Publications
X. Yan, A. Stocco, J. Bernard, F. Ganachaud
Freeze/Thaw-Induced Carbon Dioxide Trapping Promotes Emulsification of Oil in Water
Journal of Physical Chemical Letters – Octobre 2018
DOI: 10.1021/acs.jpclett.8b02919
X. Yan, M. Delgado, J. Aubry, O. Gribelin, A. Stocco, F. Boisson-Da Cruz, J. Bernard et F. Ganachaud
Central Role of Bicarbonate Anions in Charging Water/Hydrophobic Interfaces
Journal of Physical Chemistry Letters – Décembre 2017
DOI: 10.1021/acs.jpclett.7b02993
Photo (de gauche à droite) : Julien Bernard et François Ganachaud, chercheurs à l’IMP de l’INSA Lyon

