
Sciences & Société
Journée thématique MacroSEC2022
La plateforme lyonnaise de chromatographie liquide des polymères, portée par les laboratoires IMP et CP2M, organise une journée dédiée à la chromatographie d'exclusion stérique (SEC) et ses applications pour la caractérisation des polymères synthétiques et naturels.
Cette manifestation scientifique a pour but de rassembler des académiques et des industriels autour de cette thématique par le biais de conférences.
Elle sera complétée par une demie journée de formation sur la « SEC appliquée à la caractérisation de polymères » à destination des doctorants des Écoles Doctorales « Matériaux », « Chimie », et « Sciences Ingénierie Santé », le vendredi 7 octobre 2022 dont le programme sera :
10h00 - 11h30 : Principe de la SEC, principaux détecteurs couplés à la SEC, intérêts pour la caractérisation des polymères, quelques aspects pratiques. Intervenantes : Marion COLELLA (IMP), Caroline PILLON (IMP)
11h30 - 12h00 : Table ronde - Temps de discussion entre les participant/e/s et l'équipe organisatrice de MacroSEC 2022. Intervenant/e/s : Olivier BOYRON (CP2M), Marion COLELLA (IMP), Agnès CRÉPET (IMP), Catherine LADAVIÈRE (IMP), Caroline PILLON (IMP), Manel TAAM (CP2M).
Le contact pour s’inscrire à cette demie journée de formation est : odile.brasier@univ-lyon1.fr
Información adicional
-
CPE Lyon - Amphithéâtre - Campus LyonTech-La Doua Villeurbanne
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Recherche
« Certains plastiques biosourcés sont considérés comme des perturbateurs du recyclage »
Depuis quelques années, des nouveaux matériaux polymères ont fait leur apparition. Biosourcés, ils offriraient une alternative aux plastiques conventionnels. Mais sont-ils vraiment plus écologiques ? Valérie Massardier, chercheure au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères1 est co-porteure du projet « Bioloop ». Menée en collaboration avec deux autres laboratoires, le GREDEG et Triangle, l’étude s’attache à montrer les freins dans le développement des bioplastiques. Pourquoi nos emballages à usage unique ne sont-ils pas (encore) tous fabriqués en plastique biosourcé ? Valérie Massardier répond.
 Qu’appelle-t-on un plastique biosourcé et quelle est la différence avec les plastiques qui constituent les emballages de notre quotidien ?
Qu’appelle-t-on un plastique biosourcé et quelle est la différence avec les plastiques qui constituent les emballages de notre quotidien ?
Les « bioplastiques » désignent des polymères fabriqués à partir de la biomasse, partiellement ou totalement. D’origine végétale ou animale, les biopolymères peuvent provenir de différentes molécules comme la caséine du petit lait, d’acide lactique extrait de l’amidon de maïs, de chitosane présent dans les carapaces de crevettes… En fait, on distingue deux types de plastiques biosourcés. Il y a ceux qui imitent les matériaux pétrochimiques comme les « PE » ou « PET » qui constituent la majorité de nos emballages. Ces derniers polymères peuvent être obtenus à partir de pétrole ou de biomasse. Et puis il y a les nouveaux, les polymères « drop in » : ceux qui n’ont jamais été produits à partir de pétrole. Ces polymères « de rupture », biosourcés, sont souvent biodégradables. Concrètement sur le marché, il y a encore peu de bioplastiques. On estime qu’ils représentent 1 % à 2 % de la production mondiale.
Pourquoi ces matériaux « de rupture » peuvent-ils être une ressource intéressante pour le futur ?
Face à l’épuisement des stocks de ressources fossiles, ces matériaux promettent une certaine indépendance au pétrole, dont nous ne disposons pas directement en Europe. Cependant, cet affranchissement de la pétrochimie serait partiel, car pour extraire des éléments de la biomasse comme l’amidon de maïs, notre agriculture a besoin de carburant, de produits phytosanitaires généralement issus du pétrole… D'autre part, la plupart des biosourcés se dégradent plus facilement que les plastiques conventionnels. On peut imaginer des objets qui tirent parti de cette propriété comme les films de paillage pour l’agriculture, pour remplacer ceux en polyéthylène qui libèrent des microplastiques relativement stables dans les sols.
Pourquoi ces bioplastiques ne sont-ils pas plus largement développés ?
Dans le cadre du projet Bioloop, deux étudiants stagiaires ont étudié les freins qui empêchaient le développement de l’acide polyactique (PLA), un substitut utilisé pour des emballages alimentaires. Il semblerait que le problème soit davantage d’ordre économique et marketing. Benjamin Sandei, en 5e année en Sciences et Génie des Matériaux s’est d’abord intéressé à la recyclabilité du PLA. Il a pu montrer que c’était un polymère plutôt facile à recycler mécaniquement : malgré un petit jaunissement de la matière, les propriétés mécaniques restent bonnes. Donc sur le plan technologique, le PLA est recyclable, mais dans la tête des consommateurs, un plastique jauni peut correspondre à un matériau dégradé, potentiellement mauvais pour la santé. Les metteurs sur le marché pourraient donc être plus frileux à réutiliser ces matériaux, mal perçus par les consommateurs. D’un autre côté, les polymères biosourcés restent encore trop peu développés, limités à des applications de niche. Ils ne peuvent pas s’intégrer dans les filières traditionnelles de recyclage dont ils sont considérés comme des « perturbateurs ».
Donc les plastiques biosourcés ne sont finalement pas si écologiques qu’ils le laissent penser ?
À l’heure actuelle, un emballage biosourcé en polylactide (PLA) aura une fin de vie moins positive qu’un plastique pétrosourcé lorsqu'il s'agira de conserver le "stock matière" pour alimenter les industries. Récemment, la société Yumi, productrice de jus de fruits mettait sur le marché des bouteilles fabriquées à partir de PLA : elle s’est vu pénalisée par une taxe en raison du matériau utilisé, non compatible avec les infrastructures de recyclages actuelles. En fait, ces matériaux font face à une sorte de paradoxe où les entreprises voudraient bien faire en utilisant du biosourcé, mais d’un autre côté, le modèle n’est pas encore prêt à les accueillir. Les recycleurs attendent que les plastiques soient très utilisés par les metteurs en marché pour que leur recyclage soit rentable. Mais peut-on parier que le développement du PLA permettra de développer des filières de recyclage adaptées à ce dernier ? Léa Barbaut, en Master 2 Management de l'Innovation au sein du projet Bioloop a étudié la question : c’est un cercle vicieux aujourd’hui qu’il convient de transformer en un cercle vertueux.
Il faudrait donc tendre vers une économie circulaire pour que les bioplastiques soient vertueux. Quid de la loi anti-gaspillage qui fixe l’objectif de recycler 100 % des plastiques d’ici 2025 ?
Il est clair que pour avoir des économies d’échelle, il faut que ces matériaux de rupture émergent réellement. La diffusion de ces nouveaux polymères ne sera viable, tant sur le plan technologique qu'économique, que s’ils sont recyclables et recyclés. Tant qu’il n’y aura pas d’intérêt économique à les développer dans une perspective d’économie circulaire, ce sera difficile de basculer vers des filières spécifiques. C’est l’avis des économistes qui doivent nous guider dans l’orientation de nos recherches sur de nouveaux polymères. Dans tous les cas, il me semble important de souligner que le constat est toujours le même : une démarche durable implique de produire et consommer moins de plastiques, qu'ils soient issus de la biomasse ou du pétrole.
 Laboratoire De Nouveaux Polymères BIOsourcés pour une Économie Circulaire
Laboratoire De Nouveaux Polymères BIOsourcés pour une Économie CirculaireLe projet Bioloop (Projet PRIME - MITI du CNRS) est mené au sein de trois laboratoires : Ingénierie des Matériaux Polymères (INSA Lyon/Lyon1/CNRS), le Groupe de Recherche en Droit, Économie et Gestion (GREDEG) et le laboratoire Triangle (ENS Lyon/CNRS/Sciences Po Lyon/Lyon 2/Jean Monnet).
▪️ Plus d’informations : https://miti.cnrs.fr/projet-multi-quipe/bioloop/
------
[1] Ingénierie des Matériaux Polymères – IMP (INSA Lyon/Lyon1/CNRS

Sciences & Société
Les polymères se réinventent sans cesse, quel avenir pour les plastiques ?
Conférence dans le cadre du cycle "Pour le Développement des Sciences et de l'Innovation (PDSI) au service des Transitions"
Avec l'intervention de :
- Jean-François Gerard, professeur à l'INSA Lyon et directeur adjoint de l'Institut de Chimie du CNRS
- Alain Marty, directeur scientifique de la société CARBIOS
Les "plastiques" sont partout dans notre quotidien et il est bien difficile de nous en passer. Quelles sont les évolutions en cours au regard de leurs spécificités, des usages et des enjeux industriels et économiques ?
+d'infos => https://bit.ly/33v7q5H
Gratuit sur inscription
Información adicional
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Recherche
Innovation for Humanity : innover pour réparer l’humain
« À l’heure actuelle, des millions de personnes à travers le monde ont besoin d’une prothèse mais n’y ont pas accès en raison du coût matériel, du manque de ressources humaines expertes et de la difficulté à se déplacer dans un centre de santé. » Tel est le constat énoncé par Pierre Gallien, directeur innovation, impact & information d’Handicap International.
La réadaptation physique et fonctionnelle est le premier sujet de recherche qui amorcera les collaborations scientifiques menées dans le cadre d’une alliance unissant le Groupe INSA et la Fédération Handicap International. Dans le cadre de la chaire de recherche et d’enseignement « Innovation for Humanity » lancée le 28 janvier prochain, les chercheurs de l’INSA auront pour objectif de répondre aux problématiques rencontrées par les équipes de l’organisation humanitaire. Abder Banoune et Jérôme Chevalier, tous deux impliqués dans cette chaire, expliquent comment la recherche peut participer à restaurer l’intégrité physique des personnes handicapées, avec une contrainte : celle de faire « avec ce qu’il y a sur place ».
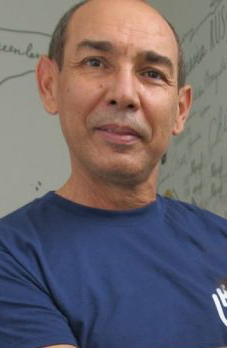 Dans le monde et selon l’Organisation Mondiale de la Santé, seulement 5% à 15% des personnes ayant besoin de technologie d’assistance (fauteuils, prothèses et orthèses, aides à la mobilité aides auditives et visuelles) y ont accès. Accompagner les personnes handicapées vers l’autonomie est le métier originel d’Handicap International, et malgré plus de 40 ans d’action, les défis humanitaires restent nombreux. Abder Banoune, spécialiste de la réadaptation physique au sein de l’ONG, explique. « L’une de nos missions fondamentales est d’accompagner des personnes victimes à récupérer une mobilité optimale. Nous intervenons principalement dans des pays frappés par des conflits, des catastrophes naturelles ou une extrême pauvreté et où l’accès à des prothèses ou des orthèses est rendu difficile. Aujourd’hui, pour rendre une prothèse disponible, nous avons besoin d’équipements lourds et d’équipes très qualifiées, ce qui est souvent incompatible avec les situations des pays dans lesquels nous intervenons. »
Dans le monde et selon l’Organisation Mondiale de la Santé, seulement 5% à 15% des personnes ayant besoin de technologie d’assistance (fauteuils, prothèses et orthèses, aides à la mobilité aides auditives et visuelles) y ont accès. Accompagner les personnes handicapées vers l’autonomie est le métier originel d’Handicap International, et malgré plus de 40 ans d’action, les défis humanitaires restent nombreux. Abder Banoune, spécialiste de la réadaptation physique au sein de l’ONG, explique. « L’une de nos missions fondamentales est d’accompagner des personnes victimes à récupérer une mobilité optimale. Nous intervenons principalement dans des pays frappés par des conflits, des catastrophes naturelles ou une extrême pauvreté et où l’accès à des prothèses ou des orthèses est rendu difficile. Aujourd’hui, pour rendre une prothèse disponible, nous avons besoin d’équipements lourds et d’équipes très qualifiées, ce qui est souvent incompatible avec les situations des pays dans lesquels nous intervenons. »
Les promesses de l’impression 3D
Après des analyses de terrain, les équipes d’Handicap International ont réalisé le potentiel de l’impression 3D. Des projets pilotes ont démontré que cette technologie pouvait notamment répondre à une problématique logistique de taille. « Lorsqu’un patient a besoin d’un appareillage orthopédique, il doit se rendre dans un centre médical situé dans les grandes villes. S’il vit dans une zone rurale ou de montagne, l’accès au centre peut s’avérer compromis. L’impression 3D nous permet de nous rapprocher au plus près des personnes dans le besoin : avec un simple ordinateur et un scanner nous pouvons prendre les mesures physiologiques des patients et envoyer les données à un centre de fabrication dans les grandes villes. Mais pour ouvrir cette technologie à plus de personnes, nous avons ici besoin de la recherche », poursuit Abder.
Identifier des axes de recherche scientifique pour soigner plus de patients
 Au cours des derniers mois, les laboratoires et les équipes les plus pertinentes sur le sujet de l’impression 3D de prothèses et orthèses ont été sollicités. Parmi les laboratoires identifiés, l’IMP1, spécialiste des polymères ; le laboratoire MATEIS2, expert dans le domaine des propriétés mécaniques et de la durabilité des matériaux ; et le LaMCoS3, pour son expertise sur la conception et la fabrication additive. « Avec Christophe Garcia, également porteur de la chaire, nous avons pour mission de traduire la feuille de route transmise par Handicap International en projets de recherche. Après avoir identifié les besoins, nous allons transformer chaque sujet en projets de fin d’études et en thèses de doctorat. Il est essentiel d’impliquer les étudiants, d’une part car ils sont très demandeurs de ces sujets porteurs de sens et d’autre part parce qu’ils ont aussi de belles idées qui méritent d’être développées », dit Jérôme Chevalier, enseignant-chercheur adjoint à la direction de la recherche de l’INSA Lyon et porteur de la chaire.
Au cours des derniers mois, les laboratoires et les équipes les plus pertinentes sur le sujet de l’impression 3D de prothèses et orthèses ont été sollicités. Parmi les laboratoires identifiés, l’IMP1, spécialiste des polymères ; le laboratoire MATEIS2, expert dans le domaine des propriétés mécaniques et de la durabilité des matériaux ; et le LaMCoS3, pour son expertise sur la conception et la fabrication additive. « Avec Christophe Garcia, également porteur de la chaire, nous avons pour mission de traduire la feuille de route transmise par Handicap International en projets de recherche. Après avoir identifié les besoins, nous allons transformer chaque sujet en projets de fin d’études et en thèses de doctorat. Il est essentiel d’impliquer les étudiants, d’une part car ils sont très demandeurs de ces sujets porteurs de sens et d’autre part parce qu’ils ont aussi de belles idées qui méritent d’être développées », dit Jérôme Chevalier, enseignant-chercheur adjoint à la direction de la recherche de l’INSA Lyon et porteur de la chaire.
De l’optimisation de la prothèse imprimée…
Pour les chercheurs, la question est donc posée : comment optimiser l’impression 3D de prothèses et d’orthèses, pour soigner plus de patients dans le besoin ? De l’élaboration à la résistance des matériaux, en passant par la durabilité des composants ou l’optimisation des formes et des architectures, les challenges scientifiques sont nombreux. « D’abord, nous souhaiterions travailler à l’optimisation des prothèses en elles-mêmes. Aujourd’hui, elles sont fabriquées par thermoformage et avec des matériaux qui ne sont pas toujours disponibles dans les pays d’intervention d’Handicap International. La fabrication additive par impression 3D permet d’étudier de nouvelles possibilités de formes et d’évaluer l’utilisation de matières premières accessibles localement », explique Jérôme Chevalier également chercheur au laboratoire MATEIS.

… à une imagerie médicale adaptée.
Dans un second temps, c’est la question de l’imagerie qui sera traitée par les équipes de chercheurs. « Pour fabriquer une prothèse de façon classique, il faut reproduire la partie du corps faisant défaut avec un moule de plâtre. Aujourd’hui, dans les pays d’intervention, ce matériau une fois utilisé, est directement jeté. Le recyclage des déchets induits par la fabrication de prothèses et d’orthèses est un vrai sujet. L’impression 3D limiterait la production de déchets, voire permettrait de réutiliser certains déchets plastiques. Nous pourrions aussi imaginer prendre les mesures physiologiques sur place, directement avec l’appareil photo d’un téléphone portable au lieu d’un scanner. À partir de cela, il n’y aurait plus besoin de plâtre. Pour arriver à cela, nos équipes devront travailler à la traduction de l’empreinte 3D en modèle pour les imprimantes », poursuit l’enseignant-chercheur.

Quatre années pour la recherche au service de causes humanitaires
Alors que le premier volet de la chaire de recherche unissant l’INSA et Handicap International commence à prendre corps, « Innovation for Humanity » ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Signée pour 4 ans minimum, la collaboration donnera lieu à des recherches sur l’utilisation de drones pour déminage, l’analyse d’images et de données et plus généralement l’apport des sciences numériques, avec pour même objectif de faire émerger des enjeux scientifiques aux problématiques rencontrées sur le terrain par les équipes de l’organisation internationale. « Le monde évolue, il doit en aller de même pour nos formations et notre recherche. L’humanitaire doit également profiter de nos recherches », conclut Jérôme Chevalier.
1 Laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (CNRS / UdL / Lyon1 / UJM / INSA Lyon)
2 Matériaux : ingénierie et sciences (INSA Lyon/ CNRS / Lyon 1)
3 Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon / CNRS / UdL)

Formation
Main dans la main avec les petites entreprises : le projet de fin d'études solidaire
Camille, Hugo et Corina sont trois étudiants du département science et génie des matériaux (SGM) de l’INSA Lyon. Dans le cadre de leurs projets de fin d’études, ils vont accompagner trois petites et moyennes entreprises à haut potentiel de développement technologique dans un contexte de relance économique post-confinement. Focus sur une démarche solidaire initiée par le département et le laboratoire IMP1.
Période de reprise économique oblige, le laboratoire IMP et le département SGM de l’INSA Lyon ont réfléchi ensemble à la poursuite des activités partenariales de recherche, développement et innovation (R&DI) avec les entreprises, fortement impactées par les mesures prises pour lutter contre la pandémie. « En temps normal à l’INSA Lyon, il y a beaucoup de projets de fin d’études en lien avec les industriels, grâce à des petits contrats permettant de couvrir les frais nécessaires à l’aboutissement du projet. Cependant, la reprise post-confinement a fait naître beaucoup d’inquiétudes sur la R&DI, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Bien souvent, l’option choisie est d’abandonner l’innovation pour résoudre des problèmes de trésorerie », explique Jean-François Gérard, professeur au département SGM et vice-président du pôle de compétitivité AXELERA.
Face à constat critique, le département SGM et le laboratoire IMP ont décidé de soutenir et d'accompagner les travaux de R&DI de trois petites entreprises dont le contexte économique a bouleversé les démarches d’innovation, sans leur demander d’engagement financier. Une initiative solidaire est proposée aux étudiants de 5e année du département science et génie des matériaux dans le cadre de leurs projets de fin d'études, qui prennent la forme de projets individuels d'initiation à la recherche dans ce département et se déroulent de la mi-septembre 2020 à la mi-mars 2021.
Camille, Corina et Hugo sont séduits. « L’occasion de travailler aux côtés d’une entreprise à haut potentiel de développement technologique m’a attiré. Je n’ai pas pu réaliser de stage l’an dernier à cause de la situation sanitaire, j’attends beaucoup de ce PFE », indique Hugo Boufouchk. Enthousiaste, l’élève va travailler plusieurs mois avec la start-up Laclarée sur la conception de lunettes adaptives, et plus précisément sur le sujet d’optimisation de l’indice de réfraction d’un matériau pour verre de correction ophtalmique. Camille Godinot, et Corina Lanovaia parient, elles, sur l’avenir. Camille va collaborer avec une start-up en cours de création, Quiet, et s’intéresser aux différentes propriétés du silicone. « C’est un matériau qui est beaucoup utilisé dans le domaine du biomédical, domaine qui m’intéresse beaucoup, notamment sur les problématiques de biocompatibilité et ingénierie tissulaire. Je suis très contente de faire mon PFE sur un sujet concret, avec une entreprise en plus en cours de création ! », partage la future ingénieure. Corina, elle, s’apprête à accompagner une PME en pleine expansion, Lavoisier Composites, sur des problématiques de valorisation de sous-produits issus de la production de l’industrie de matériaux composites. Elle espère, une fois diplômée, travailler sur des matériaux haute performance pour diverses applications dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile ou du luxe. « J’ai choisi de travailler avec Lavoisier Composites parce que c’est l’opportunité pour moi d’obtenir une première expérience de travail avec les matériaux composites de haute performance. Et l’idée de participer à l’extension d’une start-up est très valorisante », précise-t-elle.
Pour les trois entreprises bénéficiaires de cette démarche, l’innovation est fondamentale à leur existence sur le marché, comme l’explique Guillaume Loiseau, co-fondateur de Lavoisier Composites. « Nous consacrons la quasi intégralité de notre temps au développement de nouveaux matériaux. Sans ce PFE, nous aurions dû reporter ce développement et nous aurions certainement moins appris. En ces temps si particuliers où le monde se réinvente, l’innovation collaborative est primordiale pour anticiper les évolutions de la société. »
Pour le département SGM, l’enjeu est important. D’autres actions de soutien aux TPE, PME et start-up seront prochainement engagées, notamment dans le cadre de projets collectifs. « Dans le contexte sanitaire et économique actuel, nous nous inquiétions de perdre le lien avec l'entreprise qui est clé pour la formation et l'insertion professionnelle de nos élèves, grâce à des projets comme les PFE, les projets collectifs ou encore les stages. Cette démarche est aussi un moyen d'engager nos élèves et le département dans une démarche de solidarité vis-à-vis des entreprises, notamment les plus fragiles », conclut Frédéric Lortie, directeur adjoint du département SGM de l’INSA Lyon.
À l'INSA Lyon, la formation des élèves se termine généralement par un « projet de fin d'études » (PFE), travail de recherche ou de recherche-développement, réalisé en individuel ou par très petits groupes sur 4 à 6 mois équivalent temps plein.
Les PFE se déroulent dans un laboratoire de l'INSA Lyon ou en entreprise. Dans tous les cas, ils sont suivis et encadrés par des enseignants chercheurs de l'INSA Lyon et donnent lieu à un rapport et une soutenance.
[1] Ingénierie des Matériaux Polymères (INSA Lyon/UdL/CNRS)

Recherche
Hommage à Jean-Pierre Pascault
Jean-Pierre Pascault, Professeur Emérite à l’INSA Lyon, Commandeur dans l’ordre des Palmes Académiques, s’est éteint ce samedi 4 avril 2020.
C’est à son établissement qu’il a consacré une grande partie de sa vie en contribuant à la fois à la qualité, désormais reconnue, de la formation des ingénieurs INSA et à faire de l’école un grand centre de recherches. C’est en effet après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur chimiste en 1965 puis un doctorat ès sciences sur la polymérisation anionique, qu’il l’a rejoint, dès 1966 comme assistant et en 1972 comme maître-assistant et enfin comme professeur des universités en 1983, et s’est investi pour faire ce qu’est l’INSA Lyon d’aujourd’hui. Fortement attaché à son établissement, il s’est toujours impliqué dans sa vie collective et son animation ayant été successivement membre élu de son conseil d’administration (1976-1980) et de son conseil scientifique (1982-1986). Attaché à la transmission des connaissances au plus près des derniers développements de la science mais aussi des préoccupations applicatives avec de forts liens avec l’industrie, il a construit une véritable école des polymères de Lyon avec de réelles spécificités reconnues nationalement et internationalement. La recherche ne pouvait être dissociée de la formation qu’il a marquée au sein des successifs départements ‘Matériaux’ de l’INSA Lyon et par ses enseignements en DEA puis master du site mais aussi dans le cadre de la commission pédagogique du GFP (groupement français d’études & d’applications des polymères, société savante dans le domaine des polymères) dont il a été le président de 2001 à 2004.
C’est un grand scientifique, passionné, rigoureux, inventif, peu attaché aux honneurs qu’était Jean-Pierre Pascault. Chercheur internationalement reconnu, il a apporté des contributions significatives dans de nombreux champs de la science des polymères : chimies macromoléculaires notamment celles des réseaux polymère, polymères dynamiques, design de morphologies à toutes échelles par la maîtrise de processus chimiques et thermodynamiques, mise en situation dans les procédés d’élaboration et mise en forme, utilisation de composés biosourcés… Tous ses travaux fondamentaux n’ont jamais été guidés par la recherche d’une mise en lumière qui n’aurait pas été justifiée par de réelles avancées applicatives, en particulier transposables en milieu industriel. Tout en ayant publié plus de 350 publications, deux ouvrages de référence et près de 300 communications, il est ainsi auteur de 50 brevets. Cette recherche, il a aimé la faire en particulier avec les 60 doctorants qu’il a encadré et auxquels il a beaucoup donné, à la fois en les guidant au jour le jour dans leurs travaux avec une grande attention, veillant à la qualité, à l’inventivité et à la rigueur de ces derniers mais aussi en leur offrant une proximité qui a fait que beaucoup d’entre eux ne sont pas de simples anciens docteurs mais sont devenus ses amis. Comme pour son établissement et la formation, Jean-Pierre Pascault s’est attaché tout au long de sa vie à construire l’environnement le plus favorable pour les chercheurs et faire vivre la vie scientifique collective. Élu au comité national de la recherche scientifique (CoNRS) pour deux mandats (1980-1986 et 1990-1994) mais aussi au conseil national des universités (CNU S33) de 2000 à 2003, il a porté avec une voix particulière faite de bienveillance et d’exigence, la défense d’une conception de la science au sein de laquelle chaque chercheur, avec ses approches et domaines particuliers, puisse y trouver sa place et s’y épanouir. C’est ainsi qu’il a aussi très tôt, de 1982 à 1992, dirigé l’Unité de recherche associée au CNRS, aujourd’hui l’UMR CNRS 5223 ‘Ingénierie des Matériaux Polymères’ et son antenne à l’INSA Lyon jusqu’en 1997 mais aussi créé la Fédération des Polyméristes Lyonnais (FR 2151) en 2000, structure qui allait servir de base avec son centre commun de RMN à la naissance de la FR Institut de Chimie de Lyon.
Aujourd’hui, l’unité IMP doit beaucoup à Jean-Pierre Pascault car il contribué, grâce à son rayonnement scientifique attesté par les nombreuses conférences et congrès auxquels il a été invité ou organisé, à construire un laboratoire internationalement reconnu, extrêmement visible à la fois sur ses travaux scientifiques mais aussi sur son positionnement avec le milieu des entreprises. C’est l’identité même de l’unité qu’on lui doit, faite de recherches originales, d’une organisation spécifique et de cette proximité avec l’Industrie mais aussi une manière de faire de la recherche au sein d’un collectif fort et passionné. Les entreprises, grands groupes mais aussi et surtout PME et PMI, ont aujourd’hui perdu un grand soutien et collaborateur au sein de la communauté académique car Jean-Pierre Pascault a toujours défendu que participer à résoudre des problématiques technologiques pouvait permettre de s’engager sur des questions scientifiques originales. Nombre d’entreprises ont travaillé avec lui sur de grands projets qui ont abouti à développer de nouveaux produits mais aussi à s’engager, grâce à son pouvoir de conviction, dans de nouvelles activités. C’est ainsi qu’il s’était fortement impliqué et était encore très récemment extrêmement actif auprès des pôles de compétitivité qui portent le tissu des entreprises de la plasturgie et des textile techniques au sein de leurs conseils scientifiques, soucieux de défendre les projets que portaient ces derniers. On ne saurait aussi parler de Jean-Pierre Pascault sans revenir sur les relations internationales qu’il a généré grâce à la renommée de ses travaux mais aussi de sa propension à découvrir d’autres pratiques pour faire la Science et à nouer des liens avec d’autres chercheurs qui sont pour la plupart devenus des amis très proches. Ces liens forts et pérennes à travers les décennies, il a su les offrir aux plus jeunes chercheurs pour qu’eux aussi s’enrichissent d’autres cultures. Les nombreuses collaborations d’aujourd’hui, certaines concrétisées sous la forme de réseaux reconnus et actifs, ou d’implications dans des sociétés savantes internationales, notamment européennes, sont pour l’essentiel issues de son engagement dans ce partage. La communauté scientifique des polymères à travers l’Europe et plus largement dans le Monde, a perdu un chercheur apprécié de toutes et tous et un grand ami.
Jean-François Gérard, enseignant-chercheur de l’INSA Lyon

Sciences & Société
Colloque de l’Association PolyRay - ANNULÉ
Poursuivre et pérenniser les échanges autour de la polymérisation sous rayonnement.
Au programme :
- La polymérisation sous rayonnement UV-Visible et haute énergie (plasma, e-beam, γ, RX, Switch Heavy Ions…)
- Les procédés, notamment les technologies LED et la fabrication additive
- Les matériaux et les relations structures-propriétés-applications.
Nouveauté ! PolyRay 2020 propose de participer à un short-course (programme pédagogique destiné aux ingénieurs, techniciens, doctorants et chercheurs) avant le démarrage du colloque.
--------------------
Le colloque PolyRay 2020 sera organisé conjointement par l’Association PolyRay, le Laboratoire d’Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP) de l’INSA Lyon et les sociétés Elkem et Ionisos, en partenariat avec le GFP à l’occasion de ‘2020 : Une année ‘Polymère’ et le GFP 50 ans’.
Información adicional
- http://www.polyray.fr/fr/colloque-polyray-2020/
-
Amphithéâtre Emilie du Châtelet - Bibliothèque INSA Lyon - Villeurbanne
Palabras clave
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Recherche
Chimie : quand les réponses sont dans le Pastis...
Partir de l’effet Ouzo pour conclure sur l’importance de la carbonatation de l’eau dans les émulsions : c’est toute la réflexion qui a propulsé l’un de nos chercheurs INSA sur le devant de la scène. Retour sur une croisade scientifique qui a déjà fait l’objet de deux publications.
Quel est le lien entre François Ganachaud, chercheur au laboratoire IMP (Ingénierie des Matériaux Polymères à l’INSA Lyon, et le Pastis ? Et bien, c’est l’effet Ouzo ! Ou l’effet Pastis pour les plus chauvins. C’est plus précisément le phénomène selon lequel une émulsion se forme spontanément lorsqu’on verse de l’eau dans un Pastis : l’alcool se dilue dans l’eau, la boisson se trouble et prend sa fameuse coloration laiteuse. Mais ce qui intéresse les scientifiques, c’est la partie cachée de l’iceberg. En effet, dans le pastis, il y a certes beaucoup d’alcool mais aussi une petite quantité d’anéthol, l’huile essentielle extraite de l’anis. Or, si l’alcool peut se mélanger à l’eau et à l’huile, en revanche, l’eau et l’huile, elles ne se mélangent pas, elles sont « non miscibles ».
« Pour se séparer de l’eau, l’huile ne démixe pas comme une vinaigrette par exemple, mais elle se disperse en gouttelettes qui se forment spontanément et restent en suspension dans l’ensemble du mélange eau/alcool. On génère une émulsion, ce qui donne à la boisson son aspect laiteux » explique François Ganachaud.
Les mélanges eau/huile/alcool ainsi étudiés et l’observation de ces micro-émulsions spontanées ouvrent de nouveaux horizons dans de nombreuses applications, dans le domaine de la pharmacie ou des cosmétiques par exemple.
De l’effet Ouzo aux interfaces avec l’eau
C’est lors de l’étude de ce procédé que François Ganachaud a poussé plus loin la réflexion, l’amenant à participer à un débat vieux de quarante ans.
« C’est une bagarre qui ne cesse de durer dans la communauté des physico-chimistes : la charge négative que l’on observe systématiquement aux interfaces entre l’eau et les composés hydrophobes » explique le chercheur.
Par « hydrophobe », comprenez « que l’eau ne mouille pas ». C’est par exemple l’huile, l’air, les lipides ou les polymères.
« C’est pour ça que la plupart des surfaces qui nous entourent (peau, cheveux, tissus, papier…) sont chargées négativement, mais on ne sait pas vraiment à cause de quoi » précise François Ganachaud. « Dans cette histoire, nous nous sommes intéressés à la chimie de l’eau, souvent très simplifiée. En particulier, dans l’eau, il y a des ions bicarbonates qui résultent de la carbonatation de l’eau et qui s’avèrent jouer un rôle plus important que l’on aurait pensé de prime abord. En effet, avec des chercheurs de plusieurs laboratoires*, nous avons découvert que la charge négative évoquée provenait de l’adsorption préférentielle de ces ions bicarbonates sur les surfaces. »
La fin de la bataille et le début de l’histoire ?
En allant à l’encontre de certaines croyances, François Ganachaud avoue qu’il s’attendait, à la publication de cette découverte il y a un an, à quelques droits de réponses bien sentis. Quelques mois plus tard et après une seconde publication sur le sujet, la découverte semble bénéficier d’une forme d’adhésion de la communauté scientifique.
« C’est une vision différente qui ouvre de nouvelles voies. On a par exemple compris comment se formait une émulsion dans un mélange huile/eau soumis à des cycles de gel et de dégel. Lors de la congélation, le dioxyde de carbone présent dans l’air est piégé avant de se transformer en ions bicarbonates, et les gouttelettes d’huile sont stabilisées par ces ions en se collant à leur surface. On imagine que la transformation de CO2 en bicarbonates par congélation de l’eau pourrait intéresser d’autres domaines d’études comme l’océanographie, notamment l’étude de la capture du CO2 par les océans aux pôles terrestres » conclut le chercheur.
Publications
X. Yan, A. Stocco, J. Bernard, F. Ganachaud
Freeze/Thaw-Induced Carbon Dioxide Trapping Promotes Emulsification of Oil in Water
Journal of Physical Chemical Letters – Octobre 2018
DOI: 10.1021/acs.jpclett.8b02919
X. Yan, M. Delgado, J. Aubry, O. Gribelin, A. Stocco, F. Boisson-Da Cruz, J. Bernard et F. Ganachaud
Central Role of Bicarbonate Anions in Charging Water/Hydrophobic Interfaces
Journal of Physical Chemistry Letters – Décembre 2017
DOI: 10.1021/acs.jpclett.7b02993
Photo (de gauche à droite) : Julien Bernard et François Ganachaud, chercheurs à l’IMP de l’INSA Lyon

Sciences & Société
Congrès National de spectroscopie diélectrique
Seconde édition pour ce colloque national sur la spectroscopie diélectrique et son utilisation pour la caractérisation des matériaux
Une attention particulière sera portée aux applications associées aux propriétés électriques et diélectriques.
Un temps important sera réservé à la discussion (communications de 20 minutes suivies de 10 minutes de questions/discussions) et une session faisant intervenir des partenaires industriels est envisagée.
Información adicional
Palabras clave
Últimos eventos
19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"
Desde 12 Hasta 15 MayoAteliers danse avec la Cie MF
Les 15 et 22 mai 2025
Recherche
Entre Lyon et Montréal, on discute innovations technologiques dans les avions !
1 630 avions à produire par an pendant 20 ans : voilà le chiffre avancé sur le marché du transport aérien, de quoi alimenter la compétitivité dans le domaine ! Pour apporter des réponses efficaces et innovantes aux constructeurs, trois jours de conférences sont programmés les 12, 13 et 14 novembre prochains à La Rotonde de l’INSA Lyon, dans le cadre des très réputés Entretiens Jacques Cartier. A l’INSA, on reçoit, mais surtout, on participe au débat.
« Nous travaillons depuis près de trente ans avec THALES Avionics, qui a sollicité l’INSA Lyon et plus particulièrement le Centre d’Énergétique et de Thermique de Lyon (CETHIL) sur la question du refroidissement des composants électroniques embarqués dans l’avion. À ces Entretiens Jacques Cartier, nous allons intervenir à deux voix avec Claude Sarno, qui est ingénieur INSA et qui travaille chez THALES depuis longtemps » explique Jocelyn Bonjour, Professeur à l’INSA Lyon.
Lui qui enseigne la thermodynamique et les transferts thermiques au Département Génie Énergétique et Environnement de l’INSA Lyon vient de laisser sa place de Directeur au CETHIL pour prendre celle directeur de l’École Doctorale MEGA de l’Université de Lyon (Mécanique, Énergétique, Génie Civil et Acoustique).
Toujours impliqué dans des activités de recherche, et plus précisément sur des travaux sur les caloducs, Jocelyn Bonjour a permis le développement de plusieurs projets de R&D pour l’avionique, notamment pour le management thermique d’électronique embarquée ou de réacteurs. Il est aussi président du Comité permanent international des caloducs (International Heat Pipe Conference).
« Le management thermique, c’est le terme scientifique pour parler de refroidissement. En effet, on ne peut pas détruire la chaleur, il faut donc l’extraire d’un endroit, la transporter, pour la rejeter à un autre endroit. Dans les avions, les besoins en management thermique peuvent se situer du côté des pilotes et de leurs ordinateurs de bord. Il y a 20 ans, ils utilisaient de simples cartes accessibles sur leur ordinateur de bord. Aujourd’hui, ce sont des empilements de composants électroniques qui produisent énormément de chaleur, qu’il faut pouvoir aller chercher pour l’évacuer » explique Jocelyn Bonjour.

Vol Rio-Paris : le gel d’une sonde provoque l’accident mortel, un cas d’école pour le CETHIL et THALES Avionics
« Vous vous souvenez sans doute de ce grave accident d’avion entre Rio et Paris, en 2009, raconte le chercheur. C’est le gel d’une sonde, qu’on appelle tube de Pitot, qui a provoqué cette catastrophe. Le tube de Pitot, qui permet au pilote d’obtenir la mesure de l’avion dans l’air, a gelé en vol, ne permettant plus de jouer son rôle d’indicateur. Le pilote, désinformé, ne connaissait pas sa vitesse de vol et est malheureusement passé au-dessous de la vitesse critique. »
Après cet accident, tous les avions sont rappelés pour être équipés d’une résistance électrique qui permet de générer de la chaleur et éviter le gel.
« Ce n’était pas une solution viable, car la résistance électrique consomme de l’électricité qui ne peut pas être stockée en quantité dans les avions. Avec THALES Avionics, nous avons développé un caloduc qui vient s’adapter sur le tube de Pitot, pour permettre cette fois-ci l’arrivée d’une chaleur inutile ailleurs mais essentielle ici pour éviter le gel » précise Jocelyn Bonjour.
Cette solution, dont les principes de fonctionnement ont été en partie découverts au CETHIL, commercialisée par THALES, est un bel exemple de collaboration scientifico-industrielle, répondant à un enjeu essentiel d’énergie dans le transport.
Avec Airbus, la réflexion s’engage sur la question de la température des moteurs
Plus récemment, c’est à la société Airbus que le CETHIL a répondu concernant des problématiques liées aux moteurs d’avion. Une réflexion s’est engagée sur la réduction de la dilatation différentielle en homogénéisant la température sur le corps des moteurs. En clair, comment parvenir à une température homogène des moteurs d’avion quand ceux-ci surchauffent alors que le reste de l’avion est plongé dans l’air glacé, risquant ainsi de provoquer une rupture thermique ?
« Nous ne sommes pas des inventeurs, mais des chercheurs. Je dirais-même des découvreurs. Je travaille souvent avec des industriels qui viennent me voir avec des problématiques concrètes. Nous menons dans nos laboratoires des expériences pour comprendre ce qui se passe, et ensuite, nous en tirons parti pour proposer des solutions » conclut Jocelyn Bonjour.
Des matériaux hautes performances au service de l’innovation aérospatiale
Avec Jean-François Gérard du laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP), ce sont les liquides ioniques combinés à des résines hautes performances qui seront au cœur du discours, offrant une nouvelle voie prometteuse pour le développement de nouvelles matrices de composites et/ou de formulations d’adhésifs structuraux à base d’époxydes aux caractéristiques non encore atteintes.
« Nous cherchons ici à pousser la performance des matériaux combinant différentes propriétés, résistance aux impacts et à la propagation de fissures voire auto-guérison, tenue au feu, protection contre la corrosion... Forts de notre connaissance de l’intérêt de tels matériaux pour différents secteurs industriels après avoir travaillé avec des sociétés comme Airbus, Ariane, Cytec ou Hexcel, un brevet a été déposé et une maturation se termine avec la SATT Pulsalys. Avec ces liquides ioniques, petites molécules additionnées dans des résines thermodurcissables, nous pouvons aussi accélérer la polymérisation et ainsi réduire les temps de cycle, c’est-à-dire de fabrication. Un gain de temps très intéressant dans un milieu concurrentiel comme l’aéronautique mais aussi l’automobile, friand de matériaux permettant l’allègement des véhicules » indique Jean-François Gérard, ancien Directeur de la Recherche à l’INSA Lyon, actuel Directeur Adjoint Scientifique de l’Institut de Chimie du CNRS à Paris et vice-président du Pôle de Compétitivité AXELERA Chimie, Matériaux et Environnement.

Des Entretiens historiques entre Lyon et le Québec
Pour ce Professeur expert dans le domaine des polymères, les relations tissées entre la France et le Québec sont historiques. Les échanges entre l’INSA Lyon et différentes entités québécoises dans le domaine de la recherche sont extrêmement anciens notamment avec l’Ecole Polytechnique de Montréal. Outre l’aspect purement scientifique, c’est-à-dire les thématiques communes d’intérêt, c’est aussi la même philosophie qui est partagée dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier. À savoir, intégrer les questions liées aux sciences humaines et sociales à des sujets scientifiques, apporter un regard sociétal sur le développement scientifique et technologique, regard qui est une marque INSA.

